
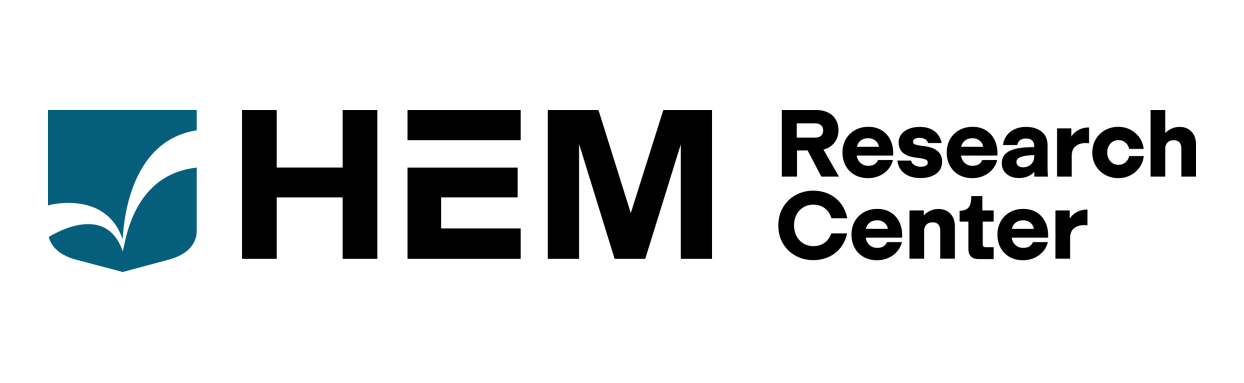
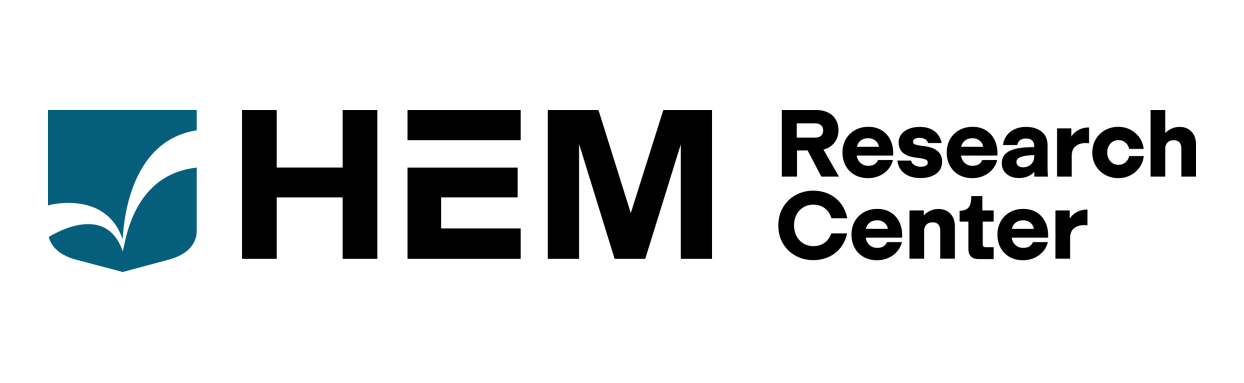
Abdellah Bounfour est titulaire d’une agrégation d’arabe et Professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales à Paris), linguiste et philologue spécialiste de la langue, de la littérature et de la culture ber...
Voir l'auteur ... [2]Ce titre mérite quelques clarifications. La désidéologisation ne doit pas être prise comme synonyme de dépolitisation pour une raison simple : Aristote, pour lequel je ne voterai pas malgré ce qu’il nous a appris, avait défini l’homme comme animal politique. Platon, son maître, pour qui je voterai avec quelques réserves, tenait en grande estime la politique. En témoigne sa République. Mais était-ce le même concept chez l’un et l’autre ? Malgré ce qui les sépare, tous deux assignent à la politique un même but : le bien-vivre ensemble des citoyens de la Cité. Ce projet a été repris par les philosophes musulmans mais avec une nouvelle donne déjà expérimentée par le judaïsme : l’irruption de la religion monothéiste et la tension qu’elle crée avec la philosophie est, rappelons-le, historiquement parlant, plus ancienne. On inventa la notion de la Cité vertueuse (al-madîna al- fâdila). Un des buts de ma contribution consiste à faire comprendre que la qualité du SEEF est un élément constitutif du bien-vivre des Marocains, du moins c’est ce que révèlent toutes les enquêtes. Nul ne peut ignorer, désormais, que ce bien-être passe par l’éducation et la formation de leurs enfants. Les quatre opérateurs dans ce domaine – État, parents, enseignants et société – en sont et en seront comptables.
La désétatisation est chose encore plus sérieuse. Revenons à Platon et à sa République. Sait-on qu’il y professe le communisme des femmes et des enfants ? C’est un peu comme s’il voulait reformer une variante de la horde freudienne. Au lieu d’un mâle qui a le monopole de la violence sur les autres mâles et de la sexualité en s’accaparant de toutes les femelles, on dira que Platon pose la communauté des femmes et des enfants dans le sens où aucune femme n’appartient à aucun homme et aucun enfant n’appartient à ce que nous appellerons, nous, ses parents. La gouvernance se fait en commun. Fantasme, utopie. Allez savoir. Ce qui me plait dans cette fable c’est, malgré tout, cette volonté d’éviter ce qui pollue le vivre ensemble, c’est-à-dire la privatisation du commun. En cela, Rousseau − qu’on aime beaucoup, me semble-t-il, au Maroc − est platonicien. Marocains, encore un effort rousseauiste. Impossible, n’est-ce pas ? Il y a des moments où l’impossible devient possible.
Désétatiser ne signifie pas cela dans mon esprit ; cela signifie de fixer à l’État, puisqu’il est là, des missions qu’il doit assumer. Comme il prélève des impôts – il y tient – il est comptable de la dépense. On lui assigne le devoir de privilégier dans sa dépense ce que les citoyens privilégient quotidiennement : la sécurité, la santé, la justice et l’éducation. Autant sécurité et justice peuvent être étatisées, autant santé et éducation peuvent relever du niveau le plus proche des citoyens.
Désétatiser signifie de manière minimale deux choses : être le plus proche des besoins des gens (région, commune) et garantir les financements qui, eux aussi, peuvent être au niveau de la région, voire de la commune.
Pour penser la gouvernance du SEEF, il n’est pas inutile d’inviter à se déprendre de deux modes de pensée qui nous sont familiers, la déduction et l’induction. S’en déprendre ne signifie pas les jeter aux orties ni même les suspendre l’espace d’un matin. Pourquoi ? Parce que le raisonnement déductif a un risque : l’emprunt d’un modèle pour l’appliquer à un contexte singulier. Je crois que toutes les réformes du SEEF ont commis ce péché mignon. On a sacrifié la réflexion confrontée à une situation singulière. On a simplement évité de penser non par incapacité ou incompétence, mais par crainte de rencontrer les failles, les responsabilités, nos propres failles, nos propres responsabilités. Celles de tous : État, société, enseignants, parents, enfants, etc. On a évité la disputation par peur de dispute. Toutefois, si l’on diagnostique que la crise du SEEF est strictement technique, il est inutile de perdre son temps : les modèles existent avec leurs modes d’emplois et leurs résultats qui parlent pour eux. Il suffit de publier un appel d’offre et choisir le moins-disant financier. Mais si l’on pense que, quel que soit le modèle, le SEEF ne réussira sa réforme que par la mobilisation à la manière des Japonais de la période Meiji1, alors c’est à cela qu’il faut s’atteler. Je peux déjà annoncer que, pour ce faire, il n’y a pas de modèle, à la rigueur des expériences.
Le raisonnement inductif, lui, a un autre risque : le fantasme de découvrir l’Amérique. Mon expérience d’enseignant accompagnant les étudiants dans leurs travaux de recherche m’a familiarisé avec ce fantasme. Sans craindre d’être démentie, on peut émettre l’hypothèse que la plupart des problèmes du SEEF ont été rencontrés ailleurs, que beaucoup ont trouvé leur solution. L’hypothèse complémentaire est aussi plausible : certains problèmes sont spécifiques au contexte marocain. On me dira alors pourquoi ne pas prendre les solutions d’ailleurs et tenter de résoudre les problèmes spécifiques. Rien de plus dangereux ! Le problème fondamental réside dans l’articulation du spécifique et du non-spécifique. Encore faut-il les identifier, les hiérarchiser avant de les articuler. C’est pour cela que seule l’expérimentation en contexte réel pourra apporter non seulement les meilleures solutions possibles, mais transformer en créateurs les participants à cette expérimentation.
Que faut-il expérimenter ?
Si l’on accepte le contenu global du SEEF tel que je l’ai défini2, l’expérimentation va porter sur les points suivants :
Le nœud de toute réforme réside dans la gouvernance et la formation des acteurs non seulement de cette gouvernance mais des autres que sont les enseignants, les évaluateurs de tous ordres, les parents et les jeunes. Vu l’espace qui m’est imparti, je me contenterai de la gouvernance.
Quatre principes en sont la base :
La formation continue doit concerner l’ensemble du personnel chargé de la gouvernance. C’est sur cette base et sur la créativité des personnels que leur carrière doit être jugée car, avec l’ancienneté, c’est l’un des critères les plus objectifs pour évaluer les personnels. Il y en d’autres, bien sûr. Je veux insister qu’une innovation dans la gouvernance par un agent soit reconnue sienne, porte même son nom et lui permette d’avancer dans sa carrière. Mais, nous n’en sommes pas encore là aujourd’hui. Néanmoins, formation continue et innovation sont le combustible du SEEF, et ce, à tous les niveaux.
Pour conclure, je me contenterai de ce schéma qui visualise l’organigramme cadre de l’expérimentation de la réforme du SEEF.
Bibliographie
1. Sous le règne de l’empereur Meiji débute la période Meiji, une ère du « gouvernement éclairé » ou « politique éclairée », équivalente à la période des Lumières en Europe au XVIIIe siècle.
2. Se reporter au site de mon blog La parole et la trace : a1540b.unblog.fr
3. Ensemble d’indications sur l’état civil, les diplômes et l’expérience d’un candidat à un poste.
4. Si l’on m’avait écouté naguère, la seconde langue nationale, l’amazighe, aurait été, dans ce contexte, régionalisée avec une mise en marche d’un travail de standardisation à long terme consenti par tous.
5. Je tiens à signaler que c’est en relisant ce texte que cette gouvernance m’apparaît proche du système allemand, sans toutefois se confondre avec lui. Ce sont peut-être les traces mnésiques de mes années d’activité à l’Université de Heidelberg.