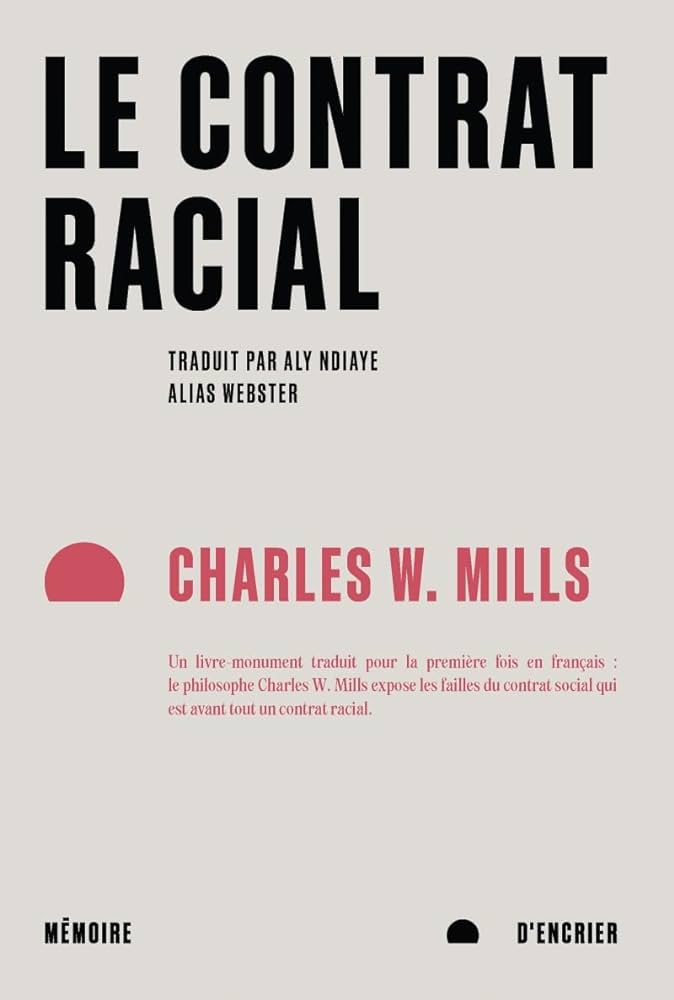Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique
Auteur : Éric et Alain Boquet et Pierre Gaumeton, préface d’Éric Vernier
La finance éthique en 10 leviers d’action
Alors que la Banque mondiale et le FMI viennent de tenir leur assemblée à Marrakech sans avancée pour l’Afrique, il est utile de relire le manifeste pour une finance éthique des frères Bocquet.
Ils ont remporté en janvier 2018 le prix éthique décerné par Anticor, association française de lutte contre la corruption, pour leur « combat pour l’égalité des citoyens devant l’impôt ». Éric et Alain Bocquet sont frères, ont été élus du parti communiste français et travaillent sur la question de la justice fiscale. Après Sans domicile fisc (Le Cherche midi, 2016), en collaboration avec le journaliste Pierre Gaumeton, ils font le bilan de l’ère post-covid dans Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique, paru en 2021.
La première partie de bilan sur les conséquences de la pandémie, qui a fait ruisseler l’argent vers le haut tandis que le prix le plus lourd, direct et indirect, a été payé par les plus fragiles. 3,9 millions de morts du coronavirus dans le monde, 183 millions de malades, 430 millions d’entreprises en danger dans le monde selon l’Organisation internationale du travail : un « potentiel tsunami de pauvreté », alertait l’expert du développement international Andy Summer, s’inquiétant d’une « crise dévastatrice et sans précédent ». D’autant que la pandémie a servi de prétexte à des licenciements, des mises au chômage partiel, des restructurations en vue de concentrer les profits des grands groupes mobilisant toutes les ressources de la finance afin de se soustraire à leurs obligations de redistribution, c’est-à-dire à l’impôt – y compris quand ils bénéficient de soutiens publics.
Or, clament les auteurs, « l’évasion fiscale est une délinquance délibérée. Elle totalise à son passif des millions de victimes. Délinquance délibérée, mais quand la justice intervient, pour éviter des procès coûteux et dévastateurs sur le plan de la renommée, les multinationales préfèrent passer par un arrangement préalable. Je négocie, s’il le faut, je signe un chèque, et basta, j’évite le coup de bambou d’une condamnation et du déshonneur. En définitive, je reste gagnant, et peu importe ce qu’il en coûte à la société. » Et de conclure : « Un sport de parasites ». Éric et Alain Bocquet appellent l’ampleur du phénomène : « L’ONG Tax Justice Network estimait en 2010 de 21 000 à 32 000 milliards de dollars la richesse privé e cachée ». Environ 8 % du PIB mondial, selon l’estimation de l’économiste français Gabriel Zucman. En cause, les « États parasites » qui abritent les paradis fiscaux. Les auteurs en appellent à une politique étatique volontaire pour garantir la solidarité, mettre fin à la marchandisation de la dette sur des marchés très opaques, repenser la notion de biens communs (comme les vaccins…). Et surtout pour refuser la naturalisation, notamment par les algorithmes, d’un mode de fonctionnement qui ne profite qu’à une oligarchie. « Nous refusons que les États se muent en vassaux de ces multinationales. […] Nous devons défendre notre libre arbitre et nos valeurs face à l’algorithme du libéralisme, destructeur d’humanité ; un libéralisme qui ne renvoie pas au concept de liberté universelle mais à la liberté de pouvoir d’une oligarchie et de ses vassaux. »
Responsabilité commune
Pour Éric et Alain Bocquet, il est essentiel que la finance et l’économie redeviennent l’affaire de tous pour qu’elles soient au service de tous. Tout le monde a ainsi la responsabilité de s’engager pour activer plusieurs leviers. Les auteurs en identifient dix.
- Créer une COP (conference of partie) fiscale, comme pour le climat, afin de redéfinir des règles, de fixer des normes et de les faire appliquer. Il s’agit d’aller plus loin que l’OCDE, dont la représentation est déséquilibrée en faveur des pays les plus riches.
- Créer une Organisation mondiale de la finance, sous l’égide de l’ONU et à la place de la Banque mondiale et du FMI, pour rompre avec une logique spéculative. Les auteurs rappellent le gouffre, en 2008, entre l’économie réelle (55 000 milliards de dollars) et les transactions financières (2 200 000 milliards de dollars). « Des chiffres qui mesurent la déconnexion croissante de la finance et de l’économie représentant des bulles spéculatives, autant de bombes à retardement. » Sans oublier l’explosion du « shadow banking », où les transactions financières ne sont pas soumises aux régulations bancaires. Cela supposerait une vraie réforme du système bancaire pour « autoriser les banques centrales à financer les États pour la relance économique » et « interdire toute transaction financière en direction des paradis fiscaux ».
- Mettre fin à la spéculation, réguler le commerce des matières premières énergétiques et industrielles, taxer les transactions financières, ce qui permettrait de dégager les 200 à 300 milliards de dollars par an nécessaires à éradiquer la faim et l’illettrisme. « Même le FMI l’avait souligné dans un rapport daté de 2011 ».
- Créer une infraction de blanchiment, en adaptant les logiciels de contrôle du secteur bancaire et en établissant des responsabilités visant directement les hauts dirigeants (« suspension des licences d’activités bancaires, amendes personnalités, peines de prison »). Le domaine des cryptomonnaies est aussi un enjeu.
- Bloquer les flux financiers vers les paradis fiscaux et interdire les « passeports dorés » complaisamment offerts à de riches investisseurs.
- Mettre fin à l’impunité fiscale, notamment en responsabilisant les cabinets de conseil, qui ne doivent pas cumuler un rôle d’audit et un rôle de conseil et devraient « rendre public un rapport d’activités détaillé pour chacun des pays où ils sont implantés ».
- Bâtir une fiscalité juste et démocratique, par une politique fiscale adaptée, reposant sur le « cadastre financier » préconisé par Gabriel Zucman pour établir une transparence, et sur la progressivité de l’impôt.
- Rompre avec l’austérité en dissolvant en partie la dette ou en la remboursant et en conditionnant l’octroi d’aides publiques aux entreprises « à l’arrêt des plans sociaux, à la mise en œuvre de contreparties sociales et environnementales [et] au non-versement de dividendes ».
- Rompre avec l’enseignement de l’orthodoxie financière libérale : « Le pluralisme doit être le symbole même des formations universitaires. Il convient de réintroduire ce qui fait la richesse et la portée universelle de l’enseignement, la diversité des approches et des analyses. »
- Se mobiliser, en tant que citoyen client d’une banque, pour réclamer un droit de regard sur les pratiques de celle-ci. Et donner un statut aux lanceurs d’alertes. Les auteurs proposent de s’inspirer de la mobilisation anti-mafia en Italie, mais aussi du refus citoyen des Islandais de supporter la dette et la faillite des banques après la crise de 2008.
Un livre plein d’optimisme.
Kenza Sefrioui
Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique
Éric et Alain Boquet et Pierre Gaumeton, préface d’Éric Vernier
Le Cherche midi, 224 p.,
Le contrat racial
Auteur : Charles W. Mills, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aly Ndiaye alias Webster
Contre la « blanchocratie »
Enfin traduit en français, l’essai majeur du philosophe caribéen-américain Charles Wade Mills, montre l’impensé raciste du contrat social.
Il a fallu 25 ans pour que ce texte essentiel soit traduit en français, grâce au travail remarquable des éditions Mémoire d’encrier basées à Montréal. Paru en anglais en 1997, The Racial Contract a obtenu entre autres le Gustavus Myers Outstanding Book Award qui récompensait des ouvrages luttant contre l’intolérance. Référence du mouvement antiraciste, il est dédié « à tous les noirs, rouges, bruns, et jaunes qui ont résisté au contrat racial ainsi que les renégats blancs et les traînes à la race qui l’ont refusé ». Le contrat racial est en effet un vibrant plaidoyer pour la justice raciale. Son auteur, Charles Wade Mills (1951-2021), d’origine jamaïcaine, était professeur émérite de philosophie à la City University of New York (CUNY) et est reconnu comme un pionnier de la théorie critique de la race. Son traducteur, Aly Ndiaye alias Webster, est également une figure de la recherche sur l’histoire de l’esclavage et de la présence afro-descendante en Amérique du Nord, en plus d’être artiste hip-hop.
« La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu’il est aujourd’hui », écrit Charles W. Mills. En effet le racisme n’est pas un épiphénomène, il est au cœur du système de domination mondial. Quand Rousseau publiait son Contrat social, sa réflexion était tronquée car elle ne prévalait que pour les Blancs et non pour toutes celles et tous ceux que l’Europe coloniale avait rejeté hors de l’humanité et de la citoyenneté, dans un statut de « sous-personnes ». Pour Charles W. Mills, il est urgent de faire paraître ce fait au grand jour pour mettre fin à ce type de domination. En effet, cette dernière repose sur l’invisibilisation de son postulat de base, de même que tous les ordres patriarcaux, bourgeois, etc. tentent de se présenter comme naturels afin de se placer hors d’atteinte des remises en question…
Repenser la notion de contrat
Proche sur ce point du philosophe Lucius Outlaw, qui insiste sur l’importance sociopolitique de la notion de race, Charles W. Mills se distingue de John Rawls qui, ne reconnaissant pas la suprématie blanche dans sa pensée du libéralisme (pas un mot sur l’esclavage…), laisse de côté la notion de justice raciale. Il invite donc à dépasser la notion biaisée de contrat social et à travailler sur une « métaphore concurrente » : celle d’un « “contrat de domination” que ce soit pour la race, comme dans le contrat racial, ou dans d’autres contextes », afin d’intégrer les luttes anti-impérialistes, anticoloniales, abolitionnistes, antiapartheid, antiracistes… « dans un espace discursif qui aborde les mêmes problèmes que la théorie dominante, mais en suivant des lignes d’investigation racialement motivées plutôt que racialement évasives ». Son travail remet donc au cœur de la philosophie politique, dont il était absent, le moteur des « luttes politiques de la majorité de la population mondiale ». En ce sens, Charles W. Mills prend le contrat comme une manière de décrire une société inégalitaire, non idéale, afin, par cette description de la dénaturaliser et d’en démystifier les mécanismes. Il fait le parallèle avec Le contrat sexuel (1988), de Carole Pateman, qui elle aussi fait du contrat un mode opératoire rhétorique.
La démonstration, en dix points, s’articule en trois parties, « trois affirmations simples : l’affirmation existentielle, c’est-à-dire la suprématie blanche, tant locale que mondiale, existe, et ce, depuis plusieurs années ; l’affirmation conceptuelle, soit qu’on devrait percevoir la suprématie blanche comme un système politique en soi ; et l’affirmation méthodologique, à savoir qu’en tant que système politique, on peut théoriser la suprématie blanche de manière éclairante comme étant basée sur un “contrat” entre Blancs, un contrat racial ».
La première partie propose une « Vue d’ensemble », et rappelle qu’aux dimensions politiques et morales de la notion de contrat, s’ajoute ici une dimension épistémologique, avec « des normes de cognition auxquelles les signataires doivent adhérer » (même si les non-Blancs en sont les objets et non les sujets) : la sous-catégorisation des humains entre Blancs et non-Blancs – « hallucination consensuelle » qui contredit l’égalité morale des humains. C’est aussi une réalité historique à l’échelle mondiale, fondée depuis le Moyen-Âge sur des dichotomies géographiques, culturelles et religieuses et servent de base morale et politique aux contrats d’expropriation, d’esclavage et de colonisation au profit de l’Europe. Les conséquences de ce « contrat d’exploitation » sont économiques, créant la domination européenne mondiale et le privilège racial national blanc : le mythe de « la spécificité et de l’exceptionnalisme des Européens » continue à être présupposé, occultant la dimension coloniale et néocoloniale du capitalisme européen.
La deuxième partie aborde dans les détails la façon dont le contrat racial découpe le monde : la dichotomie entre civil et sauvage organise l’espace politique et définit qui en est exclut. Idem à l’échelle des individus, où il distingue qui est une personne, membre de la communauté politique, et qui est une sous-personne, avec un statut inférieur en droit. Charles W. Mills insiste sur la permanence de ce fondement du contrat social, malgré les évolutions que ce dernier a connues : « les conditions d’appartenance à la blanchité sont réécrites au fil du temps, avec des critères changeants prescrits par l’évolution du contrat racial ». Il insiste aussi sur le conditionnement idéologique au racisme.
La dernière partie, « Mérites “naturalisés” », fait l’histoire de « la véritable conscience morale/politique (de la plupart) des agents moraux blancs) », de Hobbes à Marx, en passant par Locke, Rousseau, Kant, Hegel… Charles W. Mills observe des « structures intéressantes de distorsion cognitive morale » qui se modifient selon qu’il s’agit du « sous-ensemble blanc (les humains) » ou du « sous-ensemble non blanc (les moins qu’humains) ». À la norme idéale énoncée par le contrat social, il oppose « la norme réelle (le contrat racial) ». Théorie du point de vue, à l’appui, il relève que si les non-Blancs reconnaissent le contrat racial comme le véritable déterminant des pratiques morales et politiques blanches, c’est qu’il s’agit du véritable accord moral et politique à contester – la race étant une réalité sociopolitique. « Reconnaître le “contrat racial” comme un système politique donne un aspect volontaire à la racialisation de la même manière que le contrat social donne un aspect volontaire à la création de la société et de l’État. » Cette lucidité sur les enjeux de pouvoir rend hommage à celles et ceux qui ont défié cette « blanchocratie ». L’espoir de Charles W. Mills était que ses écrits « puissent contribuer à créer une société meilleure ».
Kenza Sefrioui
Le contrat racial
Charles W. Mills, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aly Ndiaye alias Webster
Mémoire d’encrier, 204 p., 20 €
En ruta con el comun, archivo y memoria de una possible constelacion
Auteur : Palmar Alvarez-Blanco
La constellation des communs
Le collectif coordonné par Palmar Álvarez-Blanco construit une archive alternative des pratiques autogérées et non capitalistes fondées sur la culture des biens communs.
École publique, santé publique, transports en commun, sécurité sociale… Pour la chercheuse espagnole Palmar Álvarez-Blanco, professeure au Carleton College dans le Minnesota et spécialiste des crises du système capitaliste, réaliser lors du mouvement des Indignés en 2011 que la plupart des jeunes revendiquaient comme une nouveauté ce qui pour sa génération avait été un service public garanti par l’État a été un choc. « Cette perception de la “nouveauté” de quelque chose de très familier m’a conduit à vouloir comprendre à quel moment quelque chose de central dans une biographie apparaissait comme un axe politique possible d’une transformation civilisationnelle et écologique », explique en préface la fondatrice de l’association internationale ALCESXXI, qui s’intéresse aux domaines éducatifs, culturels et de recherche menacés par le capitalisme. Palmar Álvarez-Blanco initie alors en 2017 un ambitieux projet de documentation d’expériences contemporaines, Constelacion de los Comunes (la Constellation des Communs). Un site avec des enregistrements audiovisuels, des podcasts mais aussi un livre, En ruta con el comun, archivo y memoria de una posible constelacion (2017-18-19) (En route avec les communs, archive et mémoire d’une constellaiton possible (2017-18-19)), publié sous licence Creative Commons, en libre téléchargement en ligne ou à commander au format papier aux éditions La Vorágine, basée à Santander – un mode de production qui s’inscrit dans la même démarche solidaire que celle qu’elle documente.
Au départ, le constat que les orientations néolibérales ont fait régresser le syndicalisme, réduit les aides sociales, la protection des travailleurs indépendants, précarisé les travailleurs indépendants, intensifié les discriminations fondées sur le sexe, la classe, etc. et dépolitisé la société. Et une question : pourquoi, « dans un prétendu État de droit, ce sont des personnes, en marge des institutions, qui répondent aux urgences et aux besoins » ?
Pour le collectif d’autrices et d’auteurs, chercheurs, activistes, acteurs institutionnels ou impliqués dans les économies sociales et solidaires, qui ont sillonné de 2017 à 2019 l’Espagne à la rencontre des acteurs sociaux mettant en pratique la culture des communs, ceux-ci représentent au contraire l’intérêt général. Des orientations ancrées dans les vécus : « Dans la revendication du commun, toute une série de tragédies, personnelles et collectives, sont présentes. » Tous ces acteurs ont en partage un engagement concret au service d’une vision politique, engagement qui se traduit par une praxis en mouvement. Le commun, c’est une pratique quotidienne, un « élan vital, un mode de vie et une position politique non capitaliste, responsable, solidaire et engagée pour un projet de vie écologique, juste et durable, où les mêmes conditions matérielles et les mêmes possibilités sont accessibles à tous. »
« Mettre le « je » au pluriel »
Onze thèmes traversent les 44 entretiens avec les initiateurs et initiatrices de projets aux noms porteurs de riches imaginaires (Pandora Mirabilia, Libros en Accion, El Salto, Colaborabora, Wikitoki, OVNI, Sosterras, La Tribu Suguru, Autofabricantes…), de Madrid à Séville en passant par Valladolid, Bilbao, Saint Jacques de Compostelle, Barcelone et Santander : justice sociale, défense des droits fonciers, du droit à la santé et à l’autonomie, de l’égalité entre hommes et femmes, du droit à un travail digne, des droits des personnes, du droit au travail, des droits des migrants, du droit à un logement décent, du droit à une éducation à tous les stades de la vie, du droit à une éducation aux médias et à l’information, mais aussi artivisme comme forme d’expression politique et exploration de nouvelles formules politiques et économiques.
L’objectif n’était pas de choisir des expériences représentatives, mais de se mettre à l’écoute d’une diversité d’expériences pratiques et de propositions concrètes autour de cette question partagée : « Dans quel monde voulons-nous vivre ? » La retranscription de ces entretiens passionnants et riches a supposé une attention particulière à la méthodologie et à la manière de faire apparaître les règles similaires. En effet, aucun interviewé n’est inventeur du concept de communs, mais le recrée selon sa perception. Les choix d’écriture cherchent donc à situer les interviews, à articuler les dimensions individuelles et collectives, les aspects institutionnels et sociohistoriques, à éviter de plaquer artificiellement un cadre théorique sur ces pratiques, et à réhumaniser les sciences humaines en y intégrant la « matérialité de la vie », en revendiquant la continuité entre action, pensée, émotion et imagination. En effet, le livre n’est qu’une facette de la cartographie et de la constitution de l’archive présentée en ligne. Une archive interrogeant les conditions de sa propre production, pour ne pas être, comme une archive conventionnelle, un « mécanisme de pouvoir » reproduisant les hiérarchies : une « anarchive », plutôt, se voulant lieu de rêve, de partage et de débat, pour « court-circuiter les mécanismes de production, d’autorisation et de stockage de la relation de pouvoir et de savoir ». D’où l’image du rhizome, de la constellation, transversale, complexe, interdisciplinaire et ouverte, revendiquant au final le droit à l’imaginaire pour penser hors des cadres établis et ouvrir les horizons. « L’urgence des réponses n’est pas seulement légale, juridique, économique et politique, c’est aussi une tâche culturelle. » À la doxa capitaliste et à ses ressorts individualistes reposant sur la concurrence et l’autoexploitation et qui génèrent isolement et inaction, les auteurs opposent le bon sens « lié à la conscience éthique appuyée sur des valeurs communautaires : entraide, solidarité, équité, hospitalité, soutien mutuel et reconnaissance », avec l’idée que « sans praxis, il n’y a pas de chemin ». Une approche « polyéthique pour le XXIème siècle », qui considère la politique comme « une éthique du collectif » et rappelle à l’État sa vocation à servir la population plutôt que les exigences du marché.
Kenza Sefrioui
En ruta con el comun, archivo y memoria de una possible constelacion (2017-18-19)
ss. dir. Palmar Alvarez-Blanco
La Voragine, 587 p., licence Creative Commons
Disponible en ligne en espagnol sur : http://https://constelaciondeloscomunes.org/en-ruta-con-el-comun/
Et en anglais sur : https://constelaciondeloscomunes.org/en/in-route-with-the-commons/
Entretien avec Mohamed Tozy : Macro et micro-politique des territoires au Maroc
SOMMAIRE :
LE TERRITOIRE COMME CONCEPT
Une notion largement utilisée, souvent même galvaudée, le territoire reste tout de même incontournable.Quelle est votre approche de cette notion?
Quel est l’état de cette notion dans le contexte marocain?
Que s’est-il passé pour que le territoire soit imposé comme élément politique au Maroc
QUI CONTRÔLER, HOMMES OU TERRITOIRES ?
Si la question de contrôle des territoires était jusqu’alors mineure, comment s’opérait le contrôle des hommes pour exprimer le pouvoir politique ?