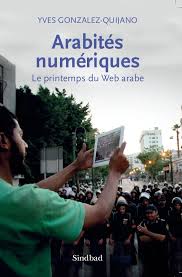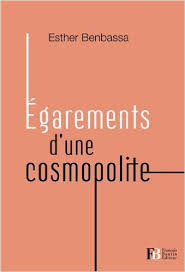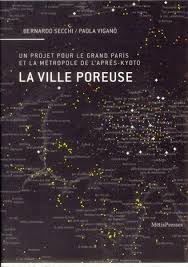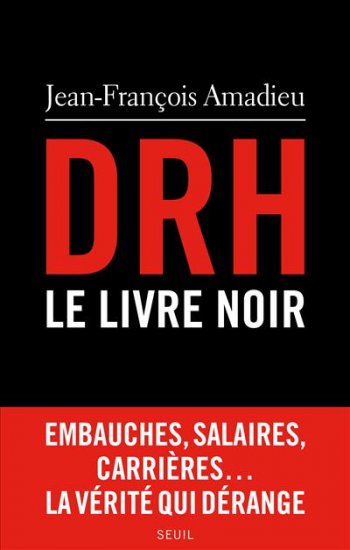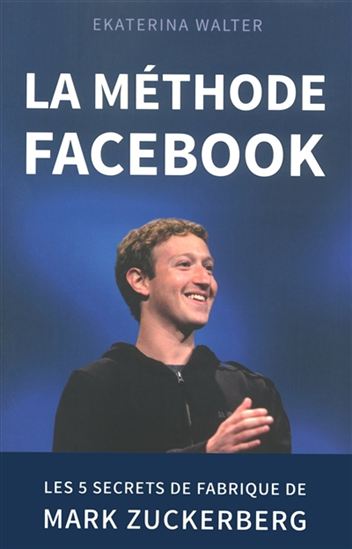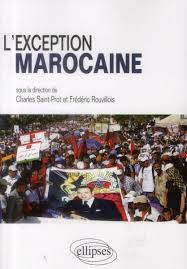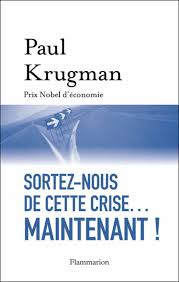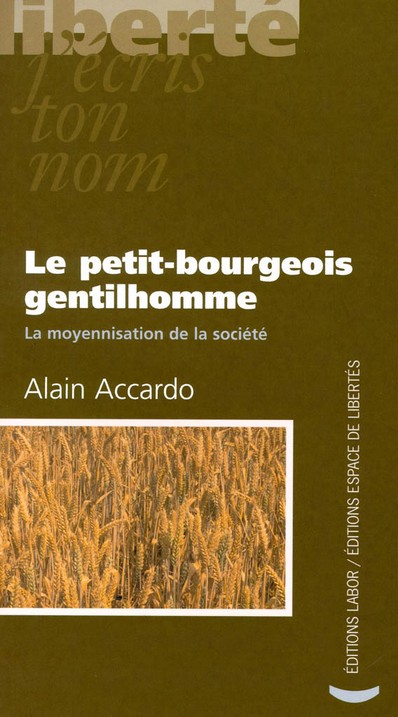
Le petit-bourgeois est l’homo oeconomicus capitalisticus
Auteur : Alain Accardo
Pour Alain Accardo, rompre avec le mode de vie petit-bourgeois est le seul moyen de combattre l’hégémonie du capitalisme.
Décidément, s’indigne le sociologue Alain Accardo, le « prolo » n’est plus ce qu’il était ! Fini « le temps des prolétaires « purs et durs » », l’heure est aux « prolétaires à temps partiel ». Car ce n’est plus le prolétariat qui doit être « le vecteur potentiel du changement social », mais la petite-bourgeoisie. Quand prime la logique économique, quand « la morale de la modernité est une éthique entrepreneuriale qui se résume à une triple règle aussi catégorique que l’impératif kantien ; quoi qu’on entreprenne il faut : a) réussir ; b) dans le plus court terme ; c) au moindre coût », il se produit une « moyennisation de la société » : l’influence des classes moyennes grandit et leur mode de vie consumériste devient la norme. Or, la soif de consommation du petit-bourgeois étant limitée par ses moyens, celui-ci n’est qu’« une caricature de bourgeois, condamnée à la simagrée et au simulacre perpétuels ». « Exister socialement, c’est être vu, ironise l’auteur. Nos classes moyennes se sont procuré des moyens nouveaux de se donner en spectacle et de s’imposer à l’attention d’autrui. Des moyens d’une telle puissance qu’en comparaison les gesticulations et les pitreries voyantes de Monsieur Jourdain et de ses moniteurs pourraient passer pour un modèle de discrétion et de retenue ». Cette « comédie de la grandeur » conditionne les classes moyennes à « confondre l’être avec l’apparence de l’avoir ». Leur éthique ? une « soif inextinguible de jouissance immédiate, sans fin et sans frein », une épargne, non pour les coups durs mais « pour s’enrichir », des « comportements du type après-moi-le-déluge » sous couvert de libertarisme et un activisme humanitaire pour compenser « l’abandon du projet politique de transformation des rapports sociaux ». Ces consommateurs infantilisés et aux liens de solidarité restreints sont, « pour le capitalisme, la meilleure population, la plus réceptive, la plus docile et la plus enthousiaste ».
Dialectique du dedans et du dehors
Alain Accardo s’interroge depuis longtemps sur l’échec de la lutte anticapitaliste. Celle-ci, postulant la séparation entre travailleurs et propriétaires des moyens de production, imputant l’indifférence des exploités à la « méconnaissance de leurs véritables intérêts de classe », et sans théorie de la subjectivité individuelle, a commis une « erreur objectiviste ». Les travaux de Pierre Bourdieu, notamment Les Héritiers et La Distinction, ont fait prendre conscience au sociologue militant qu’« un même univers social existe toujours sous deux formes conjointes », des « structures objectives de distribution de différentes espèces de capitaux » et des « structures subjectives de personnalité au-dedans », toutes deux homologues, car un système social « façonne les diverses variantes de celui qui peut contribuer à son fonctionnement et à sa reproduction. » Alain Accardo réalise donc que « le système objectif dans lequel nous vivions vivait aussi en nous, sous forme d’un homo oeconomicus capitalisticus toujours davantage enraciné dans toutes les dimensions de notre subjectivité ». Si le capitalisme a tant de succès, c’est qu’il repose sur une adhésion volontaire, sur le mode de « l’inconscient social ».
L’analyse d’Alain Accardo se double d’un violent réquisitoire contre les classes politiques des démocraties occidentales, surtout contre la gauche social-démocrate et réformiste, « convaincues que l’économie libérale est la source de la prospérité généralisée », « contresens fondamental » qui occulte l’histoire des résistances du capitalisme à une plus juste répartition des richesses. Il déplore la réduction à peau de chagrin de l’autonomie du champ politique : « Les étiquettes traditionnelles de « gauche » et « droite » ne servent plus qu’à désigner, sur l’échiquier politique, des différences dans l’évaluation et le rythme des concessions qu’il convient d’opérer, en matière de politique sociale, pour éviter que la contestation de l’ordre établi n’atteigne un seuil critique risquant de compromettre son bon fonctionnement et sa reproduction ». Or, « à quoi bon faire de la politique si la seule politique possible est de gérer l’ordre économique imposé par les puissances de l’argent ? » Alain Accardo dénonce la « propagande » du capitalisme, tolérant une certaine contestation qui « constitue la part fonctionnelle de dissensus dont le régime a besoin pour s’affirmer démocratique », tout en veillant à ce que ses fondements restent « hors du champ de la discussion légitime ». Il décrypte le rôle de l’école dans la reproduction de ce système : si un gouvernement ordonnait aux enseignants « de s’arranger pour que l’échec scolaire frappe massivement, tout au long du cursus, les enfants des classes populaires – de sorte qu’au niveau des formations et des filières les plus prestigieuses on ne trouve qu’un pourcentage infime de ces enfants, véritables miraculés de la sélection par l’échec –, ils crieraient au scandale, au crime contre l’esprit et s’insurgeraient contre de telles instructions. Et pourtant c’est exactement ce qui se passe dans la réalité ». Idem dans le domaine de l’information : « De nos jours, on ne traînerait probablement plus Galilée en justice. Mais on continue à instruire en toute occasion le procès truqué de tous ceux qui, de Marx à Bourdieu, ont dénoncé les mensonges et les illusions de nos sociétés de classes. » Et de dénoncer le fait que la majorité est reléguée dans un quasi analphabétisme en matière d’analyse historique et sociale et privée des instruments de pensée utiles à une démarche critique.
Ainsi, rompre avec le capitalisme ne saurait se faire sur le seul plan politique et collectif : cela passe aussi par une rupture individuelle avec le mode de vie petit-bourgeois. Seule cette « critique des mœurs » permettra au peuple de cesser de rêver au mode de vie de la middle class américaine, de recouvrer sa souveraineté et de renouer avec cette « pierre de touche de tout humanisme véritable » qu’est la lutte pour éradiquer les inégalités. Cela commence par un travail sur soi pour échapper à la « dictature du marché ». Et cela permettrait d’éviter d’attendre « on ne sait quel « Grand Soir » ».
Par : Kenza Sefrioui
Le petit-bourgeois gentilhomme, sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes
Alain Accardo
Agone, Contre-feux, 160 p., 13 €
Lorsque l’économie deviendra collaborative
Auteur : Jeremy Rifkin
Wall Street s’effondre, les énergies fossiles s’épuisent, l’économie mondiale s’écroule… Allons-nous tout droit vers la catastrophe ?
Absolument pas si on veut bien écouter un économiste visionnaire qui s’appelle Jeremy Rifkin.
Il est grand temps, selon Jeremy Rifkin, économiste, Professeur à la Wharton school de Pennsylvanie, Conseiller des chefs d’Etat et de gouvernements, de passer à… la troisième révolution industrielle ! L’ère post carbone rend son dernier souffle, et toute l’industrie et les infrastructures qui vont avec vont disparaître. Les entreprises de la deuxième ère industrielle ont suivi le modèle centralisé et élitiste des énergies fossiles et c’est justement ce qui menace, également leur survie.
L’auteur de dix-huit best sellers, nous propose un livre optimiste tout en partant d’un bilan totalement catastrophique : Le chômage qui augmente dans le monde entier, les Etats, les entreprises et les individus surendettés et un système économique à perte de vitesse. Mais quelles solutions peut-on apporter dans un tel désastre ?
«Au cours de mes investigations, explique l’auteur, j’ai fini par comprendre que les grandes révolutions économiques de l’histoire se produisent quand de nouvelles technologies des communications convergent avec des nouveaux systèmes d’énergie ». L’idée centrale de ce livre est que nous allons tous pouvoir produire de l’énergie verte, à partir de notre maison, de notre bureau et les partager à grande échelle sur un « Internet de l’énergie » exactement comme «nous créons et partageons aujourd’hui l’information en ligne » ! L’auteur annonce la venue d’une ère nouvelle : L’ère coopérative qui va remplacer l’ère industrielle que nous vivons.
Ce nouveau système s’appuie sur les énergies renouvelables et se nourrit des éléments de la nature : « le soleil, le vent, l’hydro énergie, la chaleur géothermique, les vagues et les marées des océans ». Rifkin va encore plus loin et propose de stocker ces énergies en développant la technologie de l’hydrogène.
L’ère coopérative qui va chambouler nos vies devrait arriver à son point culminant en 2050. Nous dirons alors adieu à l’autorité hiérarchique, au diktat du capital financier, à la discipline et au travail acharné… Cela paraît impensable ! Mais l’ère coopérative « privilégie le jeu créatif, l’interactivité pair à pair, la capital social, la participation à des communaux ouverts et l’accès à des réseaux mondiaux ». Ainsi nous vivrons un temps où la technologie intelligente impactera l’économie mondiale. Cela s’accompagnera dans un premier temps de perte massive d’emplois annonçant la fin du salariat de masse. « Le XXIème siècle sera celui des petites équipes ultraspécialisées et ultracompétentes qui programment et surveillent des systèmes technologiques intelligents ».
Il faudra donc d’ores et déjà se préparer à cette nouvelle économie , l’Allemagne en est déjà pionnière !
Une nouvelle ère d’emploi
Dans le monde du travail que nous connaissons aujourd’hui nous sommes assujettis à quatre sources génératrices d’emploi : Le marché, L’Etat, l’économie informelle et la société civile. (Par société civile il faut entendre : les associations à but non lucratif, les ONG…)
La nouvelle révolution industrielle va induire des sabrages dans les emplois comme cela s’est passé lorsque l’homme est passé du travail agricole au travail industriel. « La société civile va probablement devenir une source d’emplois aussi importante que le marché au milieu du siècle. Pour une raison évidente : le capital social se crée par l’interactivité humaine, tandis que le capital du marché se créera de plus en plus par la technologie intelligente ».
Cela paraît démentiel et pourtant pour peu que l’on se penche sur les chiffres nous décèlerons déjà les prémices de cette prophétie. Selon une étude menée en 2010* et qui concerne huit pays (Etats-Unis, France, Canada, Japon, Australie, République tchèque, Belgique, Nouvelle Zélande), on découvre une chose absolument bouleversante : La société civile ou le tiers secteur représente en moyenne 5% du PIB. « Cela signifie qu’aujourd’hui, dans ces pays, le secteur à but non lucratif contribue davantage au PIB que les compagnies d’électricité, du gaz et de l’eau ! Qu’on le croit ou non, il contribue autant que le bâtiment (5,1%) et presque autant que les banques, compagnies d’assurances et services financiers (5,6%) ».
Des chiffres surprenants, qui nous invitent à considérer autrement ces emplois.
S’affranchir du pouvoir hiérarchique pour un système latéral et collaboratif est déjà en route. Les exemples se multiplient dans le monde. Nous vivons des initiatives aux quatre coins de la planète qui convergent grâce à la puissance Internet. Ce qui permet des partages à très grande échelle. C’est le cas de Wikipédia et la communauté Linux pour ne citer que ceux là. Le système mis en place par Linux « se compose de milliers de programmateurs qui, en coopérant entre eux, consacrent leurs temps et leurs compétences à corriger et améliorer le code logiciel utilisé par des millions de personnes. Toutes les modifications, mises à jour et améliorations qu’ils apportent au code sont dans le domaine public, mises gratuitement à disposition de tous les participants au réseau Linux ». Cette riche initiative a d’ailleurs attiré de nombreuses autres entreprises mondiales tels les géants Google, IBM et bien d’autres encore.
L’ère post Carbone est bel et bien derrière nous. Nous allons produire tout ce dont nous aurons besoin à la maison ! L’imprimante 3D arrive à grands pas. Elle nous permettra de créer chez nous, tous les objets dont nous avons besoin au lieu d’aller les acheter. Non, ce n’est absolument pas de la science fiction mais la réalité de demain.
En tout cas, un livre passionnant, foisonnant d’idées dont il est difficile de rendre compte !
* Etude menée par le Johns Hopkins Center for civil Society Studies.
La troisième révolution industrielle.
Jeremy Rifkin.
Les liens qui libèrent / 413 pages. 280 DH
Par : Amira-Géhanne Khalfallah
Nahda 2.0
Auteur : Yves Gonzalez-Quijano
En octobre 2012, Yves Gonzalez-Quijano s’interrogeait sur la portée de l’arabisation du Web et, au-delà des révolutions, sur le projet collectif des Arabes.
Non, le monde arabe n’était pas « un désert numérique ». Non, le Printemps arabe n’est pas le produit d’une génération spontanée. Traducteur, professeur de littérature arabe contemporaine et spécialiste du champ intellectuel en Egypte, Yves Gonzalez-Quijano rappelle combien les nouvelles technologies de l’information ont enthousiasmé cette jeunesse frustrée par « la médiocrité du destin qui l’attendait » et leur ont permis d’élaborer de nouvelles cultures et identités numériques. Il retrace l’historique du Web arabe depuis vingt ans, l’histoire d’une progression fulgurante, aboutissant à de nombreux prix, dont le Nobel de la Paix pour la journaliste yéménite Tawakkol Karman : la langue arabe est désormais à la 7e place mondiale, devant le français, après une explosion de son nombre d’usagers (2 500 % entre 2000 et 2011) ; croissance record sur les réseaux sociaux, avec 175 % par an sur Facebook (le double de la moyenne mondiale) et 200 % pour sa version arabisée (contre 45 % pour la version anglaise), créant une population de 15 millions d’« amis », soit un million de plus que le nombre total d’exemplaires vendus par l’ensemble des quotidiens arabes toutes langues confondues. Au Maroc, où la hausse est de 300 % sur les 3 dernières années, avec une personne inscrite sur dix, dont 40 % de femmes et 80 % de moins de 30 ans, Internet est la première distraction préférée de 95 % pour la jeunesse urbaine. Aujourd’hui, le Web 2.0 « n’est plus [l’expérience] d’une minorité privilégiée, à savoir les milieux occidentalisés les plus favorisés des grandes villes modernes, mais bien celle de la majorité ». Au point de devenir une cible très courtisée par les grandes sociétés du Web : l’arabisation des interfaces et des programmes, de plus en plus rapide, n’est plus le fait des seuls développeurs arabes. A l’enjeu économique s’ajoute l’enjeu politique : Facebook a veillé, en mars 2009, à lancer la version arabisée en même temps que la version hébraïsée, « pour ne pas être accusé de favoriser l’une ou l’autre langue ». Enfin, l’auteur relate le passage du monde arabe à la « cyberpolitique », avec l’appropriation du champ politique par les activistes du Web et l’évolution de la répression, passant de l’emprisonnement à la cyber-riposte, comme la tentative de piratage des comptes des Fassabika (Facebookers) tunisiens par les services de Ben Ali à la veille de sa chute – que l’avenir de la révolution du Jasmin ait dépendu d’une entreprise privée (qui de surcroît aurait dû sa réouverture en Tunisie à l’intervention personnelle du même dictateur) fait froid dans le dos.
Dans ce petit livre dense, qui raconte autant qu’il décrypte, au point qu’on y perd parfois le fil directeur, Yves Gonzalez-Quijano analyse les raisons de la longue cécité quant à un phénomène aussi important, évoque « les risques d’une « lecture « orientaliste » des soulèvements arabes » mettant en avant ces jeunes qui « se servent de « nos » logiciels, reprennent nos images et les codes de ces modes qui sont aussi les nôtres […], qui nous ressemblent. Quitte à les inventer s’ils n’existent pas ». Il fait état des arguments des cyberoptimistes et des cyberpessimistes, les premiers arguant des microsolidarités rendues possibles, les seconds s’inquiétant de la dépendance à quelques entreprises américaines, des possibilités d’ingérence voire de déstabilisation, etc. Mais la partie la plus intéressante du livre est celle où l’auteur commente la portée socioculturelle de cette « Wiki-révolution ».
Des mondes arabes en conversation
Fort d’une longue réflexion sur le champ de l’édition et des médias, notamment sur l’émergence de la presse en ligne, Yves Gonzalez-Quijano estime que ce Printemps réenclenche le processus de la Nahda. « L’apparition de ce qu’on appelle aujourd’hui le « monde arabe » et qu’aucun atlas n’avait jamais décrit sous ce terme avant cette époque […] n’aurait jamais pu acquérir une telle présence dans l’imaginaire de la région et marquer à ce point l’histoire moderne si elle n’avait pas redoublé, dans l’espace spécifique du politique, une mutation plus large et plus puissante, de l’ordre des transformations sociétales ». Il rappelle l’importance décisive de l’imprimerie à la fin du XIXe siècle dans la modernisation des sociétés arabes et le développement d’une « manière inédite de se percevoir comme arabe, à la fois au niveau individuel et collectif ». Et de situer l’arabisation du Web et la numérisation du monde arabe en continuité symbolique de ces mutations historiques, même si leur portée n’a rien à voir : « Les acteurs de l’imprimé formaient une corporation de spécialistes peu étoffée, et leur public se limitait à un cercle restreint de lecteurs, alors que les flux numériques concernent de plus en plus aujourd’hui toutes les classes sociales, avec des mots de la langue de tous les jours qu’accompagnent le son et l’image ». Le Web est le dernier avatar permis par le développement socioéconomique, l’urbanisation et l’accès élargi à l’éducation, après l’essor d’une presse transnationale arabe dans les années 1980, des chaînes satellitaires dans les années 1990, puis des blogs et de la presse en ligne autour de l’an 2000, chaque support ayant généré ses formes d’écriture et modifié les rapports entre les membres de la communauté, pour aboutir à la mise en place d’une « société en conversation ». Cette « démocratie internet » est un « nouvel état d’esprit », avec sa culture. Englobant « tout le répertoire des pratiques symboliques, y compris ses formes légitimes traditionnelles » (poésie, littérature, etc.), celle-ci procède, comme au temps de la Nahda, par « revivification et emprunt (ihyâ’ et iqtibâs) ». La masse des usagers et « l’intelligence collective des réseaux » y imposent spontanément une parole vivante et opèrent une « révolution des signes » (les chiffres remplaçant les lettres inexistantes dans le clavier latin) qui n’est pas sans évoquer la Turquie kémaliste. D’où une remise en cause des parlers des classes dirigeantes, l’émergence des revendications d’autres langues, comme l’amazighe, et une interrogation sur les identités nationales. Au final, on parle moins de « monde musulman » ou de « Grand Moyen-Orient », et on dessine de nouveaux contours à un monde arabe qu’on veut plus ouvert, plus fluide, plus collaboratif et plus polyphonique, ouvert aux diasporas et ne s’arrêtant pas aux frontières nationales. En un mot, pluriel. De ce monde en puissance, il reste à en faire une réalité.
Par : Kenza Sefrioui
Arabités numériques, le printemps du Web arabe
Yves Gonzalez-Quijano
Actes Sud – Sindbad, 147 DH
Une cosmopolite en quête de liberté
Auteur : Esther Benbassa
Esther Benbassa, la Française, la Turque, l’Israélienne…livre son expérience de Cosmopolite, revient sur l’Histoire des Juifs, met en garde contre les dérives de l’extrémisme et du communautarisme.
C’est une leçon de vie et des leçons d’Histoire que nous exposent Esther Benbassa dans « Egarements d’une Cosmopolite » dans lequel elle revient sur l’histoire des Juifs d’Europe. L’universitaire française d'origine turque, spécialiste de l’histoire du peuple juif et de l'histoire comparée des minorités est également, sénatrice d’Europe Ecologie et directrice du Centre Alberto-Benveniste. Et c’est de ses expériences, humaines et professionnelles que se nourrit ce livre qui puise sa sève dans les combats d’une femme. Esther Benbassa porte un regard lucide sur la communauté israélite dont elle fait partie et évite de tomber dans les dérives de l’extrémisme tout autant que les clichés. Elle milite pour la reconnaissance de l’histoire sans la figer et l’instrumentaliser. Egarements d’une Cosmopolite est un ouvrage qui raconte et qui dénonce à la fois une histoire souvent tronquée. Dans le chapitre intitulé « La Shoah comme religion », Benbassa met en garde contre la transformation de la Shoah « en un culte sacré avec ses cérémonies, ses monuments, ses grandes dates, ses temples que sont les musées qui lui sont dédiés, sans oublier ses grands prêtres. »Elle écrit à ce propos « J’avais eu de surcroît l’imprudence de d’évoquer la question de l’unicité de la shoah, avançant qu’aucun génocide n’est unique puisque notre siècle en a connu un certain nombre avant celui-ci et aussi après ». Un livre courageux et des positions claires qui ont valu à l’auteure de vives critiques en France.
Cet ouvrage est autant le résultat d’un parcours politique que d’un vécu personnel. Deux lignes narratives s’y croisent. Deux récits, l’un intime et l’autre détaché, l’un au présent et l’autre au passé , tentent de donner une explication à ce que l’on appelle aujourd’hui l’antisémitisme et va au-delà d’une communauté pour parler du rejet de l’Autre et d’incompréhension. L’auteure porte un ensemble de réflexions forgées au fil des années. Ces textes, articles et autres interventions publiques (publiés entre 2000 et 2012) ont été rassemblés dans cet ouvrage et livrent une analyse de l’évolution des mœurs et des peurs entretenues dans nos sociétés d’aujourd’hui. « Le cosmopolite préfère regarder le monde que le subir, voler de ses propres ailes que se cloîtrer dans une idéologie, être en équilibre qu'avoir des racines. Sa liberté dérange parce qu'elle met en question, déstabilise et appelle à une révision constante de ce que l'on croit acquis ». C’est ce ton de liberté qu’a choisi l’auteure. La cosmopolite se refuse d’être dans le consensus et le non dit. « C’est en France que j’ai découvert qu’on n’avait pas, en tant que juive, le droit de critiquer Israël, mais le devoir de le soutenir en toute circonstance, y compris dans l’erreur », regrette l’auteur qui trouve en Israël un liberté d’expression qu’elle ne trouve pas en France. «Certains de mes amis intellectuels en Israël critiquent la politique du pays, soutiennent les Palestiniens, émettent des avis hautement subversifs dans les médias en prime time», raconte-elle.
Une histoire figée et un traumatisme entretenu
Israélienne, Française, Turque, la trinationale refuse qu’on la cantonne dans une communauté, une nationalité même si elle n’en renie aucune. Elle s’affranchit du carcan de l’identité, traverse la géographie et l’histoire, atterrit dans un monde laïc qui se nourrit du respect de la différence et prône une citoyenneté sans origines. Et même si dans la France d’aujourd’hui on se targue à prôner la laïcité, selon l’auteur, cette notion semble avoir perdu toute sa substance. La France n’en a retenu, au final, que les formes. « La France, en période de crise, construit son identité dans l’opposition à l’Autre qui lui fait peur. AU XIX ème siècle, ce fut le cas avec les juifs. Actuellement, face à la globalisation, c’est l’Autre arabe ou noir qui effraie. Et surtout sa religion, transformée depuis le 11 septembre en objet de tous nos fantasmes (…) Les Musulmans ont remplacé les Juifs du XIXème siècle et de l’entre deux guerres ».
La juive par héritage, la française par choix, la laïque par ses combats rêve d’une France où l’on regarderait les choses de plus près sans tomber dans le communautarisme. A son sens, cela devrait commencer très tôt, c’est-à-dire à l’école. « Il ne s’agirait nullement de catéchèse, mais d’un enseignement envisagé sous un angle culturel, allant de la littérature à la musique. Puisque les signes et les manifestations religieuses dérangent, pourquoi ne pas contribuer à une dédramatisation et à une relativisation en organisant un tel enseignement, lequel enrichirait et diversifierait le contenu des disciplines existantes, valoriserait les cultures d’origine des élèves et établirait des points de rencontre entre les civilisations ».
Esther Benbessa ne fait pas que rêver et formuler des vœux pieux. Elle fait de ses convictions un combat quotidien. Ses prises de paroles sont pour elle un devoir de mémoire. Mais elle sépare le dogme de l’histoire. Les différentes identités de l’auteur lui ont non seulement permis une ouverture sur le monde mais aussi appris à respecter chaque part de différence et chaque parcelle d’histoire. « Seul le dur et exigeant combat contre la pauvreté, la relégation, la discrimination aurait le pouvoir d’enrayer les extrémismes avec lesquels on nous fait peur. À l’inverse, donner libre cours à une islamophobie feutrée sous couvert de laïcité nous mène à un nouvel obscurantisme clivant, et compromet les chances d’un avenir partagé », conclut-elle.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Esther Benbassa
Egarements d’une Cosmopolite. François Bourin Editeur.
387 pages. 24 euros.
Pour repenser l’égalité
Auteur : Pierre Rosanvallon
L’égalité est, pour Pierre Rosanvallon, la clef de la mise en œuvre d’une démocratie intégrale, et il est urgent d’en reformuler une définition convenant au contexte actuel.
Le dernier ouvrage de Pierre Rosanvallon (2011) est un manifeste tout autant qu’une magistrale leçon d’histoire, d’économie et de philosophie politique. Ecarts croissants des revenus, concentration accrue des patrimoines, montée des nationalismes, des protectionnismes et de la xénophobie, tolérance implicite face aux inégalités, etc., la crise actuelle de l’égalité éveille chez l’historien, Professeur au Collège de France et fondateur de La République des idées, une inquiétude citoyenne : « La démocratie affirme sa vitalité comme régime au moment où elle dépérit comme forme de société. […] Le temps est venu du combat pour une démocratie intégrale, résultant de l’interpénétration des idéaux longtemps séparés du socialisme et de la démocratie ». Dans ce projet à la fois politique, sociétal et philosophique, la notion d’égalité est centrale, comme lors des Révolutions française et américaine à la fin du XVIIIe siècle. Pierre Rosanvallon propose de repenser nos « représentations du juste et de l’injuste » au fil d’un passionnant récit des évolutions de la notion d’égalité du XVIIIe siècle à nos jours.
Il retrace d’abord l’invention de l’égalité, avec le rejet des privilèges et des formes d’esclavage, fondant la démocratie comme une « société de semblables », égaux en liberté. Elle allait de pair avec l’économie de marché, devant détruire la société d’ordres, et avec la citoyenneté. Elle s’est donc rapportée « à une qualité du lien social beaucoup plus qu’à la définition d’une norme de distribution des richesses ». Au XIXe siècle, la révolution industrielle et l’avènement du capitalisme constituent une rupture considérable dans son histoire. Le mode de production bouleverse le monde de la production et de l’échange. La société est désormais « coupée en deux », entre travail et capital. Pierre Rosanvallon identifie quatre « tentatives de requalification de l’idéal égalitaire, pour en conjurer la dynamique ou en réinterpréter le sens ». L’idéologie libérale-conservatrice dilate à l’extrême la notion de responsabilité individuelle pour « réduire à l’état de peau de chagrin la dimension proprement sociale des inégalités » ;elle oppose la liberté à une égalité taxée de « partialité ». Le communisme utopique, critiquant l’individualisme et la concurrence atomisant la société, aboutit à une extinction du politique, de l’économique et du psychologique : pas de place pour la démocratie. Le national-protectionnisme lie égalité et identité, tandis que le racisme constituant pense l’égalité comme « une homogénéité excluante ». Ces « négations et redéfinitions perverses » de l’égalité ont pris fin au XXe siècle, « siècle de la redistribution », de la réduction spectaculaire des inégalités et de la généralisation en Europe du suffrage universel. Trois réformes ont été décisives : l’institution de l’impôt progressif sur le revenu, prônant la solidarité entre catégories sociales ; la mise en place d’un « Etat instituteur du social » corrigeant les inégalités et protégeant les gens contre les risques de l’existence ; la reconnaissance des syndicats et la régulation collective du travail. Avec l’Etat-providence, égalité rime avec solidarité. Dans cette rupture intellectuelle et politique, les deux guerres mondiales ont imposé l’idée d’une « dette sociale » et renforcé « le projet d’une égalité-redistribution inclusive en tant qu’élément central de l’esprit démocratique ».
Plus d’échanges entre les citoyens
Pourtant, dès les années 1980, les mutations du capitalisme, l’effondrement du communisme et l’estompement de la mémoire des épreuves collectives ont permis le retour du « marché-roi », des « pathologies de l’identité et du lien social », l’évidemment des institutions de solidarité et l’explosion des inégalités. « Au-delà d’une forme de répétition de l’histoire, c’est le cœur même de la fabrique des sociétés démocratiques qui est menacé dans des termes inédits ». Aujourd’hui, précise Pierre Rosanvallon, « c’est une page séculaire qui est en train de se tourner : celle d’une conception de la justice sociale fondée sur des mécanismes redistributifs » : les évolutions de la société vers « l’âge de l’individu » imposent de repenser le projet démocratique dans ce nouveau cadre conceptuel.
Il consacre la dernière partie du livre à formuler les grandes lignes d’une « ébauche » de ce que serait la « société des égaux » qu’il appelle de ses vœux. Sa réflexion s’appuie sur trois piliers. Il s’agit d’abord de bâtir une « société des singularités », qui ne soit basée ni sur un « universalisme abstrait » ni sur un « communautarisme identitaire » mais sur « une construction et une reconnaissance dynamiques des particularités ». Dans cette « démocratie de reconnaissance », les politiques sociales sont appréhendées comme des dispositifs de constitution du sujet – ce qui suppose de renforcer la notion de « droit procédural qui raisonne en termes d’équité de traitement ». D’autre part, il s’agit de prôner comme étalon des relations sociales la « réciprocité d’implication », « principe d’équilibre », sur le modèle de l’amitié. Ainsi, droits et devoirs ne sont plus seulement des normes abstraites mais acquièrent « une fonction d’institution du social », dont l’Etat est garant et ordonnateur. Cela permet aussi de dépasser le seul traitement ciblé de la pauvreté et d’envisager les échanges de façon plus large, pour répondre au « malaise des classes moyennes ». Enfin, grâce à la notion de « communalité », il s’agit de repenser la manière d’être des concitoyens, à l’heure du repli sur des appariements sélectifs, et de produire du commun, que ce soit par un vécu partagé, par l’accès à des informations et une culture commune ou par la fréquentation des espaces publics par tous.
C’est en fait une refonte globale de la pensée du collectif et de l’échange que propose Pierre Rosanvallon, suggérant, dans une langue fluide et accessible à tous, de retourner la question : plutôt que chercher à établir l’égalité, ne faudrait-il pas proposer « une inégalité d’équilibre comme idéal social, aucun individu ne se trouvant en situation irréversible ou psychologiquement destructrice de cumul d’inégalité » ? Tout simplement remarquable.
Kenza Sefrioui
La Société des égaux
Pierre Rosanvallon
Seuil, collection Les livres du nouveau monde, 432 p., 22,50 €
La ville poreuse
Auteur : Bernardo Secchi ET Paola Viganò
Dans cet ouvrage, présenté en quatre parties, les deux chercheurs ont pris au mot le philosophe ; ils ont fait de la porosité un outil d’analyse et de projet qui « traverse l’épaisseur de l’agglomération parisienne et qui interroge son futur ». La ville poreuse est une image qui construit des échanges entres différentes disciplines, acteurs et individu. Il s’agit en même temps d’un concept précis qui évoque la possibilité du mouvement et des flux ainsi que celui d’une image qui peut traverser plusieurs langages et paradigmes gardant une clarté suffisante pour alimenter d’autres images et d’autres concepts.
1. La métropole du 21 ème siècle.
L’ouvrage commence par une réflexion sur les principales caractéristiques de « la nouvelle question urbaine » et de la spécificité de la métropole parisienne par rapport à d’autres métropoles. Partant des similitudes qui subsistent entre différentes agglomérations, les auteurs atterrissent sur les particularités qui caractérisent l’évolution de chacune, et qui font la spécificité des solutions que devra apporter chaque métropole aux problèmes liés aux inégalités sociales, aux changements climatiques et aux problèmes de mobilités. Ils postulent ainsi que l’innovation et l’invention sur le terrain sont intrinsèques à la disposition de chaque métropole à réagir aux problèmes considérés prioritaires et à les mener de front.
2. La métropole des 21 ème siècles de l’après Kyoto : Scenarios.
La seconde partie de l’ouvrage est une illustration de quatre « scenarios » ou explorations dans un futur possible. Pour les auteurs, lorsqu’on agit dans « l’incertitude », la meilleurs stratégie de construction de l’avenir est de partir de l’élaboration de différents scenarios qui ouvrent une perspective, interrogeant le futur et évaluant les conséquences des politiques, actions et projets possibles.
Au préalable, le scenario 0 est constitué par les nombreux projets en cours et déjà engagés qui déterminent les trajectoires possibles et avec lesquelles toute idée doit cohabiter même si elle se révèle antagoniste
Les quatre autres scenarios étudient les possibilités d’atteindre dans la métropole Parisienne une situation 100% durable (scenario 1), les opportunités d’y vivre avec l’eau (scenario 2), d’y construire un système écologique fort à partir du dross[1] (scenario 3), d’y passer d’un système de transport en commun vertical et hiérarchisé à un système isotrope[2] et horizontal (scenario 4).
Ces scenarios permettent d’interpréter la métropole existante et d’imaginer celle à venir. Le Grand Paris comme une ville poreuse, perméable et isotrope, est une vision qui contraste fortement avec les processus en cour d’exclusion / inclusion et de formation d’enclaves ; elle permet d’atteindre les objectifs fixés par le protocole de Kyoto et les différents Grenelle de l’environnement[3] .
3. Un projet de ville poreuse.
Cette partie est une exploration concrète de ce que peut être une ville poreuse : une ville dense en lieux significatifs, qui donne de l’espace à l’eau et aux échanges biotiques, où la biodiversité se diffuse par percolation et les parcs rapprochent au lieu de séparer et qui se transforme par stratification en accueillant différentes idiorythmies. En d’autres termes, l’hypothèse avancée est que les principaux problèmes auxquels toutes les métropoles du 21ème siècle devront se confronter seront ceux des inégalités sociales, de l’énergie, de la gestion des eaux, de l’utilisation des zones résiduelles que chaque génération a laissé en héritage et, in fine, le besoin d’un nouveau système de mobilité qui puisse désenclaver le territoire.
Une nouvelle structure spatiale.
La dernière partie avance l’hypothèse que la ville poreuse ne peut être atteinte par la structure spatiale actuelle de la métropole, responsable en grande partie de ses maux. Cette hypothèse est confrontée à la réalité par l’étude d’une liaison écologique et métropolitaine entre Sceaux et la Seine, qui traverse les sites d’Orly Rungis et Seine Amont démontrant comment ces stratégies peuvent opérer dans le « réel ». Une approche radicale se dessine donc à la hauteur du « pari du Grand Paris », un défi que devra affronter toute grande métropole à l’avenir.
La substance de ce livre se veut faite d’hypothèses plutôt que de certitudes, hypothèses guidant à la formulation des politiques et des projets pour une métropole du 21ème siècle où il sera possible de « vivre ensemble » , elle soulève des problèmes liés à la gouvernance et aux contraintes que rencontre toute formulation de projet, où concertation et gouvernance deviennent souvent des négociations de contingents.
Certes, la question de la transposition de cette étude sur des cas particuliers se pose, mais face à une globalisation qui pénètre tous les recoins des sociétés et des territoires actuels, peut-on encore se cantonner à une défense jalouse voire injustifiée de nos spécificités ? En somme, pour des questions d’ordre social, économique, environnemental et spatial, sommes-nous si différents que cela ?
Par : Chennaoui Med Mehdi (Architecte-enseignant d’E.A.C)
[1] Dross : Espaces résiduels (carrières, sites d’usine, vieillissantes…)
[2] Isotrope : L'isotropie caractérise l’invariance des propriétés physiques d’un milieu en fonction de la direction. Le contraire de l’isotropie est l’anisotropie.
[3] Le Grenelle de l’environnement désigne le processus de concertation lancé en 2007 dont le but était de réunir divers représentants (membres du gouvernement, des associations professionnelles et des ONG d’orientations politiques diverses) pour définir ensemble une politique environnementale et de développement durable en France..
Les vraies raisons de l’embauche
Auteur : Jean-François Amadieu
Les pratiques de la fonction RH, son évolution, son utilité et ses dérives sont décortiquées dans ce livre aux traits très bien noirs!
Comment se décident les embauches ? De quoi dépendent réellement les salaires ? L’évaluation du personnel est-elle juste ? Pourquoi fait-on carrière ? Quelles sont les véritables raisons des réductions d’effectifs ?... C’est cette série de question qui ouvre le livre de Jean-François Amadieu, DRH, le livre noir. En y répondant, l’auteur spécialiste des relations sociales au travail, lève le voile sur des pratiques courantes discriminatoires qui passent souvent sous silence. « J’ai découvert une bizarrerie française, la question de la discrimination physique n’était pas prise au sérieux ». Pourtant, et même si cela paraît grossier et inadmissible, en Europe l’aspect vestimentaire ou physique est le premier critère de recrutement ! Mais au-delà de cette ségrégation à l’embauche « le sentiment de discrimination à cause de l’apparence ne se limite pas à l’embauche : les déroulements de carrière, l’évaluation, la détermination des salaires ou le licenciement n’obéissent pas non plus à une simple logique de compétences et de performances », poursuit le directeur de l’Observatoire des discriminations.
Alors que vous soyez noir ou blanc, gros ou mince, grand ou petit, vous n’aurez malheureusement pas les mêmes chances de trouver du travail à compétence égale. Le diktat du physique et l’éloge du jeunisme ont, d’ailleurs, donné lieu à de nouvelles pratiques : la chirurgie esthétique, le blanchiment de la peau, la lutte contre le vieillissement…et un nouveau business florissant. Quel est le prix de la beauté ? Se demande d’ailleurs et à juste titre le sociologue. La conclusion est que chaque patron l’évalue selon ses propres critères.
Ce livre n’est pas seulement un lourd plaidoyer des techniques d’embauche mais il agit comme une boite noire, révélant les dessous et le fonctionnement interne et inaccessible de l’embauche et de l’évolution des carrières. Parmi ses démonstrations : l’inefficacité des techniques de recrutement. Ce n’est qu’en 2000 avec l’arrivée du testing que l’on a pu démontrer le manque d’objectivité des techniques de tri des candidats. « Personne ne sait en France si les tests sont biaisés au détriment de certaines origines nationales ou en faveur de certaines catégories de la population », explique l’auteur.
Autre facteur important à l’embauche, le relationnel. Aux Etats-Unis, on considère que 15% des écarts de salaires sont dus au réseau d’amis ou de famille. « Etre un « protégé » comme disent les Anglo-Saxons, procure des bénéfices tel meilleur salaire, un succès de carrière et une plus grande satisfaction au travail. Cela va du plus petit employé jusqu’au top management. En France, par exemple, les salaires des patrons dépendent aussi du réseau dont ils disposent au niveau du conseil d’administration.
La littérature du management est aussi riche d’expressions telles : promotion canapé ou encore harcèlement sexuel. Dans un cas comme dans l’autre, ces pratiques passent sous silence et sont bien plus courantes que ce que l’on pense. Selon les sondages 60% des femmes affirment avoir été victimes d’avances répétées malgré leurs refus et 12% de ces avances sont suivies de chantage !
Le besoin d’un véritable code de déontologie se ressent aujourd’hui malgré tous les gardes-fous qu’on a essayé de mettre.
La religion, cet autre obstacle à l’embauche
Lorsqu’on s’appelle Khadidja mieux vaut de se présenter au Secours islamique qu’au Secours catholique, car c’est Marie qui aura le poste. Ceci est le résultat d’un testing établi en France sur envoi de CV. La discrimination à l’embauche basée sur la logique d’appartenance religieuse est une pratique très ancienne qui n’a pas disparue et qui n’est pas prête de disparaître.
Jean-Jacques Hénaff Patron des célèbres Pâtés Hénaff témoigne : « Je suis de religion catholique, j’ai eu une formation dans une école catholique, j’ai fait partie longtemps des entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) et mon père était au Centre français du patronat chrétien (CFPC)…on arrive à connaître des personnes, dans le milieu professionnel, que l’on sait partager les mêmes valeurs ».
Tout cela pour répondre à cette question que nous nous posons tous les jours : Sommes-nous recrutés pour les bonnes raisons ? Selon ce que nous avons à offrir en matière de compétences ?
Nous savons tous que le monde du travail est loin d’être juste. Il ne repose pas toujours sur les qualifications, en tout cas, pas seulement ou pas toujours.
Dans un tout autre chapitre intitulé ironiquement : " Les DRH font de la figuration, les financiers décident", Jean-François Amadieu arrive aux licenciements. Ce que dévoile une étude publiée par Les Annales des mines c’est la forte corrélation entre l’évolution du résultat et les réductions d’effectifs. « Les licenciements économiques ont lieu en certaines périodes de l’année : un pic est observable en juillet et un autre en janvier. Ces deux périodes correspondent en fait à la présentation des budgets en décembre et à leur révision en mi-année », conclut-il. Chaque décroissance induit une baisse des effectifs. Telle est la loi effective du marché du travail et non pas la compétence ou la productivité de l’employé.
Autre chose prévient Amadieu : les systèmes des évaluations demeurent flous. En 2011, ceux d’Airbus ont été jugés non conformes aux exigences légales. Ils semblent, en effet, très ambiguës. « Le problème que posait cette grille d’évaluation est que le salarié qui est parfaitement performant en atteignant ses objectifs peut être évalué comme non performant ». Et le cas d’Airbus n’est pas isolé. Les employés sont souvent évalués selon des systèmes opaques.
Au final, a-t-on le salaire ou le poste que l’on mérite ? Rien n’est moins sûr !
On devrait se regarder longtemps devant un miroir, à questionner notre tenue vestimentaire, notre âge, notre religion, la couleur de notre peau avant d’évaluer….nos compétences.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Le cas Facebook : Comment l’idée d’un étudiant d’Harvard a révolutionné le rapport au Web.
Auteur : Ekaterina Walter
C’est effectivement une réussite fulgurante. A 19 ans, le tenace Mark Zuckerberg, étudiant en informatique et en psychologie, voulait « créer un monde plus ouvert et plus interconnecté » et « transposer nos modes de communication « hors ligne » dans le monde des interactions en ligne alors en pleine explosion ». Ayant remarqué que ses camarades étaient très « attachés à leur statut social », il avait lancé un premier site, Facemash, qui lui avait attiré les foudres de l’Université pour usage inapproprié et illicite de données personnelles mais avait été un vif succès. Le 4 février 2004, il lance Facebook sur le campus, en garantissant le caractère volontaire des inscriptions et des partages. 6 000 utilisateurs en trois semaines. Un million huit mois après ouverture à d’autres universités. Douze millions en septembre 2006 lors de l’ouverture à tous. Deux cents millions trois ans plus tard. Plus d’un milliard, soit un septième de la population mondiale en septembre 2012. « Si Facebook était un pays, ce serait le troisième du monde, derrière la Chine et l’Inde », avec ses 75 langues, ses 751 millions d’utilisateurs par mois depuis des périphériques mobiles, son milliard de contenus partagés depuis une application Open Graph. Une minute du temps passé en ligne sur sept l’est sur Facebook. Pour son fondateur (désigné comme une des personnes les plus influentes du monde dans le Time de juillet 2008 avant d’y être élu en 2010 personnalité de l’année), c’est « le mécanisme de distribution le plus puissant jamais créé dans une génération ». Il « a créé une addiction douce aux connections 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aux flux d’informations » et a transformé en profondeur le rapport au Web. Celui-ci, de plus en plus développé « autour des personnes » et non du contenu, doit désormais être le lieu d’un « dialogue bilatéral et non un mode de diffusion à sens unique ». A la fois réseau social et canal de diffusion, Facebook sert même de système d’identification, et 48 % des utilisateurs se connectent par son biais à des sites tiers. D’où une valorisation grimpant en flèche. En recevant son premier gros investissement en 2005 (12,7 millions de dollars de la société de capital-risque Accel Partners), Facebook a été évalué à 98 millions de dollars (contre 75 pour Google au même stade). En mai 2012, Facebook a été la plus grande introduction boursière aux Etats-Unis, après General Motors et Visa, levant 16 milliards et étant valorisée à 104 milliards de dollars.
Livre promotionnel
Cette réussite arracherait presque des larmes d’émotion à Ekaterina Walter, responsable de l’innovation sociale chez Intel, experte en marketing et réseaux sociaux et collaboratrice du Huffington Post, qui s’émeut des hauts faits rendus possibles par Facebook : don de rein à une petite fille malade, retrouvailles de familles ou de couples, etc. Mais de là à affirmer qu’on tire une « méthode » de cette histoire… Ekarterina Walter, prétendant nous apprendre à « Penser comme Zuck », comme l’indique le titre de l’édition américaine, trouve normal que ses amis, « de vrais croyants », aient abandonné leurs études universitaires pour aider « Zuck » dans sa « mission ». Pas un mot sur les difficultés de l’introduction en bourse, qui ont fait perdre à Facebook 8,1 milliards de dollars. Et elle survend largement sa capacité à révéler les « secrets de fabrique » de Mark Zuckerberg. En fait de méthode, elle se limite à seriner cinq poncifs, où la rhétorique a la part belle. Les clefs de la réussite, selon elle, sont les 5 P : Passion, Propos, Personnes, Produits et Partenariats. Et d’enfoncer doctement des portes grandes ouvertes : « La passion alimente la persévérance – c’est l’un des principaux ingrédients du succès », ou encore « Passion + Action = Résultats ». En fait, le cas de Facebook est un prétexte à un cours de management plus ou moins réussi, car saturé de storytelling : Ekaterina Walter ne s’attarde pas sur le respect de la confidentialité des données, ni sur les tendances à l’hégémonie promues par l’interface de programmation Open Graph. Elle se contente de s’émerveiller de la façon dont ces algorithmes ont cessé d’être « cool » et sont devenus un élément de la vie ordinaire.
L’intérêt de ce livre ne tient pas à son apport théorique mais à la relecture détaillée des choix stratégiques faits par Mark Zuckerberg, comparés à d’autres exemples concrets tirés de Zappos, Threadless, XPLANE, TOMS’, et même Dyson, réussissant son aspirateur au 5127e essai… D’abord, le caractère permanent de la recherche et des innovations. Une équipe entière est dédiée à la croissance. On a du mal aujourd’hui à imaginer Facebook sans son Mur et ses groupes lancés en septembre 2004, sans l’identification sur les photos en 2005, sans le fil d’actualité (2006), sans le bouton J’aime (2010) et son Journal (2011)… D’un simple réseau social, Facebook est devenu une plateforme, créant un « ensemble d’opportunités économiques en autorisant des tierces parties à développer des extensions intéressantes par rapport à la manière dont les personnes et les entreprises interagissent en ligne ». Ce choix le consacre comme leader : « Une fois que vous avez construit un écosystème autour de votre service, il devient difficile de vous concurrencer » : grâce à l’API (Application Programming Interface), les sociétés partenaires génèrent ensemble en 2010, 835 millions de dollars, presque autant que Facebook lui-même. Ekaterina Walter rappelle que la réussite d’un projet tient moins à l’originalité de son contenu (les réseaux sociaux existaient déjà) que de sa mise en forme (un « graphe social » basé sur des identités cohérentes et connues des autres membres) et à la cohérence de son propos dans le temps. Et de citer son mentor : « Nous n’avons fait que 1 % du voyage ». Pour ancrer sa vision à long terme, Mark Zuckerberg, comme Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.com, a toujours fait en sorte de garder le contrôle sur sa société. Ekaterina Walter insiste aussi sur l’importance d’une culture d’entreprise donnant la possibilité aux « intrapreneurs » d’épanouir leur créativité : chez Facebook, c’est la « voie du Hacker », « discipline pragmatique et active » qui sert d’approche managériale et culturelle. L’auteure rappelle ensuite que, le succès étant « un sport d’équipe », cette culture doit être élaborée et vécue collectivement, d’où la nécessité de recruter les personnes qui ont l’attitude adéquate, car les compétences peuvent s’acquérir. Quelques développements sont consacrés à l’art du leadership, inspiré des qualités du colibri (sic), notamment pour son sens stratégique, ainsi que sur l’art des partenariats. L’auteure salue la complémentarité entre Mark Zuckerberg, incarnant l’imagination, et Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook, chargée de l’exécution. Autant de choix stratégiques intelligents, qui ont permis à Mark Zuckerberg d’être, à 29 ans, à la tête d’une fortune estimée par Forbes à 19 milliards de dollars.
Par : Kenza Sefrioui
La méthode Facebook : les 5 secrets de fabrique de Mark Zuckerberg
Ekaterina Walter, traduit en français pas Emmanuelle Burr
Editions First-Gründ, 240 p., 17 €
Si loin de la réalité
Auteur : Charles Saint-Prot, Frédéric Rouvillois
Pourquoi le Maroc est-il resté en marge des tourments des révolutions arabes ? C’est à cette question qu’a essayé de répondre une quinzaine d’universitaires, chercheurs en différentes disciplines, sous la houlette de Charles Saint-Prot et Frédéric Rouvillois. Pour parler de cette « exception marocaine », chacun y est allé de son argument, de sa théorie, cherchant souvent dans l’histoire, l’origine de cette stabilité. Les chercheurs nous renvoient jusqu’à la genèse du Royaume et les volontés réformatrices de Mohamed V et de son successeur feu Hassan II.
Mais parfois à force de s’éloigner dans le temps on en oubli le présent, la realpolitik d’aujourd’hui, la rue et ses revendications. C’est justement un des reproches qu’on pourrait faire à ce livre.
Selon les auteurs de cet ouvrage, ce qui semble différencier le Maroc des autres oligarchies arabes, c’est la monarchie alaouite, son histoire avec le peuple, sa stabilité économique, son statut avancé avec l’Europe, la position géopolitique du Maroc, son enracinement dans l’Afrique et le poids des confréries religieuses.
La religion, parlons-en ! Pour Charles Saint-Prot, « Les adeptes des confréries sont donc fort nombreux et leur influence est considérable dans la mesure où leur action constitue un facteur déterminant des grands équilibres du pays. Elles participent à l’encadrement spirituel, et parfois social». Toujours selon cette même étude, ce sont ces confréries, leur ancrage dans la société et leur message de paix qui continue de faire barrière à l’Islam politique au Maroc.
Au-delà de ce rempart religieux et de son rôle de modérateur dans la société, les chercheurs nous parlent de réformes profondes entamées au Maroc : séparation équilibrée des pouvoirs, de démocratie pluraliste et libérale, de démocratie citoyenne et participative …et oublient d’évoquer toutes les atteintes aux libertés. (Emprisonnement de rappeurs ou de bloggeurs pour ne citer que ceux là) et toute une frange marginalisée qui est bien loin de tout processus démocratique.
On tombe vite dans la caricature d’un pays idéal qui a su faire taire tous ses démons.
Frédéric Rouvillois, Professeur agrégé de droit public à l’Université Paris-Descartes et membre du Centre Maurice Hauriou, écrivain et politologue, explique quant à lui, dans une analyse- au départ pertinente -, que le consensus est plus une composante d’une monarchie que d’une république « Le consensus paraît plus aussi indispensable à une monarchie qu’à une république démocratique (…) dans une monarchie, le rapport entre pouvoir, consensus et légitimité est plus complexe, car la légitimité, du moins dans les monarchies modernes, n’est pas une légitimité à priori, dépendant de l’origine du pouvoir, mais une légitimité a postériori, liée, d’abord, à la capacité de réaliser le bien commun ». L’analyste fait, par contre, l’impasse sur les événements qui ont conduit au consensus et à la nouvelle constitution, minimisant jusqu’à réduire, les revendications de la rue et le rôle de la société civile. Quant aux réformes, on s’est contenté, dans ce livre, de les citer sans se soucier de leur application.
Théories et autres déceptions
Autre grande déception de ce livre, la contribution signée : Zeina El Tibi sous le titre généreusement ambitieux : L’évolution de la condition de la femme. La Présidente déléguée de l’Observatoire d’études géopolitiques, chercheur, essayiste et enseignante à l’Université ouverte de Catalogne, nous explique le saut extraordinaire du Maroc en matière d’égalités des droits. « La troisième étape a été le renforcement de la place des femmes en politique et dans les affaires publiques. Des progrès conséquents ont été effectués en matière de représentativité des femmes dans la sphère politique. Cette implication politique a été jugée indispensable pour donner corps à une égalité juridique … ». A moins que l’on vive sur une autre planète, il serait difficile de croire en ce vœu pieux !
Dans sa conclusion Zeina El Tibi n’hésite pas à parler de « l’amélioration constante du statut de la femme marocaine, tendant désormais vers l’égalité ». La chercheuse devrait peut être rentrer au Maroc pour vivre cette égalité au quotidien et voir à quel point les femmes sont présentes dans la vie politique du pays. La lecture de cette contribution rend perplexe. Un discours rompu à toute réalité à l’heure où une seule femme siège au gouvernement marocain.
Mais nous n’en sommes pas à un oubli près. La stabilité économique est aussi un des arguments qui étaye la théorie de l’exception marocaine. Selon l’économiste Henri-Louis Védie, la crise financière qui a démarré aux Etats Unis et qui s’est vite propagée dans toute l’Europe n’a pas pu traverser les frontières du Royaume. L’intégration limitée du système financier marocain dans le système financier global serait favorable à son économie. « La politique macro-économique du Maroc se caractérise bien par différents leviers, supports lui permettant d’être souvent à contre-courant de la situation nationale et internationale. C’est cela aussi l’exception marocaine. Et c’est ce qui fait de son économie une économie résiliente à la crise », conclut-il. En réalité, les investissements ainsi que le tourisme ont pris un sérieux coup de frein et les exportations ont baissé sensiblement à cause de la crise ! Dans son analyse, l’auteure fait également l’impasse sur les différentes fragilités économiques du pays : un Etat qui vit au-dessus de ses moyens, le taux de chômage qui se creuse, panne industrielle, une caisse de compensation épuisée, des finances publiques malmenées…
Au final, cet ouvrage qui coûte 190 DH censé nous éclairer et apporter des réponses à nos incompréhensions ne fait que les exacerber.
L’exception marocaine
Sous la direction de Charles Saint-Prot et Frédéric Rouvillois
282 p. 190 DH.
Par : Amira-Géhanne Khalfallah
Un prix Nobel au chevet de la crise
Auteur : Paul Krugman
Crise financière, économique. Parlons-en avec Paul Krugman, Prix Nobel d’économie. Mais parlons-en différemment. L’économiste nous en dresse le tableau et propose des solutions.
C’est une dissection de la crise économico-financière à laquelle nous convie, Paul Krugman dans son essai, Sortez-nous de cette crise maintenant ! L’autopsie d’un crime, où il explique les tenants et les aboutissants dans un langage simple et accessible.
La crise tout le monde en parle mais que sait-on finalement de ses mécanismes ? De son évolution ? En manipulant les mêmes chiffres auxquels on nous a habitués, Krugman explique que l’économie pourrait repartir dans le bon sens et nous propose une fine analyse de la situation ainsi que des solutions.
Mais tout d’abord, prenons le temps de nous poser les bonnes questions au lieu d’attendre des réponses toutes prêtes.
Pourquoi, à titre d’exemple, la récession se poursuit-elle en Europe tandis que que les Etats-Unis ont pu relancer leur économie ? L’auteur nous invite à nous interroger.
Pour comprendre ce qui s’est réellement passé, revenons au début de cette dépression économique qui a touché à la fois, l’Amérique et la zone euro.
Entre 2007 et 2010, ces deux puissances monétaires vivaient la même situation d’affaiblissement et notamment un taux de chômage assez élevé. Mais à partir de 2010, la situation aux Etats-Unis s’était sensiblement améliorée. L’Amérique s’est mise à créer des emplois tandis que l’Europe a continué à creuser son taux de chômage.
En 2012, le vieux continent est rentré officiellement en récession. Les taux de chômage en Grèce et en Espagne sont supérieurs à ceux que les Etats-Unis ont connus « au plus profond de la dépression », explique le prix Nobel d’économie.
La raison de cette flagrante différence revient à la doctrine austérienne qui a fait son chemin en Europe. Selon l’auteur, les mesures d’austérité n’ont réussi qu’une seule chose : détruire les emplois. Aux Etats-Unis, les partisans de l’austérité ont été freinés et c’est ce qui semble avoir sauvé leur économie même si elle n’est toujours pas au meilleur de sa forme. « On a fait de l’austérité sauvage la condition de l’accès à l’aide pour les pays en difficulté. Pour bien évaluer la chose, songez que si les Etats-Unis devaient appliquer des coupes budgétaires et des hausses d’impôts de l’ampleur de celles imposées à la Grèce, leur montant atteindrait environ 2,5 billions de dollars par an ». Un exemple qui donne une idée de l’ampleur du drame et de la difficulté pour ces pays de s’en sortir. La situation ne semble pas prête à changer malheureusement pour des pays comme la Grèce où la troïka : FMI, Banque centrale et Commission européennes continuent à conditionner les prêts d’urgence par les mesures d’austérité. Les déficits se creusent tout autant que la crise. Un cercle vicieux dont ces pays ont du mal à s’en sortir.
Mais la zone euro semble souffrir d’autres maux, qui sont plutôt d’ordre structurel : « L’Europe n’est pas un tout, c’est un assemblage de nations possédant chacune son propre budget (parce que l’intégration budgétaire est très faible) et son propre marché du travail (parce que la main-d’œuvre est peu mobile)- mais pas sa propre monnaie. Et c’est cela qui crée la crise », explique l’économiste qui n’hésite pas à étayer sa thèse en donnant en exemple l’éclatement de la bulle immobilière en Espagne et sa gestion dans la zone euro.
Alors, peut-on sauver l’Europe aujourd’hui ? L’auteur parle à la fois de « course au désastre » et de possibilités de changement. Jusqu’à maintenant, la zone euro demeure très menacée économiquement et profondément instable.
Pourtant, poursuit l’analyste, « La crise que nous vivons est totalement injustifiée », Il propose des solutions qui semblent évidentes et pourtant…
Le traitement
Une fois le diagnostic établi, l’auteur propose de soigner les blessures et les maladies dont souffrent les Etats en récession. L’économiste plaide pour une politique expansionniste, créatrice d’emploi. Et invite à discuter « du rôle de la politique monétaire, des implications de l’endettement des Etats ». Il questionne à ce propos le marché monétaire et nous rappelle que les coûts de l’emprunt sont très bas et que l’Amérique a eu bien raison d’emprunter. Il va encore plus loin en disant qu’elle « devrait emprunter davantage ».
Pour expliquer sa théorie, Krugman n’hésite pas à faire le comparatif avec la dépression de 1930. Il revient à la stratégie keynésienne et en fait un véritable cas d’école qu’il résume en : dépenser plus pour gagner plus. Une leçon de l’histoire qui nous apprend, entre autres, que remettre le secteur privé sur pied demeure un des préalables à cette remise en marche.
Revenons à l’euro. La monnaie unique semble être un des handicaps majeurs de l’Europe. Si l’auteur est un eurosceptique, il n’est pas non plus pessimiste. Selon lui, il n’est pas nécessaire de faire marche arrière et se débarrasser de la monnaie européenne pour s’en sortir, d’ailleurs cela risquerait de créer une autre crise de confiance. Il propose alors un plan de sauvetage pour l’euro. D’abord les Etats devraient trouver le moyen de garantir les liquidités nécessaires. (C’est ce qu’ont fait les Etats-Unis en empruntant dans leur propre monnaie).
Ensuite il faudrait que, « les pays excédentaires deviennent la source d’une forte demande pour les exportations des pays déficitaires », indique-t-il.
Au vu de l’état de l’Europe aujourd’hui, on voit bien que les politiques restrictives brutales n’apportent par leurs fruits.
L’Europe semble se tromper de chemin selon Krugman qui explique à titre d’exemple que le problème de la Grèce n’est pas dû à l’irresponsabilité budgétaire (comme on nous a toujours fait croire) et considère, à juste titre, que le remède ne devrait être une restriction budgétaire non plus.
Krugman termine sur une note d’espoir : Rien ne réussit mieux que la réussite.
Par : Amira Géhanne Khalfallah
Paul Krugman. Sortez-nous de cette crise…maintenant
Champ actuel. 283 pages. 88 DH.