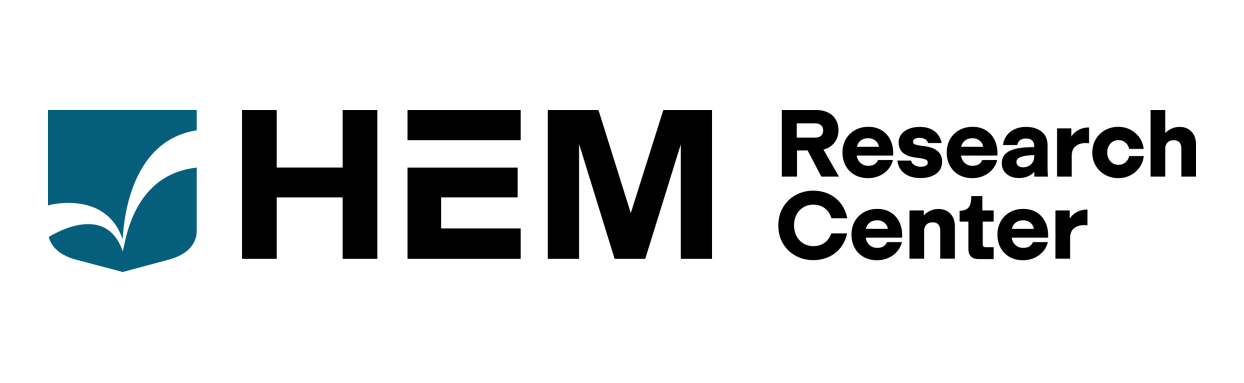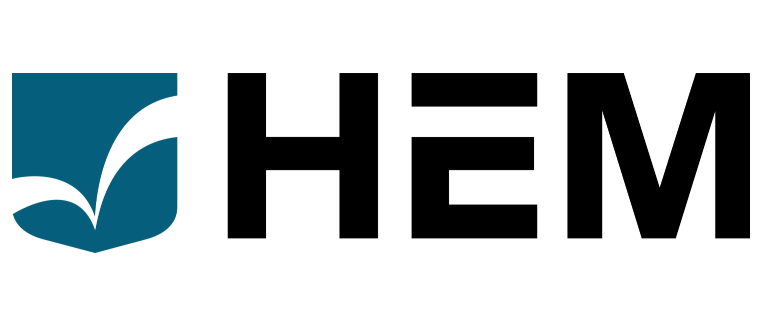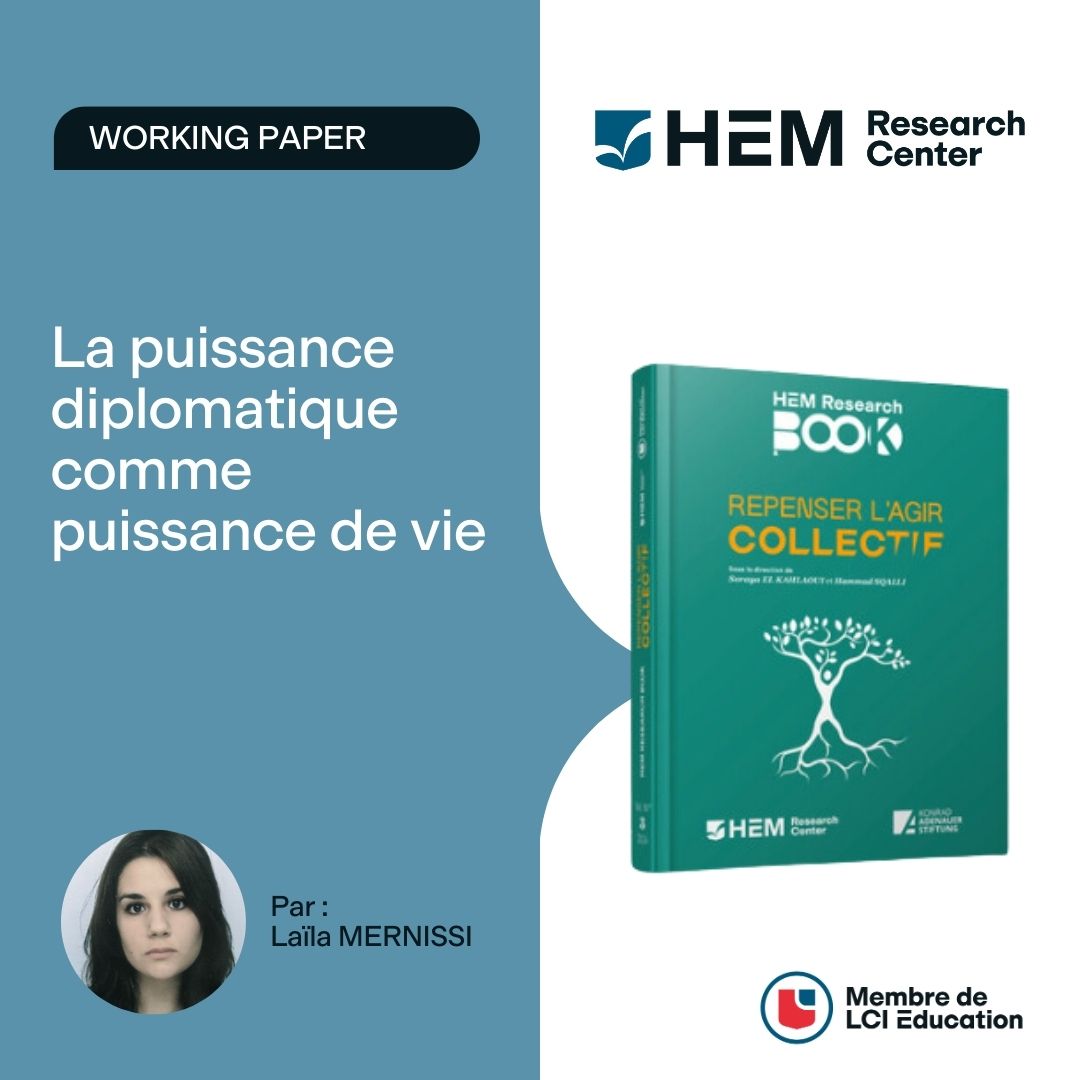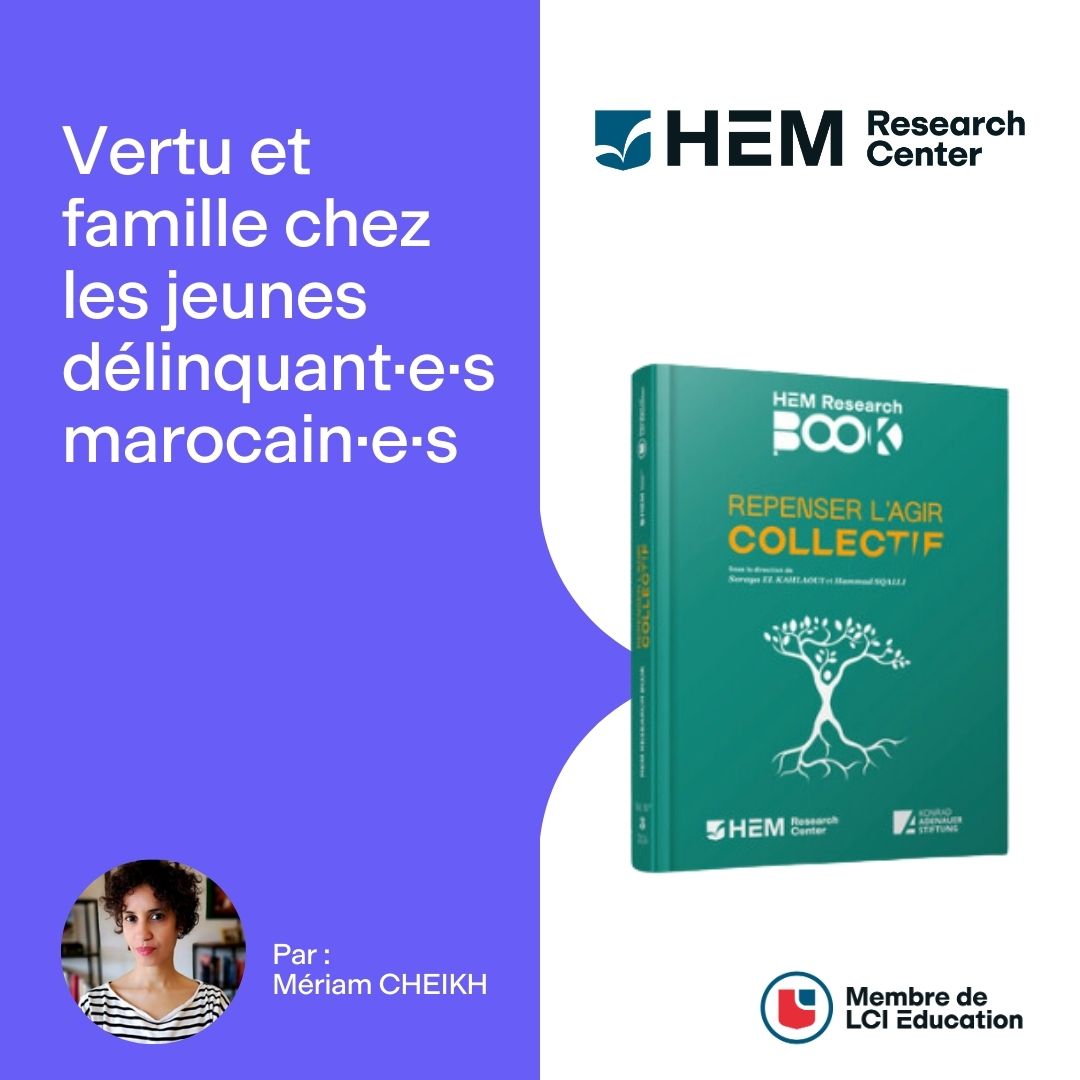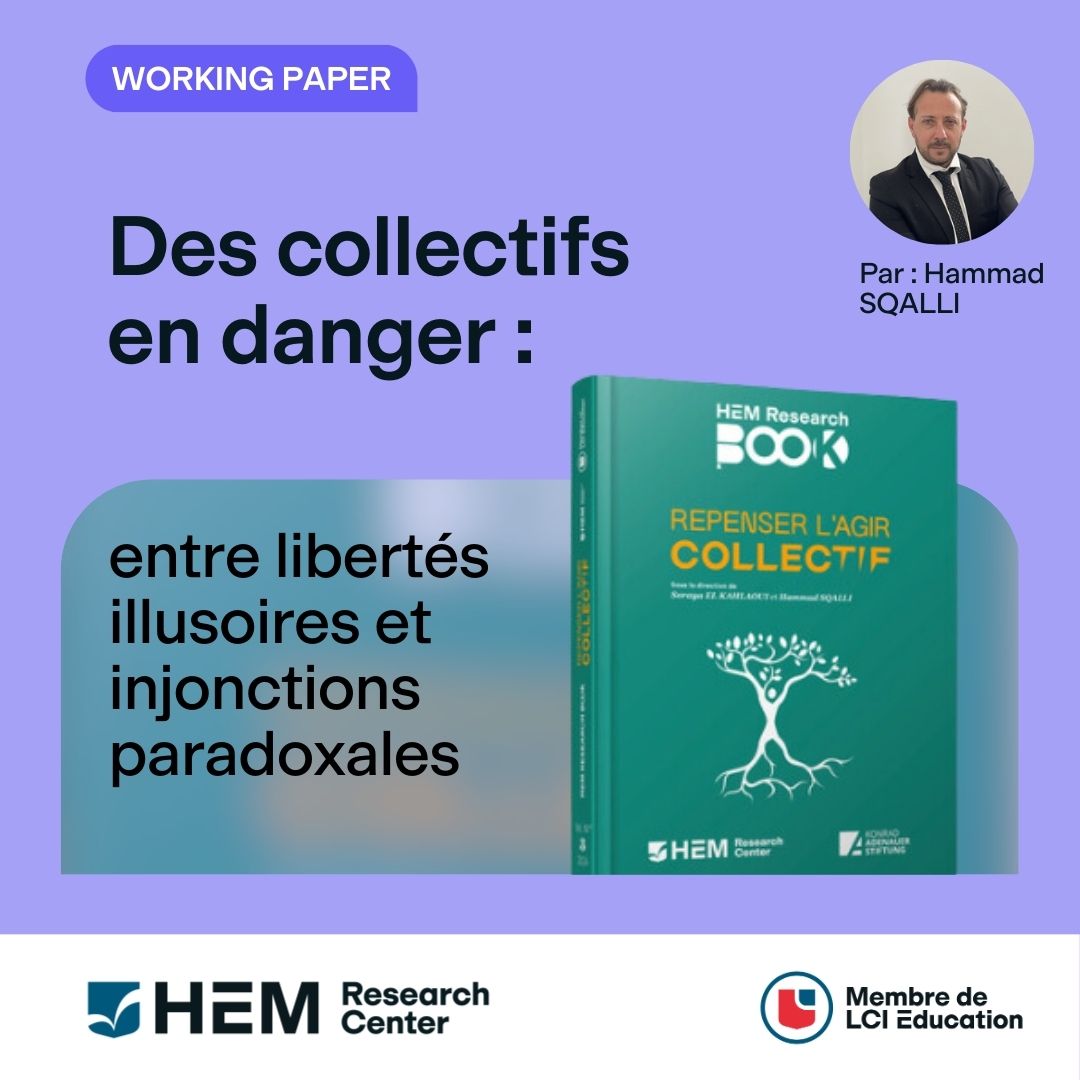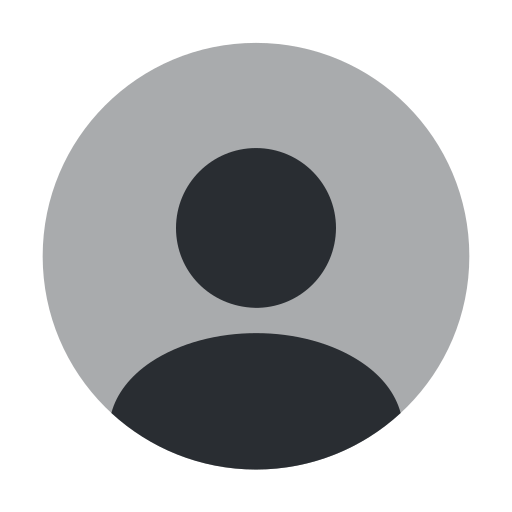
Abdelhalim BENBOUAJIL
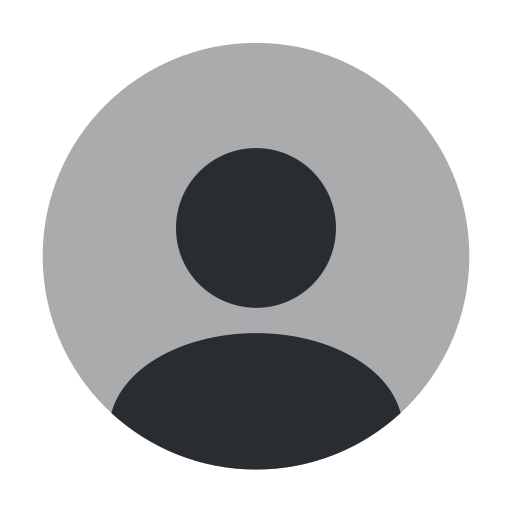
Abdelhalim BENBOUAJIL

Abderrahim BOURKIA
RAPPORT NARRATIF : Cycles de formation-action sur le management des secteurs culturels et créatifs
Ce rapport présente un compte-rendu de l'état d'avancement du projet Taqafiat, un programme de formation-action sur le management des secteurs culturels et créatifs au Maroc. Il s’agit d’une formation qualifiante répondant à des critères précis, sanctionnée par un certificat délivré par HEM-AUF. Le projet est né de la collaboration fructueuse entre l'Institut français du Maroc, la Fondation HEM et l'Agence Universitaire pour la francophonie (Afrique du Nord).

Laïla MERNISSI
Laïla MERNISSI est diplômée de Sciences-Po Paris, de l’ENS et de l’EHESS, docteure en philosophie (Université Toulouse II – Jean-Jaurès). Anciennement enseignante en philosophie à l’académie de Versailles, elle est spécialiste de philosophie française contemporaine, et principale...
Voir l'auteur ...La puissance diplomatique comme puissance de vie
Quelle pertinence et effectivité du concept de diplomatie dans la composition des collectifs de demain ? Se faire diplomate, c’est accepter que la relation tissée transforme l’agencement en question et nous transforme nous-mêmes, et ce, toujours en vue d’une vitalité augmentée.

Mériam Cheikh
Mériam Cheikh termine actuellement une thèse de doctorat en anthropologie à l'Université Libre de Bruxelles. Son travail porte sur les transactions intimes et sexuelles en milieu urbain au Maroc. Elle a mené une ethnographie auprès d'un groupe de jeunes filles à Tanger pratiquant l...
Voir l'auteur ...Vertu et famille chez les jeunes délinquant·e·s marocain·e·s
En partant d’une enquête sur les cultures juvéniles transgressives, cet article s’attachera à comprendre le collectif non pas au travers des institutions – manière classique de l’aborder – mais au travers de relations entre individus, liés entre eux par la filiation ou le mariage, saisies au coeur de leur intimité. Si la famille constitue bien une institution dans le sens où par elle sont régis des systèmes relationnels qui produisent des normes et des règles, il s’agira alors de s’attarder sur les modes de se relier les uns aux autres au sein de ce groupe.

Jamal Lamrani
Jamal LAMRANI est psychosociologue et chercheur, il a cofondé et codirige LMIntervention, cabinet de formation et d’intervention dans les organisations à Paris. Il est professeur affilié à l’ESCP-EAP, et intervient dans les grandes écoles (HEC, Centrale Supélec). Il est membre du CIRIFP...
Voir l'auteur ...Le collectif, espace imaginaire. Décoloniser l’imaginaire collectif
Inventer les collectifs du futur demande à accéder et à agir sur l’imaginaire collectif pour le dégager des aliénations et répétitions qui empêchent les collectifs de penser par eux-mêmes à leur futur désirable. Telle est l’hypothèse que pose l’auteur de cet article. L’approche du collectif est d’orientation psychosociologique. C’est une approche clinique qui vise à articuler les processus psychiques et les processus sociaux.
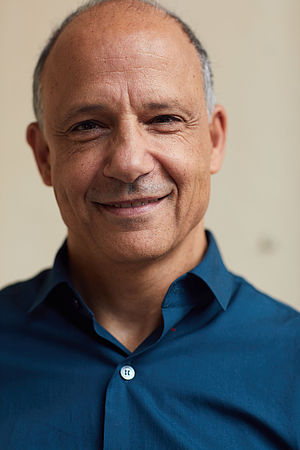
Jamal Lamrani
Des collectifs en danger : entre libertés illusoires et injonctions paradoxales
La réflexion proposée dans cet article relative au fait collectif dans des contextes professionnels d’entreprise est traversée par des analyses épistémologiques, théoriques et historiques qui soulèvent plusieurs questions, mais aussi des hypothèses et des pistes de recherche.