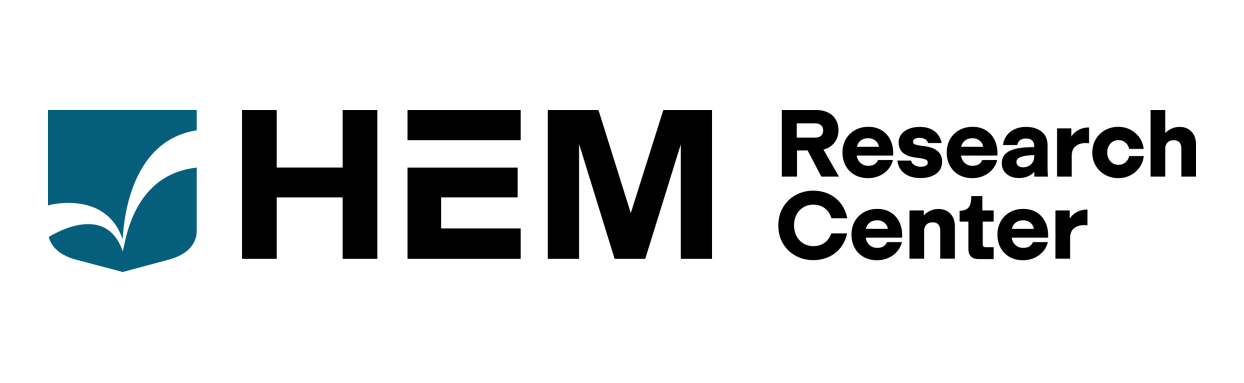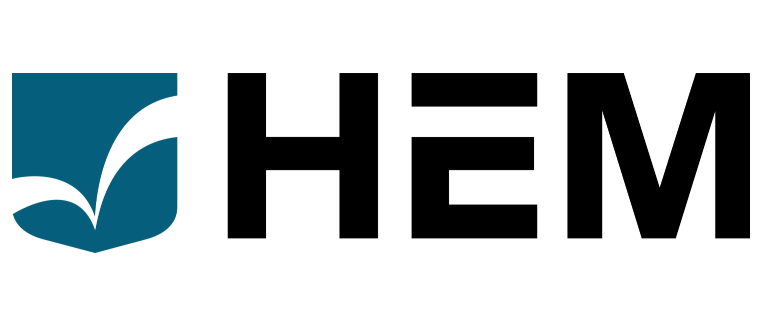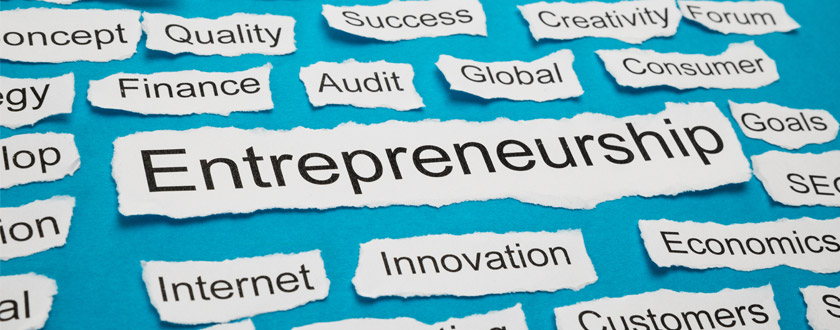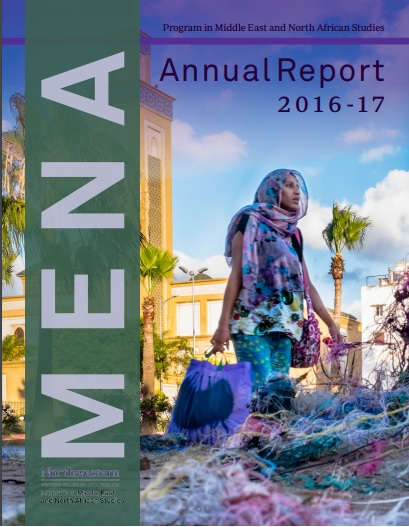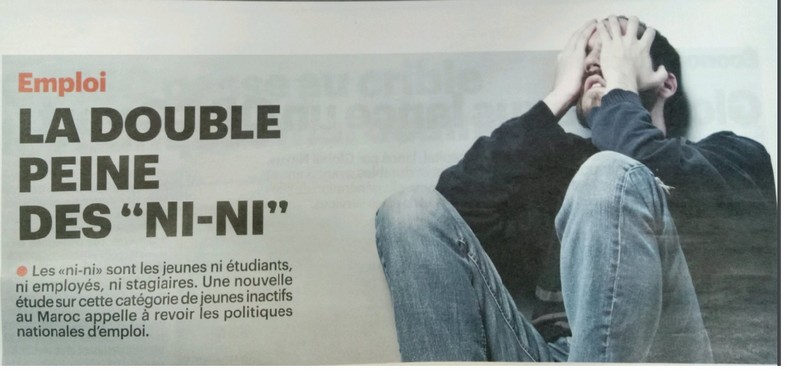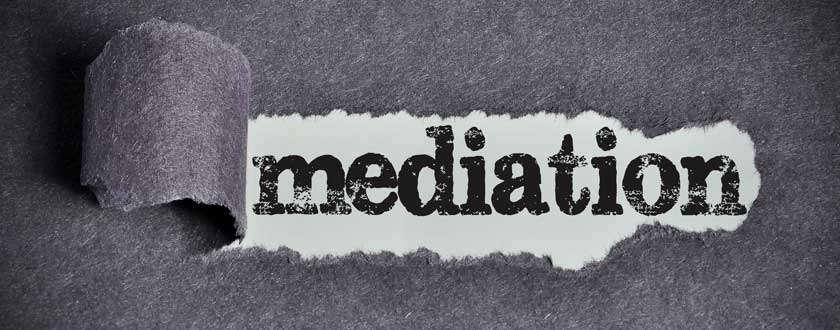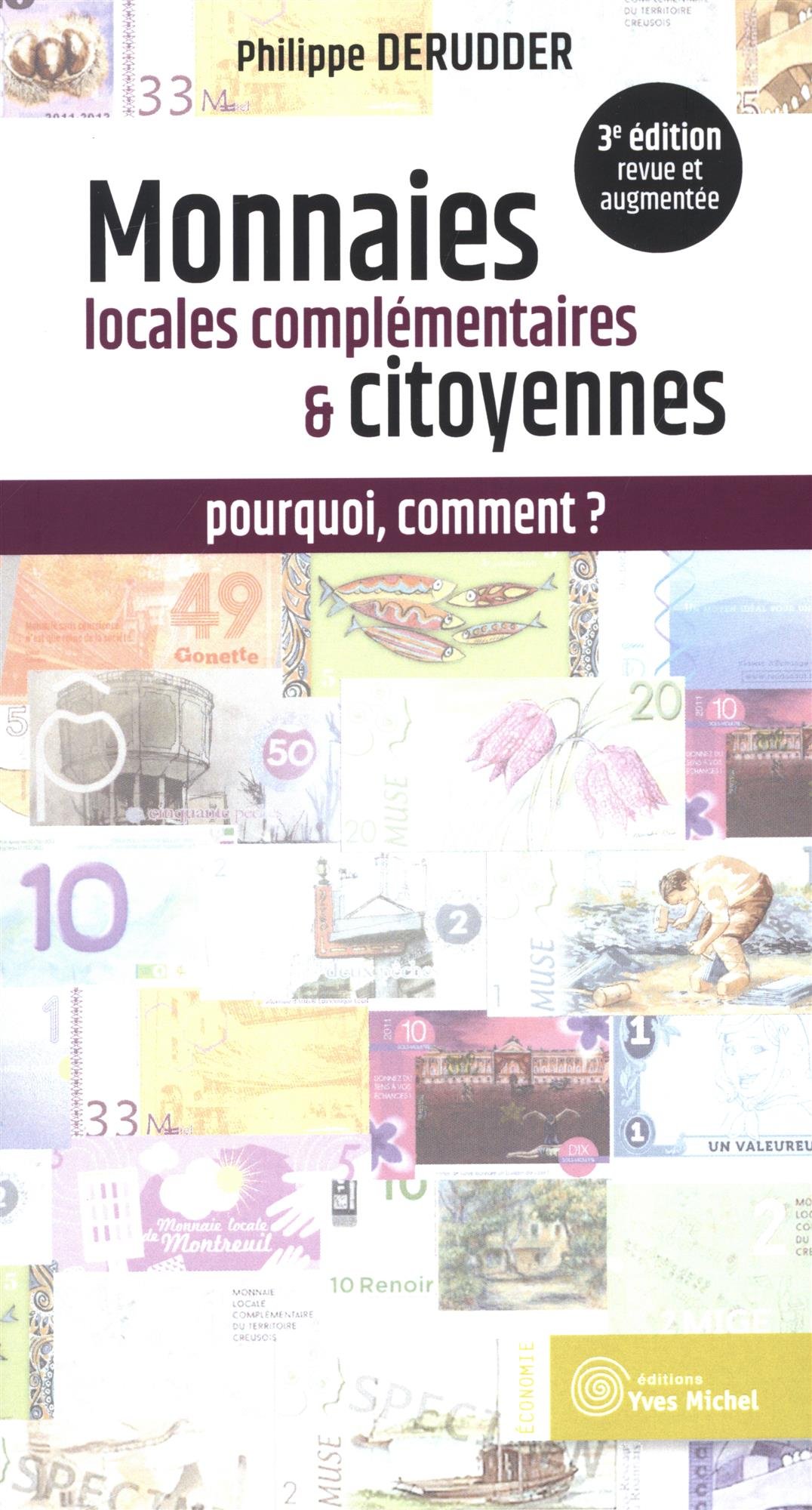Les institutions monétaires et financières internationales issues des accords de Bretton woods (FMI , Banque mondiale, OMC) ne sont plus à l’abri des critiques de l’intérieur du système onusien .Une résolution de l’assemblée générale adoptée le 19 décembre 2016 a sollicité un rapport examinant le rôle de ces institutions dans la promotion d’un ordre international démocratique et équitable et ce ,dans le cadre de la rubrique consacrée à la promotion et la protection des Droits de l’Homme.[i]
L’expert indépendant Alfred-Maurice de Zayas [ii] a présenté ce rapport à la soixante douzième session de l’AG réunie en Septembre 2017 .[iii]Le résultat est un document sévère à l’encontre du FMI dont ci-dessous la synthèse :
Un diktat idéologique
Le rapport sur le FMI rapporte les effets des politiques financières et économiques appliquées par celui-ci. Il porte en particulier sur la « conditionnalité » des prêts de cette institution. Un véritable réquisitoire. Pour aborder la question, l’Expert indépendant estime que, dans l’exercice de ses fonctions, le FMI devrait s’assurer que ses pratiques de prêt, en particulier la « conditionnalité » n’entrent pas en conflit avec les normes établies en matière de droits de l’homme. Rappelant les travaux des éminents économistes mondiaux dont des « nobelisés » très critiques envers le FMI , Alfred-Maurice de Zayas écrit : « « Ce rapport ne prétend pas faire mieux que Naomi Klein dans son livre phare La stratégie du choc, ou surpasser les professeurs Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Paul Krugman, Dani Rodrik, William van Genugten, Graham Bird et Dane Rowlands », il entend surtout formuler des recommandations permettant l’alignement des institutions de Bretton Woods sur le régime international des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, lesquels constituent des obligations non seulement pour les États, mais également pour les organisations intergouvernementales et les entreprises transnationales.
L’expert indépendant accuse l’institution d’avoir un positionnement strictement « idéologique » , « Les prêts du FMI, consacrés… au remboursement des dettes ou à la stabilisation des devises s’accompagnent toujours des mêmes exigences : privatiser les biens publics (qui peuvent être vendus à des multinationales guettant l’opportunité de frapper et ce, à des prix bien inférieurs à ceux du marché) ; supprimer les filets de protection sociale ; réduire de manière drastique le champ des services gouvernementaux ; éliminer les réglementations ; et élargir l’ouverture des économies au capital multinational, même au prix de la destruction de l’industrie et de l’agriculture locales. » . Il relève le paradoxe faisant que sous la tutelle directe du FMI, quelques-uns des pays les plus pauvres ont sous-financé leurs systèmes de protection sociale alors que les débats mondiaux autour des objectifs de développement durable se centrent massivement sur la fourniture universelle des services clés…
Un usurier à dimension universelle !
D’un ton implacable, le rapport met en relief le caractère usurier du FMI en reproduisant les termes de la fiche technique du FMI sur la conditionnalité stipulant « Lorsqu’un pays emprunte auprès du FMI, ses autorités acceptent d’ajuster leurs politiques économiques pour surmonter les problèmes qui les ont conduites à solliciter l’aide financière de la communauté internationale. Les conditions de ces prêts permettent également de veiller à ce que le pays soit en mesure de rembourser le FMI ».Le rapport estime que dans la mesure où le FMI continue de mettre l’accent sur l’imposition de limites strictes aux dépenses gouvernementales, il se doit de définir clairement quel type de dépenses est nocif et quel type ne l’est pas. Notamment, les gouvernements ne devraient, en aucune circonstance, réduire les dépenses liées à la santé et à l’éducation, par contre le FMI ne met jamais en cause les dépenses militaires souvent importants et très couteux.
Le rapport remarque que « les capacités de surveillance du FMI sont inégalement appliquées selon le statut des économies des États membres. » .Il constate ainsi que « Selon le Bureau indépendant d’évaluation du FMI , cette institution a violé sa propre règle fondamentale en autorisant un sauvetage financier de la Grèce en 2010 sans être à même de garantir que le plan de renflouement permettrait de contrôler la dette du pays ou ouvrirait la voie vers le redressement. ».Il a rappelé aussi les constatations d’un autre expert indépendant onusien: « À la fin de sa visite en Grèce en décembre 2015, l’Expert indépendant onusien chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels » Juan Pablo Bohoslavsky, avait fait une déclaration soulignant son inquiétude sur le fait que près de 2,5 millions de personnes ne disposaient pas d’assurance-maladie à cause de la crise. Il a souligné que le droit au travail et à la sécurité sociale étaient compromis, que le chômage des jeunes stagnait à 47,9 %, et qu’une personne inscrite au chômage sur dix recevait les allocations de chômage. En parallèle, des millions ne bénéficiaient pas de régimes de protection sociale de base ».
Des Etats pliés à la volonté d’autres puissances
Le rapport considère que « Le FMI doit s’abstenir de prendre des mesures qui menaceraient la possibilité pour l’État emprunteur de se conformer à ses propres obligations nationales et internationales en matière de droits humains. » et souligne que c’est également ce que rappellent les Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme de l’ONU [iv].
Concernant la dette grecque, le rapport note qu’en février 2017, l’Union européenne et le FMI ont décidé d’imposer des « mesures d’austérité » supplémentaires à la Grèce, contraignant notamment ce pays à faire un nouveau remboursement de 7 milliards d’euros à ses créditeurs.
Concernant la Tunisie, le rapport relève que le FMI a suspendu les versements du prêt de 2,8 milliards échelonné sur quatre ans pour « contraindre le Gouvernement à procéder à des licenciements en masse dans le secteur public, ainsi qu’à vendre ses actifs et, potentiellement, à diminuer les pensions ». Parmi d’autres conditions, le FMI a exigé que la Tunisie vende ses parts dans trois banques publiques, en plus de l’abolition de 10,000 emplois dans le secteur public .Le rapport rappelle que même les participants au Sommet du Groupe des Vingt tenu à Hambourg en juillet 2017, avaient déploré les mesures d’austérité supplémentaires que le FMI a imposées à la Tunisie.
La santé, victime du FMI
Le rapport relève aussi les effets de la conditionnalité des prêts du FMI sur les dépenses de santé dans le monde ; outre l’affaiblissement des infrastructures du secteur public, il constate les risques qu’elle fait prendre au droit à la santé, notamment à travers les exemples d’Ebola , du Sida et d’autres maladies ainsi que sur la santé des enfants dans les pays pauvres.
Le rapport examine le rôle du FMI dans l’ordre International autour de plusieurs volets , le premier concerne la corruption et l’évasion et transparence fiscales .A ce propos , le FMI avait répondu a l’expert en soulignant que la limitation des effets néfastes de l’évitement fiscal et de l’évasion fiscale sur les pays en développement requiert un renforcement des capacités, que déploie l’assistance technique du FMI. L’Expert indépendant considère cet argument comme insuffisant et que le FMI pourrait se montrer plus proactif faisant de la transparence fiscale une condition et ce, en refusant d’octroyer des prêts aux pays qui abritent des paradis fiscaux.
Discrétion du FMI face à la corruption et à l’évasion fiscale
Le deuxième volet concerne le rôle du FMI dans la restructuration de la dette souveraine. A ce sujet, le rapport cite les propos de Anne Krueger en 2001, alors directrice générale adjointe du FMI, qui avait proposé une nouvelle approche de la restructuration de la dette souveraine. Elle remarquait que « dans le droit interne, les entreprises et les individus peuvent avoir recours à des codes de faillite qui les protègent de leurs créditeurs, alors que les États souverains ne jouissent pas de ce privilège. ».
Le rapport enregistre qu’en juin 2016, le département de recherche du FMI avait produit un document intitulé « Le néolibéralisme est-il surfait ? », remettant en question l’efficacité de l’actuelle idéologie directrice du FMI. Le document débute par la découverte sinistre suivante : « Au lieu d’apporter la croissance, certaines politiques néolibérales ont creusé les inégalités au détriment d’une expansion durable». L’examen de ces politiques en particulier aboutit à trois conclusions troublantes :
a) Les bienfaits en termes de gains de croissance semblent très difficiles à déterminer à l’échelle d’un large groupe de pays ;
b) Les coûts liés au creusement des inégalités sont importants. Ils témoignent de la nécessité d’arbitrer entre les effets sur la croissance et sur l’équité induits par certains aspects du programme néolibéral ;
c) Le creusement des inégalités influe à son tour sur le niveau et la durabilité de la croissance. Même si la croissance est l’unique ou le principal objectif du néolibéralisme, les partisans de ce programme doivent rester attentifs aux effets sur la répartition.
Afin d’élucider davantage l’application concrète des normes en matière de droits de l’homme aux institutions financières internationales, le rapport propose à ces dernières de demander un avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Selon l’expert indépendant, l’article VIII de l’accord du FMI et des Nations Unies autorise explicitement le FMI à exiger des avis consultatifs au sujet de toute question juridique soulevée dans les limites du champ de ses activités.
Le rapport formule une série de recommandations .Constatant que l’évasion fiscale systématique par les entreprises et les personnes les plus riches coûtent aux pays pauvres un montant estimé à 20 milliards de dollars par an. Le rapport propose au FMI d’assujettir ses prêts à un nouvel ensemble de conditions, incluant :
a) L’adoption d’une législation prévenant la corruption et les pots-de-vin, accompagnée de véritables mécanismes de suivi ;
b) L’assurance de l’emprunteur qu’aucune partie d’aucun prêt ne sera utilisée pour satisfaire les réclamations de fonds vautours ou de créanciers récalcitrants.
c) l’assistance des juridictions dans le développement des capacités pour combattre les flux financiers illicites ;
d) la contribution aux investissements publics dans l’éducation, l’économie des soins, l’eau et l’hygiène, ainsi que d’autres services publics de qualité ;
e) Le soutien des systèmes de pension durables, tel que promis dans le Programme d’action mondial d’avril 2017[v].
Par Bachir Znagui
[i] « 22. Prie l’Expert indépendant de lui présenter, à sa soixante-douzième session, un rapport d’étape sur l’application de la présente résolution et l’invite à poursuivre ses recherches concernant l’incidence des politiques financières et économiques appliquées par les organisations internationales et autres institutions, en particulier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, sur l’instauration d’un ordre international démocratique et équitable ». Source : https://undocs.org/fr/A/RES/71/190
[ii] Alfred-Maurice de Zayas, est depuis 2012 l'expert indépendant des Nations unies pour la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. De nationalité américaine ,Il est historien, avocat et écrivain.
[iii] Les Experts indépendants font partie de ce qui est désigné sous le nom des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Les procédures spéciales, l’organe le plus important d’experts indépendants du Système des droits de l’homme de l’ONU, est le terme général appliqué aux mécanismes d’enquête et de suivi indépendants du Conseil qui s’adressent aux situations spécifiques des pays ou aux questions thématiques partout dans le monde.
[iv] : « Les institutions financières internationales… sont tenues de respecter les droits de l’homme… Elles doivent à ce titre s’abstenir de formuler, d’adopter, de financer et de mettre en œuvre des politiques et programmes qui contreviennent directement ou indirectement à la jouissance des droits de l’homme ».
[v] Document de la direction générale du FMI