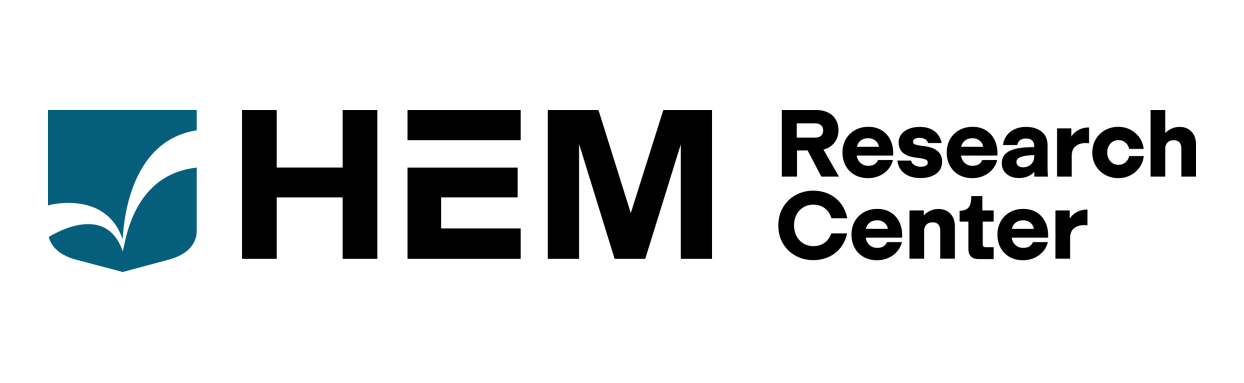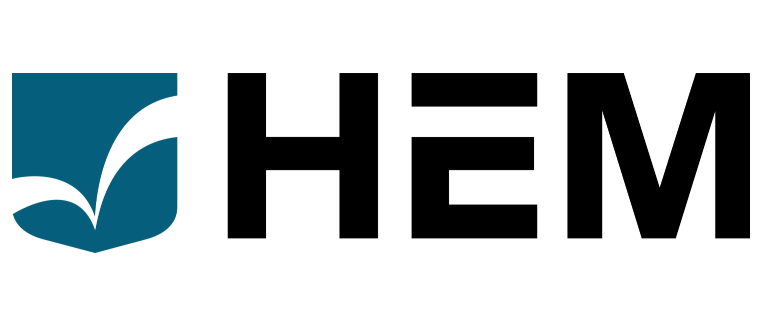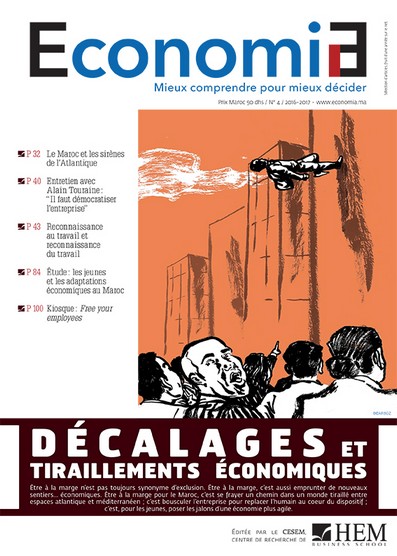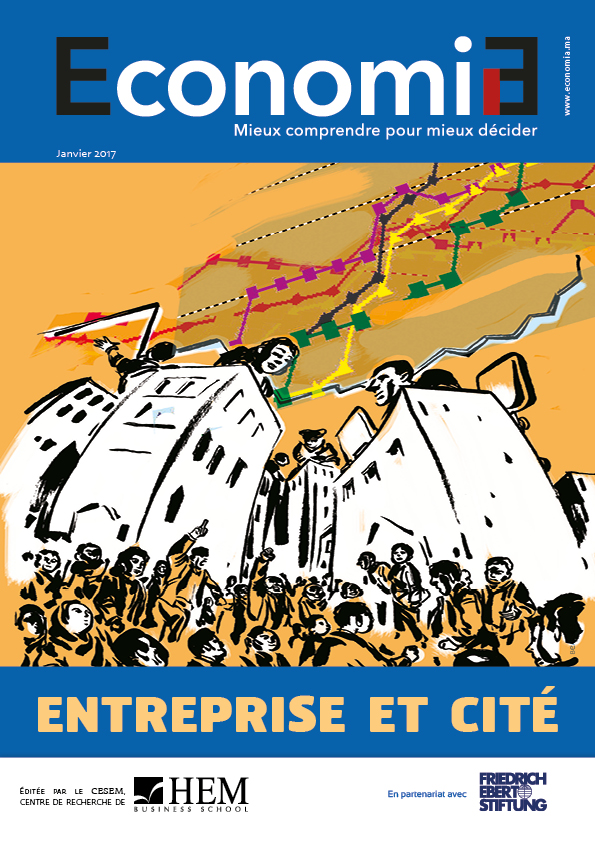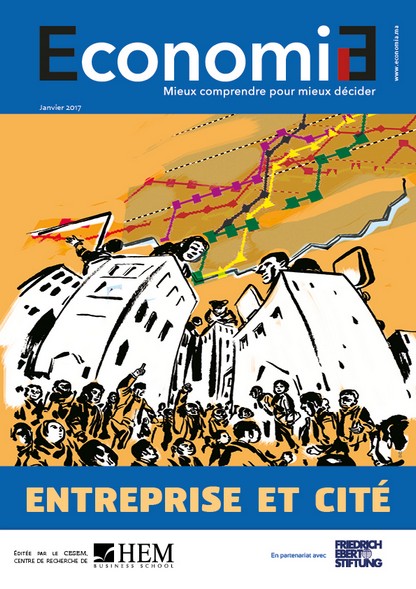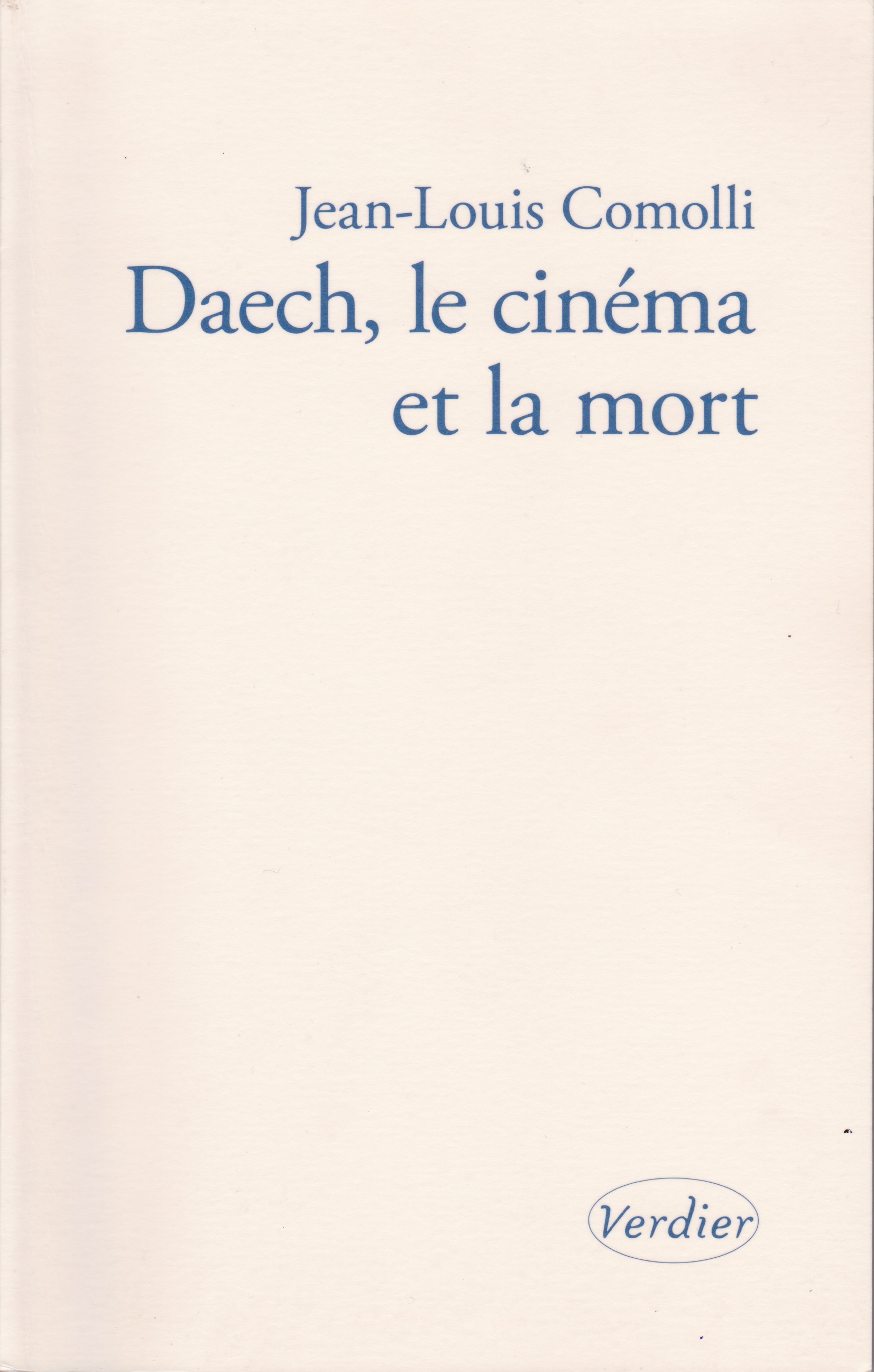Le gouvernement du social au Maroc est un ouvrage qui explique le système de gouvernement politique à l’œuvre dans notre pays. Celui-ci est « l’expression simultanée d’une hégémonie certaine mais aussi d’actions hétérogènes, plurielles, éclatées, fragmentées qui ne cessent d’entrer en conflits ». L’approche se présente comme une série de nouvelles compositions, d’inventions et d’arrangements en des moments précis, ce qui donne place à une pluralité d’interprétations, parfois même conflictuelles.
Le gouvernement du social au Maroc, édité chez Karthala en 2015, rend compte d’un travail réalisé sous la direction de Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS (Sciences Pô-CERI) et d’Irène Bono, maître de conférences à l’Université de Turin (Département Cultures, Politique, Société). Cet ouvrage ne manquera pas de stimuler la réflexion des chercheurs marocains en sciences sociales et politiques, et celle des différents acteurs sociaux et politiques du pays.
Fruit d’une recherche qui s’est étendue sur quatre ans (de 2012 à 2015), Le gouvernement du social au Maroc a été réalisé par un groupe très dynamique de sociologues, dans le cadre du CRESC (Rabat, Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, Université Mohamed VI Polytechnique). La démarche de ses auteurs entend se démarquer des lectures usuelles du « social » et de sa « question », lesquelles sont souvent fondées sur des délimitations rigides : société, État, politiques publiques… Ces identifications statiques et intemporelles aboutissent souvent à des conclusions aussi rituelles que stéréotypées. Les auteurs ont opté pour une approche qui reconnaît d’emblée les frontières imprécises du « social », tenant compte de la pluralité des acteurs et la diversité de ses dispositifs. Ils se sont orientés vers une lecture susceptible d’en remodeler plus efficacement les formes. Les auteurs se sont proposés d’explorer les administrations des espaces, des catégories, des temporalités, des imaginaires ou des conflits afin d’aborder leurs liens sociaux, leurs appartenances, leurs médiations, et pouvoir également reconnaître les aspects relatifs à l’ordre établi.
De la pluralité des formes du social
Dans une tradition wébérienne, l’ouvrage appréhende le « social » à travers ses relations et ses interactions quotidiennes, qui sont d’ailleurs sans cesse réinventées, sans préjuger des formes de la société. C’est donc la pluralité des formes du « social » et des façons par lesquelles elle peut être gouvernée qui est mise en valeur dans ce travail, pluralité qui fait écho non seulement à la trajectoire historique propre à chaque situation analysée, mais également à la diversité des référents structurant la conception de l’État et des rapports de pouvoir au sein de nombre de segments de la société.
Dans « le gouvernement du social », on ne peut penser celui-ci de façon isolée. Il faut l’articuler aux logiques politiques du vivre-ensemble, en prenant en compte aussi bien le cadre légal qui définit l’ordre politique ou économique que les ressorts idéologiques et culturels des stratégies de légitimation, les définitions de la sécurité ou de la stabilité, les conceptions de la citoyenneté ou du bien commun. Penser ainsi le gouvernement du social, c’est aussi redéfinir en permanence l’appartenance et les logiques d’inclusion et d’exclusion.
La construction des espaces sociaux est abordée par Yasmine Berriane à travers l’exemple des maisons de jeunes à Casablanca et leurs multiples figures de l’intermédiation. Cet examen l’a conduit au constat de « la pluralité des modes de délégations, de référentiels et d’acteurs formels et informels qui contribuent à articuler État et société ». « Gouverner par moments », volet examiné par Nadia Hachimi Alaoui traite des transports urbains à Casablanca, et interroge les modes de régulation de ce secteur en analysant les manières de faire des wali à propos de ce dossier ; elle conclut que les situations sociales devenues plus tendues contraignent l’État à intervenir « sans qu’il ait pour autant défini une stratégie et une politique « sociales ». L’article de Valentine Schehl, intitulé « Du blé au pain, que régule-t-on ? », montre comment la politique de compensation de la farine ne fonctionne pas en vase clos. Les circulations étant nombreuses entre « public » et « privé », la régulation du prix de la farine libre et du pain est dépendante de l’existence de la subvention, laquelle compense le prix d’une partie de la farine mais aussi de son détournement (celui-ci advient de diverses manières). Elle fait remarquer que la politique des prix au Maroc « n’est assumée et déployée ni par l’administration de façon directe, ni par des politiques publiques à proprement parler ».
Redouane Garfaouia choisit un angle impliquant le syndicalisme marocain. Il a examiné « le prix de la paix sociale au port de Casablanca », notamment à travers la longue histoire de l’intermédiation en emploi dans ce port (1916 à nos jours). À travers une hégémonie syndicale établie à la veille de l’indépendance du pays, l’auteur constate qu’aujourd’hui il n’y a plus de dockers intermittents, la transition de l’ancien régime de manutention vers le système actuel s’étant déroulée en douceur. Ainsi, « même à l’heure de la vérité des prix, le “social” reste le principal champ dans lequel se négocient les rapports ».
L’ouvrage focalise aussi sur le courtage de l’emploi domestique et la production de l’ordre social (Leila Bouasria), ainsi que sur la patrimonialisation d’une région marginalisée (le Rif) à travers la révélation des conflits classiques portant sur les rapports de la société locale à l’État central mais aussi sur les conflits latents concernant l’appartenance, la définition du groupe et les modes de gouvernement (Badiha Nahhass).
L’article de Ben Della, intitulé « Une catégorie juridique pour gouverner le social », a fait l’inventaire minutieux de la gestion des terres collectives à travers les régions et les politiques concrètes. Il démontre le rôle du dahir de 1919 – référence absolue dans le foncier –, qui a constitué un acte bien particulier, « celui de légiférer par omission ». Ses effets persistent encore aujourd’hui. Irene Capelli s’est consacrée à la question de l’aide aux mères célibataires, qualifiant la situation de « production bureaucratique et morale d’un impensable social ».
Les enjeux sociaux passent souvent par des médiations peu institutionnalisées
Le gouvernement du social a plus particulièrement mis en évidence l’importance des modalités indirectes du traitement du social, parfois difficilement perceptibles, et la multiplicité des façons de le gouverner. À partir de catégories (les « mères célibataires », les « pauvres », les « petites bonnes »), d’institutions sociales (les maisons de jeunes, la caisse de compensation), de secteurs économiques (le port ou les transports urbains à Casablanca) ou encore de territoires (le Rif ou les terres collectives dans les Hauts Plateaux de l’Oriental), ce livre montre que ces enjeux sociaux sont largement pris en compte en dehors des politiques publiques formalisées, et qu’elles passent le plus souvent par des intermédiaires et des médiations peu institutionnalisées, ce qui alimente compromis et équivoques, mais ouvre ce faisant l’horizon des possibilités et des bricolages en jouant sur la souplesse, l’adaptation et les arrangements.
Le gouvernement du social au Maroc apporte des réponses et des explications concernant le système de gouvernement politique à l’œuvre. Celui-ci est l’expression simultanée « d’une hégémonie certaine et d’actions hétérogènes, plurielles, éclatées, fragmentées qui ne cessent d’entrer en conflits ». Cette approche se présente comme une série de nouvelles compositions, d’inventions et d’arrangements en des moments précis, ce qui donne place à une pluralité d’interprétations parfois même conflictuelles.
S’inscrivant dans la continuité de deux titres précédents (parus dans la même collection : Recherches internationales), consacrés à la privatisation des États à l’âge néolibéral et à l’État d’injustice au Maghreb, ces recherches inédites ouvrent de nouvelles perspectives à la sociologie historique du politique, bien au-delà du seul cas du Maroc.
Par Bachir Znagui, journaliste-consultant, Cesem-HEM