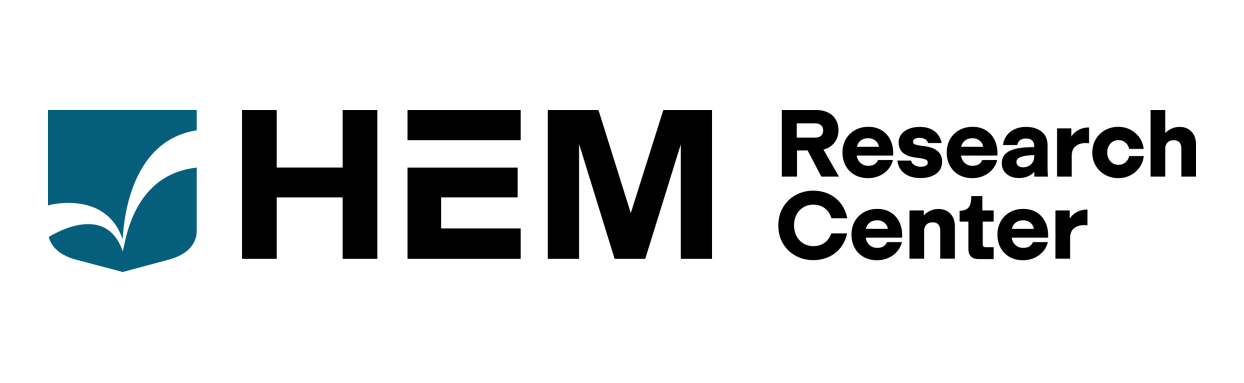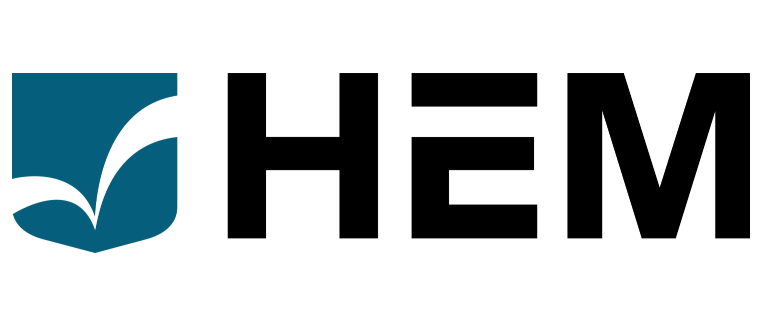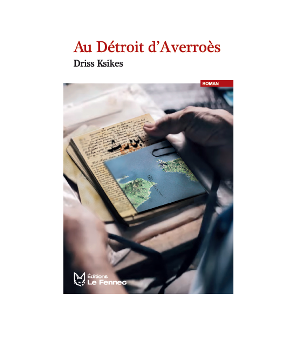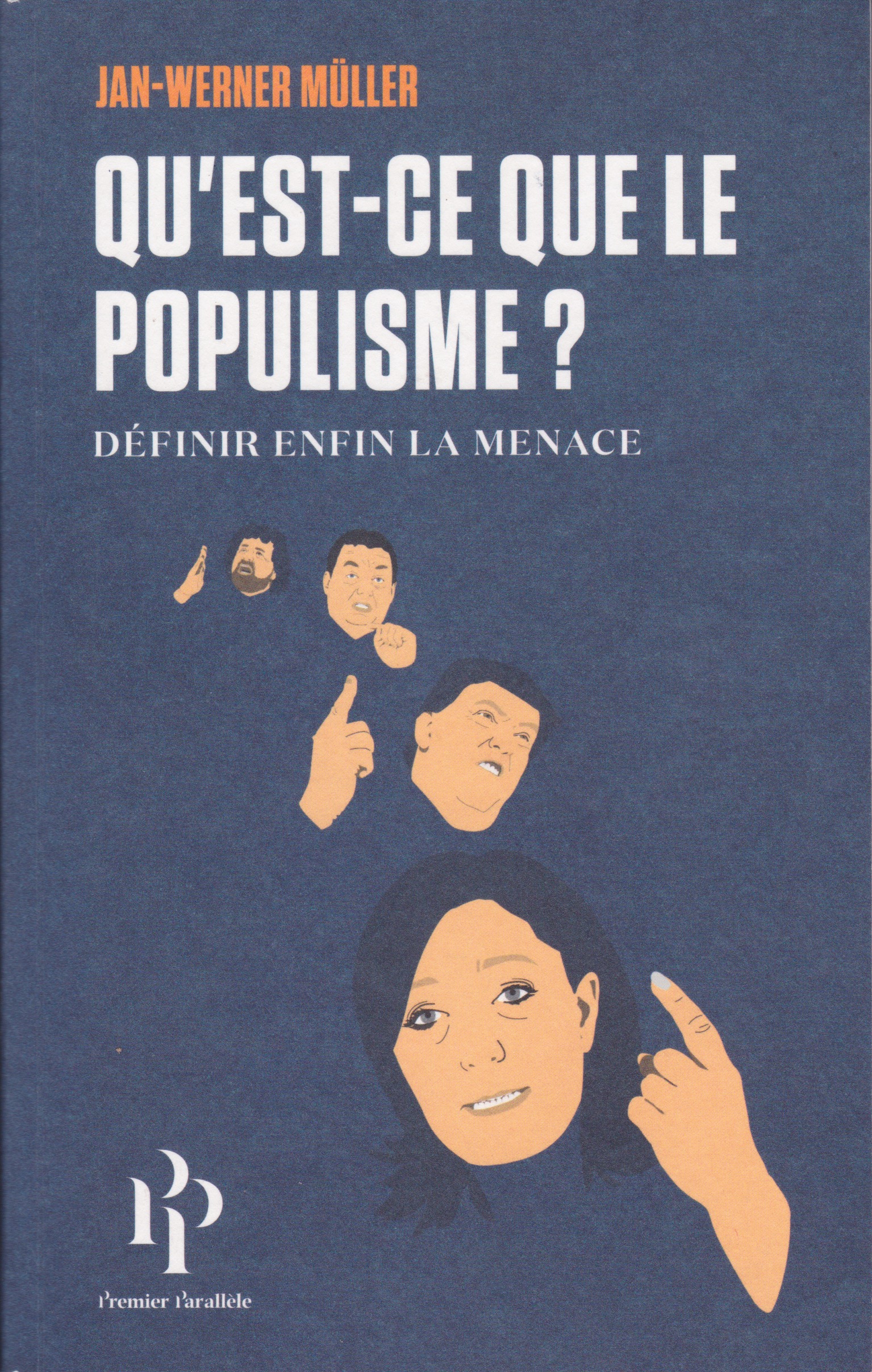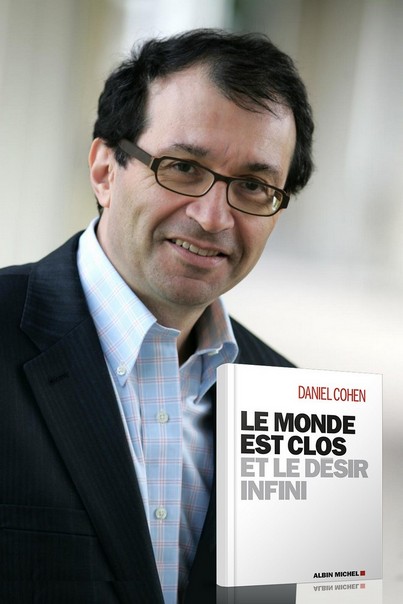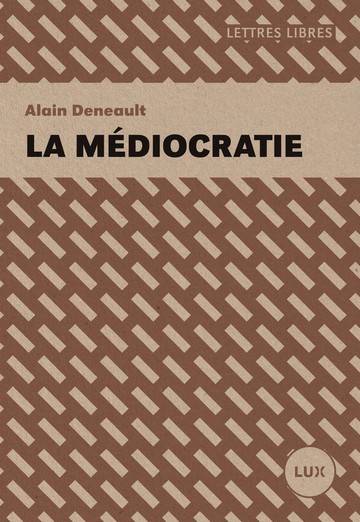Dans Le monde est clos et le désir infini, Daniel Cohen, économiste de formation et de métier, se fait volontiers philosophe, historien des idées… Et s’il se fait philosophe, c’est d’abord, comme généalogiste d’un Homme, celui de la Modernité.
Comment cette figure, certes des sciences, du discours, se fait-elle jour dans l’univers de la vie. Et, partant, du monde économique ? En se donnant corps et son âme, à une idée maitresse du projet dit moderne : celle de Progrès.
On pourrait, aujourd’hui, sans trop de peine, et non sans ironie, se payer le luxe de battre en brèche cette désormais vieille et, presqu’un peu honteuse notion, le Progrès ! Que signifie-t-elle, encore, dans le monde où nous vivons ?
Plus grand-chose, au fond, depuis que la philosophie qui l’a porta et fût portée par elle, se vit réduite au silence par les grands malheurs du vingtième siècle : colonisations, destructions de sociétés dites primitives, holocaustes, sanglots de l’Homme Moderne, retour des refoulés…
Oui, le Progrès, comme théologie, est mort, pour nous.
Mais, pour que la généalogie de Daniel Cohen soit possible, il convient de dire que c’est bien l’idée de Progrès qui aura permis à l’Occident de devenir la fabrique des désirs. De tous nos désirs d’individus sans lesquels, en vérité, les révolutions techniques, industrielles, n’auraient pas vu le jour. Sans lesquels, - nos désirs de sujets dits autonomes -, l’idée de Progrès n’auraient pas non plus conduit à celle, centrale dans le livre, de Croissance.
Oui, la Croissance, celle dont, habituellement nous parlent les économistes, les gens du chiffres, ne serait rien, au fond, sans la centralité, inventée, et donnée par la Modernité à l’Homme dont elle considère que le génie est de créer un monde qui soi le reflet de sa génialité largement désirante.
Ainsi la Croissance, comme finalité de toute économie qui se respecte, est-elle, d’abord, fille d’un Homme nouveau, né au XVIIIème siècle, s’accordant à lui-même la centralité en toute chose. Celui dont Descartes disait qu’il était « comme maître et possesseur de la nature ».
Toute la pertinence du Monde est clos et le désir infini consiste, en premier lieu, à rappeler cette dimension, presque démiurgique, au fond, de l’idée de croissance. Et, même si Daniel Cohen ne le dit pas exactement en ces termes, on ne peut, à la lecture, ne pas la voir, émerger en creux. La thèse d’un Homme Moderne, dont la puissance, certes réflexive et transformatrice mutant en une sorte de volonté de croissance est probablement essentielle, dans la thèse de Daniel Cohen.
Mais si la philosophie s’invite dans ce livre, pour le plaisir du lecteur soucieux de généalogie, il va de soi que le propos de l’auteur, est de rappeler que si la société industrielle a été l’apogée de la rencontre entre la volonté de croître et de faire croître, de l’Homme Moderne, la société dite numérique ne donne, pas en terme de progrès – techniques et économique – le droit de se féliciter des mêmes exploits que la parenthèse industrielle aura permis d’accomplir.
La puissance de manifestation de la croissance, comme volonté, pourrait bien même disparaître, à l’ère de l’économie dite numérique…
Exemple canonique ? L’industrie automobile, prise comme ce que l’on pourrait nommer un fait total… De progrès.
Oui, car l’automobile, si elle porte bien son nom, est bien l’illustration d’un progrès - pour l’Homme et son autonomie, magnifique victoire sur l’espace et le temps, anciens… Pour l’économie, c’est-à-dire la création de richesses, comme objet susceptibles de créer l’une des plus formidables chaîne de valeur jamais conçue.
Ainsi l’ère post-industrielle qui est la nôtre, produirait-elle, - force Smartphones, réseaux sociaux, le désir perpétué d’un quant-à-soi sans cesse renouvelé, ne capitalisant que les contacts, au fond, plutôt que de créer les maillons d’une chaîne de valeur, désormais rompue. Un monde clos, fait de désirs infinis. Dont la croissance pourrait bien n’être plus que narcissique. Lorsque l’économiste se fait philosophe, il renoue avec une tradition un peu perdue, qu’on a plaisir à retrouver.
Par : Driss Jaydane
Le monde est clos et le désir infini
Daniel Cohen
Albin Michel, 224 p., 17,90 €