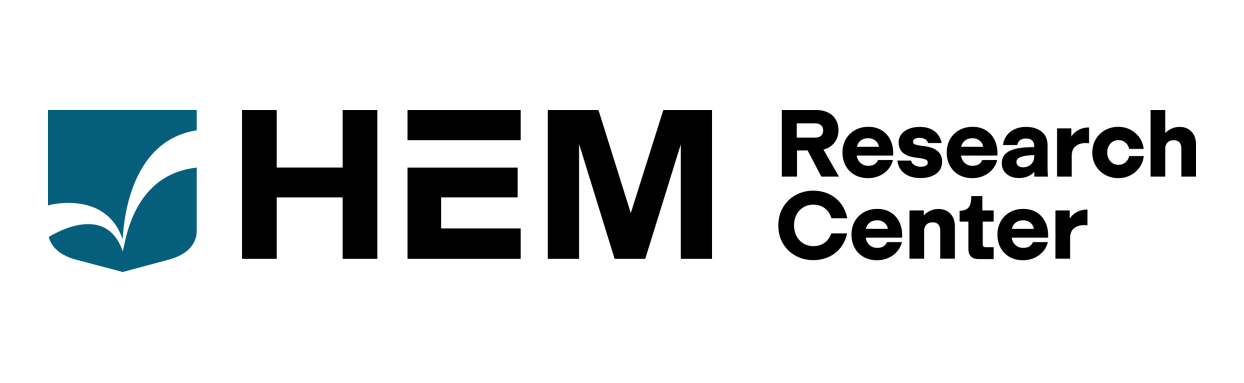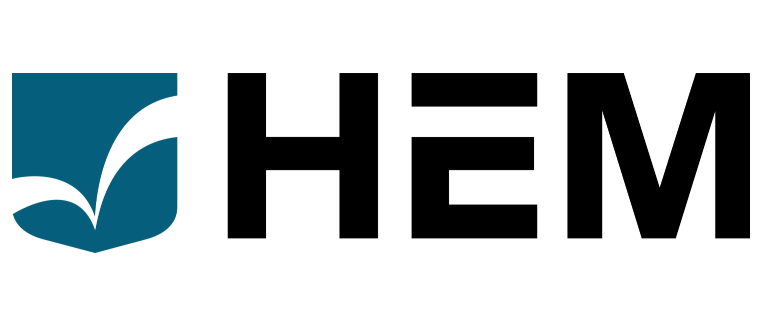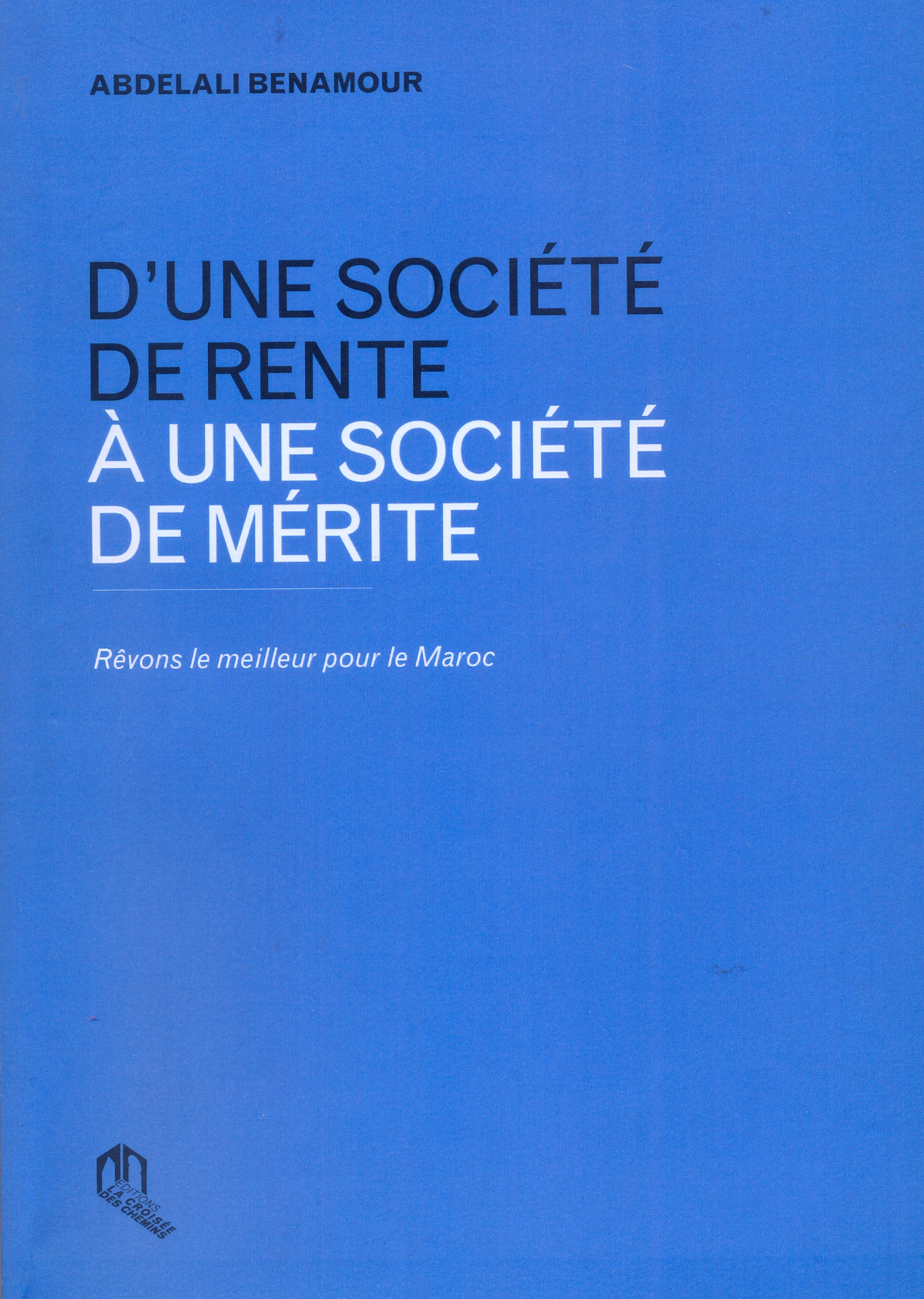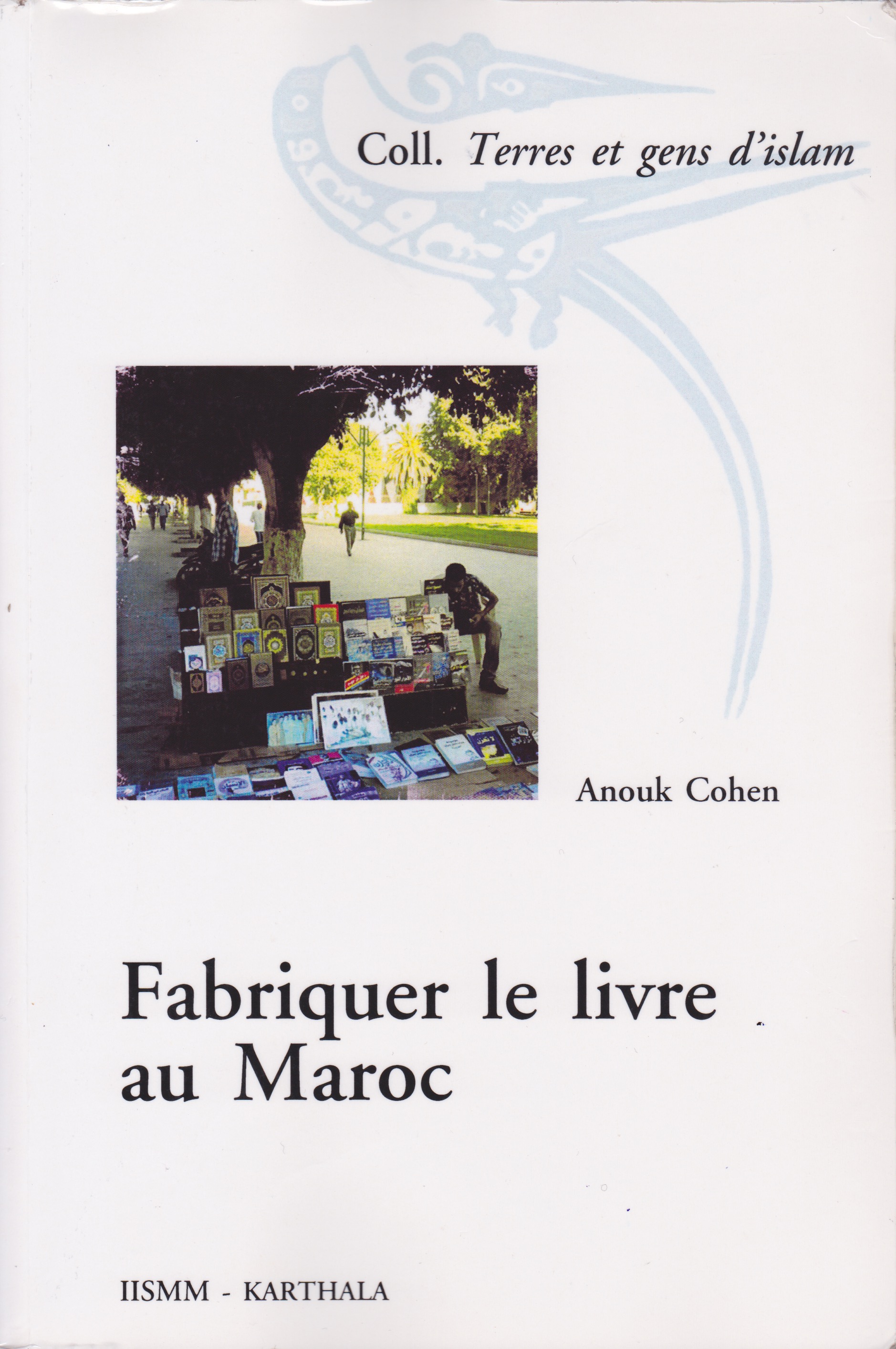Une invite au rêve, quoi de plus approprié pour commencer une nouvelle année sous de bons auspices ! Le livre d’Abdelali Benamour est sorti en 2016, quelques mois avant la fin de l’année. L’auteur est une personnalité publique bien connue, il assure actuellement la présidence du Conseil de la Concurrence, mais il a eu dans son itinéraire plusieurs parcours tout aussi intéressants ; enseignant chercheur, fondateur et PDG de l'Institut des Hautes Études de Management (HEM) en 1988, ancien député de l’USFP à Casablanca, il a également été Président de l'Association "Alternatives" (1995 – 2002). Ainsi le chercheur en économie, le pédagogue, et le militant sont inséparables dans son cheminement comme dans sa personnalité. Cet essai de 250 pages est une réflexion sur la situation socio-économique et politique du Maroc et ses perspectives d'émergence. Réparti en cinq chapitres, l’essai qualifie le Maroc de société rentière en lente transition, et pour mieux l’identifier, Benamour aborde les différentes grandes expressions de cette rente dans le contexte national les plaçant dans une perspective historique.
Le comportement rentier diffus marque profondément l’ensemble de la société marocaine, mais il caractérise aussi les organisations de représentation de celle-ci. La rente d’abord sociale se double d’une autre qualifiée de religieuse, laquelle est répartie d’abord entre instances religieuses traditionnelles et gouvernants, mais se retrouve aussi en troisième lieu dans la sphère dite idéologico-islamiste, se manifestant entre autres, dans le salafisme jihadiste, meurtrier et sanglant.
Benamour n’hésite pas à mettre à nu les paradoxes de cette catégorie de rentes ; il écrit à ce propos : « on met en évidence la morale dans les comportements sociaux, mais les relations socio-économiques perdent énormément en termes de confiance et la corruption prend des proportions exorbitantes ».
La troisième catégorie de rentes qui sévissent au Maroc est politique selon Benamour, elle a tout d’abord un caractère institutionnel, mais émane aussi des dysfonctionnements internes des structures politiques, et de certaines dimensions culturelles de la politique marocaine. Enfin la rente économique est citée en dernier, illustrée par les dysfonctionnements du marché dans leur globalité, tout en étant aussi des rentes drainées par des milieux « politiquement connectés ». Partant de ce constat, l’auteur propose pour alternative le rêve d’un système de valeurs à travers ce qu’il appelle une charte de citoyenneté, ce qui signifie d’abord le rêve d’un Etat démocratique, fort et sans rentes indues.
A travers un diagnostic politique, l’auteur note l’histoire d’une lutte acharnée autour du pouvoir de 1956 à 1998, puis une période d’apaisement avec le Roi Mohamed VI mais où la faiblesse grandissante des partis politiques et de leur représentativité, accompagnée de la lancée conservatrice du PJD, ne cessent de susciter les inquiétudes. Que faut- il alors pour retrouver une « faisabilité » pour ce rêve ? Benamour constate : « Ce qui est paradoxal, c’est que ce regain de religiosité ne s’accompagne pas réellement de la mise en évidence des valeurs fondamentales proclamées aussi bien par l’Islam que par les acquis universels ; nous assistons en fait à une réelle panne en termes de valeurs ; on se proclame de la spiritualité musulmane, mais dans les faits on réduit souvent l’islam à des interdits qui frisent parfois le ridicule ; on va certes à la mosquée, mais les chaines de solidarité s’affaiblissent ».
Il cite la nécessité de préciser le référentiel religieux pour mieux le délimiter vis-à-vis de la sphère politique ; la clarification de la séparation des pouvoirs et leur répartition au niveau de l’exécutif ; mais il note aussi « la perte de représentativité de nos organisations politiques … notre système électoral éparpille le champ politique et ne permet pas l’émergence de majorités claires » et propose la recomposition du champ politique avec l’adoption d’une représentation électorale menant à des majorités claires ; la mise en place d’une régionalisation réelle et la décongestion de l’Etat, par son recentrage sur ses fonctions de base et le renvoi des autres à des structures plus appropriées.
Dans cette lecture politique, Benamour apporte une perspective précise en termes d’analyse. Tout en sauvegardant la modération, la cohérence et un certain pragmatisme il adopte beaucoup de rigueur dans l’identification des réformes et la définition des acteurs qui devront les porter . Toutefois, si on prend en compte la nature et les profondes caractéristiques des parties concernées, les propositions alternatives de l’auteur défient et paraissent difficiles sinon quasiment utopiques aujourd’hui. Est- ce la raison pour laquelle il a tenu à parler de rêve ?! Peut être.
Sur le plan économique, l’auteur s’appuie aussi sur la même approche allant d’une analyse des facteurs à des propositions alternatives. Il relate ainsi la longue période de « tâtonnements » s’étalant depuis l’indépendance jusqu’au programme d’ajustement structurel (1956-1983). Il considère que la deuxième phase, celle d’avant le gouvernement de l’alternance en 1998, n’était qu’une démarche de réforme inachevée. Ce fut ensuite un parcours de redressement jusqu’au 20 février 2011, dont la suite a des caractéristiques spécifiques avec la nouvelle constitution et l’émergence du PJD et du gouvernement Abdel Ilah Benkirane.
En tout cas, à la fin du mandat de celui-ci en tant que premier chef de gouvernement, dans un nouveau contexte politique et économique, le Maroc a pour bilan une compétitivité économique insuffisante pour assurer la logique d’émergence et ce, malgré beaucoup de données économiques encourageantes.
A ce niveau aussi, des inquiétudes s’installent autour de résultats économiques en demi-teinte et des retards majeurs relatifs à des réformes primordiales en justice et en éducation. Benamour note ainsi « on semble vivre dans une sorte de cercle vicieux sociétal au moment même où les potentialités du pays sont réelles ». Il incrimine à ce propos « le faible niveau de conscience politique » chez « une bonne partie » des Marocains et le positionnement « assez conservateur des élites». Il écrit : « L’une des inconséquences les plus pénibles me semble être liée au fait que beaucoup de Marocains n’ont pas encore pris conscience de l’impératif de mériter pour gagner, ni de produire avant de répartir ».
Pour que s’accomplisse le rêve de Benamour, il appelle au redéploiement de l’action économique dans quatre directions ; une action soutenue contre les rentes notamment par le biais d’une nouvelle législation de régulation du marché, une « synthèse » entre la compétitivité et l’action sociale, une synthèse tout aussi nécessaire entre l’entreprenariat d’adaptation à la mondialisation et l’auto entreprenariat indispensable à l’emploi, et consacrer enfin la priorité aux secteurs d’avenir. En appui à ces grandes options, il appelle à mettre en évidence deux choix horizontaux : l’entreprenariat et la recherche axée sur les secteurs prioritaires et des universités de pointe.
Le cinquième et dernier chapitre de cet essai se trouve consacré au rêve dans sa dimension sociale, où il évoque un modèle viable assurant protection et égalité des chances et « sans rentes indues ». Au niveau de l’analyse, l’auteur rappelle le bilan national marqué par un déficit en développement humain, la persistance de la pauvreté et des inégalités, ainsi que l’expansion de l’intégrisme religieux. La priorité aux réformes dans ce champ repose sur un social qui, sur le plan individuel respecte la logique du marché, mais qui agit en faveur du renforcement des acquis à caractère collectif. La clé de voute ou l’outil stratégique de ces réformes concerne l’éducation et le système éducatif et de formation, la mise en place des valeurs de la qualité et du mérite. Il n’oublie pas à ce niveau encore la nécessité de se consacrer à l’exercice des droits humains fondamentaux et à la lutte contre les extrémismes religieux et communautaires.
En tout cas, pour Benamour, le Maroc se porte relativement bien mais pourrait se porter beaucoup mieux s’il s’engageait dans le démantèlement des blocages rentiers. Le mouvement du 20 février en son temps, version marocaine du printemps dit arabe, a signifié selon lui que le Maroc aspire à passer à une nouvelle étape de réformes « socio-économico-politiques profondes et plus difficiles » ; il s’agit aujourd’hui de mettre en place quatre grandes séries de réformes nécessaires, dont une charte de citoyenneté libératrice fondée sur les valeurs qui rassemblent profondément les Marocains ; une gouvernance fondée sur une démocratisation réelle, une économie concurrentielle et un modèle social soucieux des droits humains fondamentaux.
Ce livre est une porte ouverte sur la réflexion comme élément préalable nécessaire à toute approche politique du contexte marocain. Il démontre que la flamme de Benamour reste tout aussi d’actualité que trois décennies auparavant, lorsqu’il évoquait une approche social-démocrate au sein de ses anciens irréductibles camarades de gauche ; ceux là même dont la flamme s’est éteinte depuis longtemps !
Par : Bachir Znagui
D’une société de rente à une société de mérite
Rêvons le meilleur pour le Maroc
Par Abdelali Benamour
Editions : La Croisée des chemins
Prix: 80 DH / 16 €