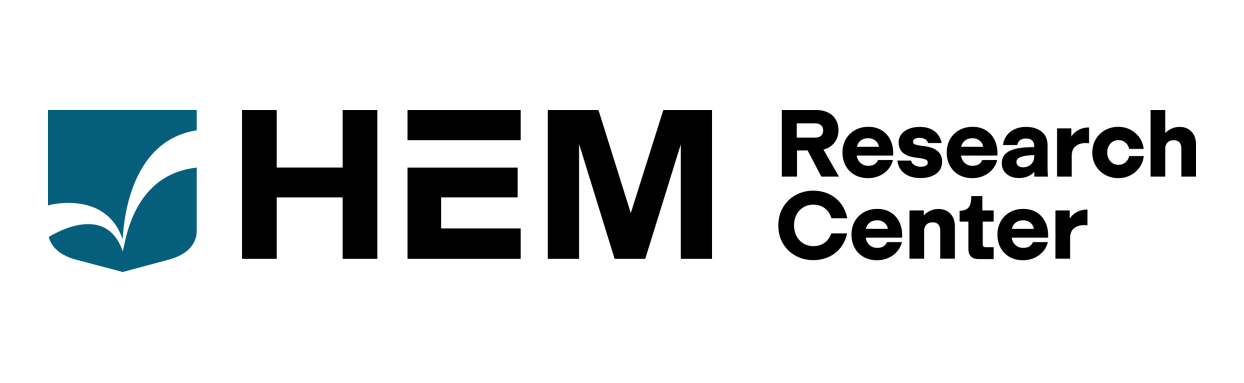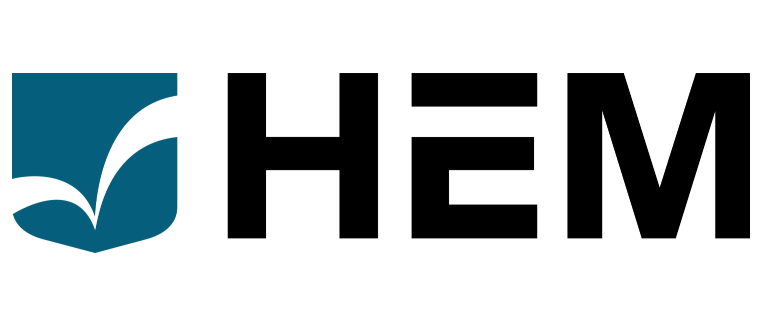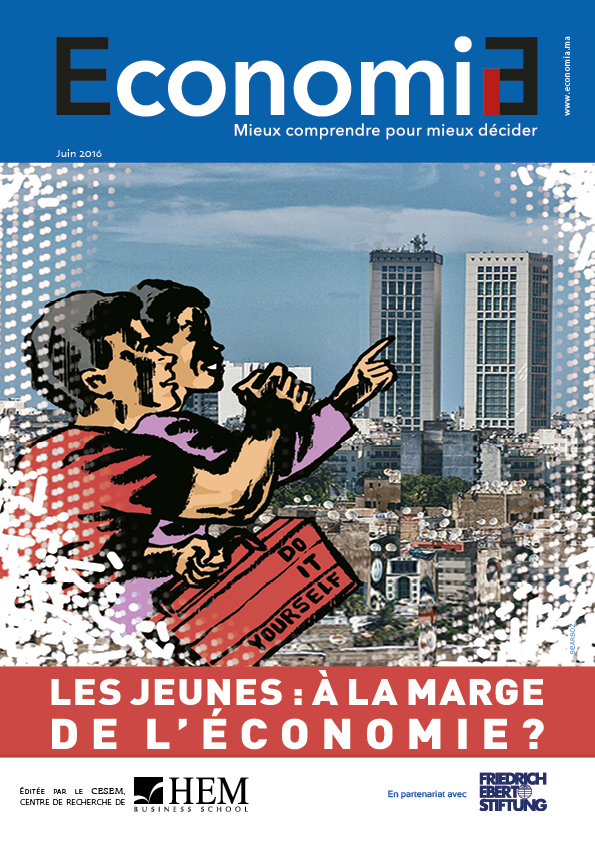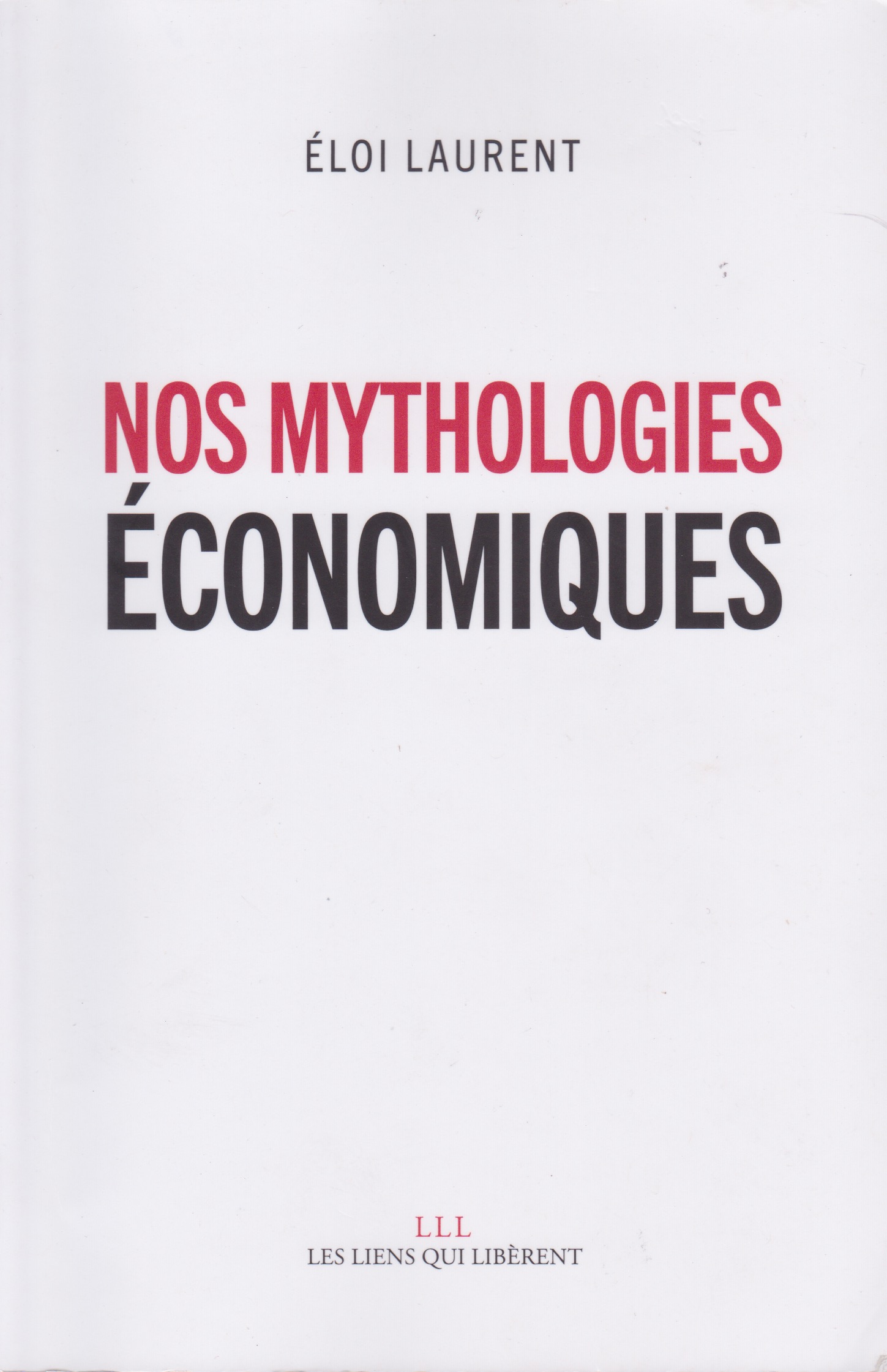Trois discours dominants verrouillent le débat sur l’économie et entravent le débat démocratique : le néolibéralisme, la social-xénophobie et l’écolo-scepticisme.
L’économie est devenue « l’impératif social que ceux qui gouvernent ne sont plus capables d’imposer par la force ou la persuasion », déplore l’économiste français Éloi Laurent. Sa rhétorique relève d’un « culte de la fatalité », prescrivant renoncements, frustrations, punitions… Ce chercheur à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) y voit une nouvelle forme de mythologie, en ce sens où Barthes écrivait que « le mythe est une parole dépolitisée ». En effet, la façon dont on présente aujourd’hui l’économie ferme le débat public : « Elle qui se veut une injonction permanente au changement et à la réforme, enferme les individus et les groupes dans le monde tel qu’il est en disqualifiant les dissidences et en étouffant les pensées nouvelles. » Éloi Laurent se propose de déconstruire trois discours dominants, le néolibéralisme, la social-xénophobie et l’écolo-scepticisme, afin de redonner goût au questionnement économique. Pour chacun, il identifie les principales antiennes et démontre en quoi il s’agit d’idées fausses, de contre-vérités ou d’escamotages idéologiques.
La partie la plus développée concerne le néolibéralisme. L’auteur en souligne la « morale simpliste » qui occulte le rôle des institutions sociales (services publics, redistribution, protection sociale…) pour prôner « un absolu mercantile qui n’a jamais existé ». « Une économie de marché dynamique repose sur une concurrence libre et non faussée » est la première contre-vérité qu’il décortique : « Le « partenariat public-privé », aujourd’hui présenté comme un outil particulièrement innovant de gestion publique, est en réalité la définition la plus simple de l’économie de marché », répond Éloi Laurent, pour qui la vraie question est « Qui assume les risques et les coûts de l’économie de marché ? Qui en possède les rentes ? » Pour lui, « les promoteurs du prétendu « libre » marché ne réclament absolument pas la fin de l’intervention publique dans l’économie, ils demandent simplement que celle-ci soit détournée en leur faveur ! […] Le « modèle économique » de ces « entrepreneurs » consiste à se spécialiser dans la captation des subventions publiques. » À ceux qui arguent de l’impuissance du politique à contrer la pression des marchés financiers, il rappelle le rôle central joué par la puissance publique dans la libéralisation financière et le pouvoir d’attraction que peut exercer la dette. De même, « l’« ubérisation » de l’économie » est analysée comme l’exploitation des failles de la régulation publique, qui aboutit à « la monétarisation des activités gratuites, la mobilisation du capital non marchand et, de manière générale, l’expansion de la sphère marchande sur la sphère privée », dont on peut se demander si c’est politiquement légitime… Seconde antienne : « Il faut produire des richesses avant de les distribuer ». Fausse naïveté, qui oppose entrepreneur et « assistés » et masque le problème de fond : la contribution équitable de tous à l’effort collectif, sous forme d’impôt et de juste rémunération du travail. « L’État doit être géré comme un ménage ou comme une entreprise » revient à ne pas tenir compte des actifs de la puissance publique pour ne regarder que la dette, ce qu’on « ne ferait pour aucune entreprise », et à oublier que la dette publique « correspond à des actifs qui ont pour nom l’éducation, la santé ou le logement ». « Les régimes sociaux sont financièrement insoutenables » ? Certainement pas autant que les marchés d’actions, « sans parler des produits financiers dérivés… » « Les « réformes structurelles » visant à augmenter la « compétitivité » sont la clé de notre prospérité » ? Mais à quelle aune évalue-t-on cette compétitivité ? productivité horaire ? qualité de la main d’œuvre ? qualification des travailleurs ? « Si l’objectif est de réduire la « compétitivité » au coût du travail et d’engager des « réformes structurelles » pour faire baisser celui-ci en réduisant les droits sociaux, il s’agit là d’une stratégie économique de pays pauvre (les pays émergents eux-mêmes empruntent la direction inverse ».
Déconstruire pour libérer la pensée
Dans une seconde partie, Éloi Laurent analyse le discours social-xénophobe de l’extrême droite, obsédé par l’immigration. « Les flux migratoires actuels sont incontrôlables et conduiront sous peu au « grand remplacement » de la population française » : or les migrations ne concernent que 3 % de la population mondiale, qui est plus que jamais sédentaire. La vraie question est « comment la France cultive-t-elle la richesse d’une population devenue tranquillement diverse au cours du XXème siècle ? » « L’immigration représente un coût économique insupportable » : considérer uniquement la dimension économique de l’immigration est le cœur d’une logique xénophobe ; le vrai coût est celui de la non-intégration, avec ce qu’elle implique de discriminations sur le marché du travail et de gâchis de compétences et de talents.
Enfin, Éloi Laurent se penche sur la régression de l’écologie au profit de discours qui en contestent les analyses, arguant que « Nos crises écologiques sont exagérées à des fins idéologiques », que « Les marchés et la croissance sont les véritables solutions à l’urgence écologique », ou qu’« On ne peut pas changer les comportements économiques sans renoncer au libéralisme ». La question de fond est ici comment les incitations, notamment économiques, peuvent préserver les libertés individuelles et le bien commun. « L’écologie est l’ennemie de l’innovation et de l’emploi » ? Un simple regard sur le dynamisme de la Finlande, de la Suède et des Pays-Bas, très régulées en matière environnementale, apporte le démenti. La transition écologique, une affaire de riches et un synonyme d’injustice sociale ? Faux : les crises écologiques touchent d’abord les plus pauvres. Il faut inventer une « transition social-écologique », car séparer les deux n’a aucun sens.
Éloi Laurent livre ici un petit ouvrage très clair et facile à lire, abondamment illustré à partir du cas de la France, et qui remet fermement les choses en perspective et combat efficacement cette forme de fondamentalisme. D’utilité publique.
Par : Kenza Sefrioui
Nos mythologies économiques
Éloi Laurent
Les Liens qui libèrent, 112 p., 160 DH