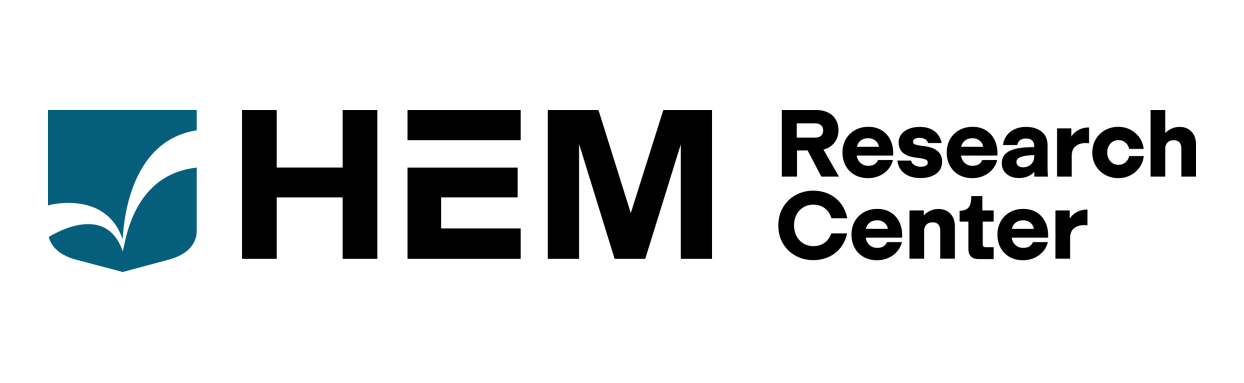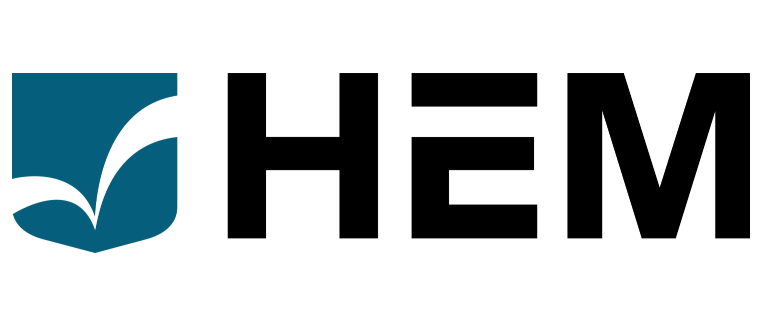Programme Economia members
Le programme Economia Members est une formation à la recherche par la recherche destinée aux étudiants de 3ème et 4 ème années de HEM qui vis à transmettre aux étudiants une culture de recherche, d'unvestigation et d'innovation. Au cours de cette formation, les Economia Members mènent un travail de recherche appliquée qui leur permet de contextualiser les enseignements thériques avec des cas concrets et à développer leur esprit critique ainsi que leurs capacités de synthèse et d'analyse de problèmatiques économiques, socials et managèriales complexes.