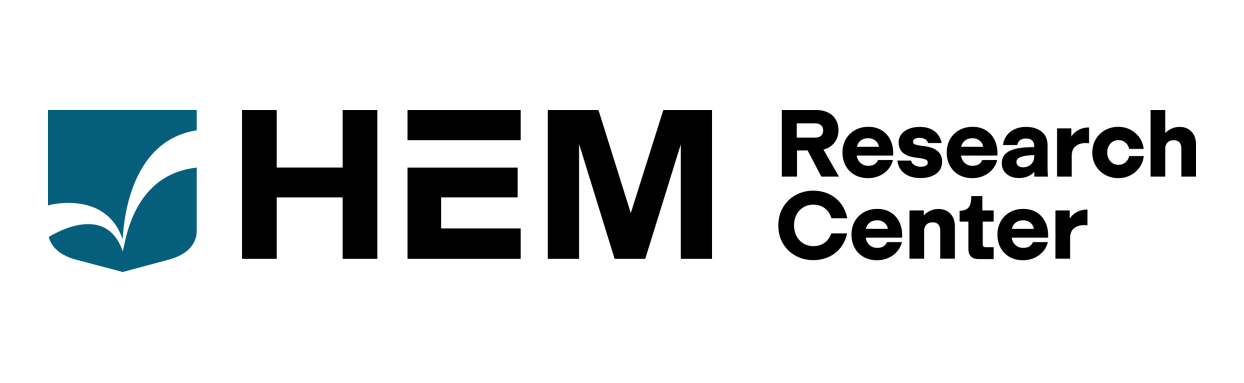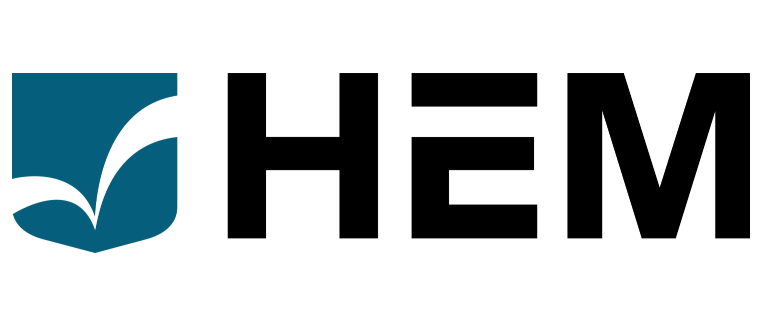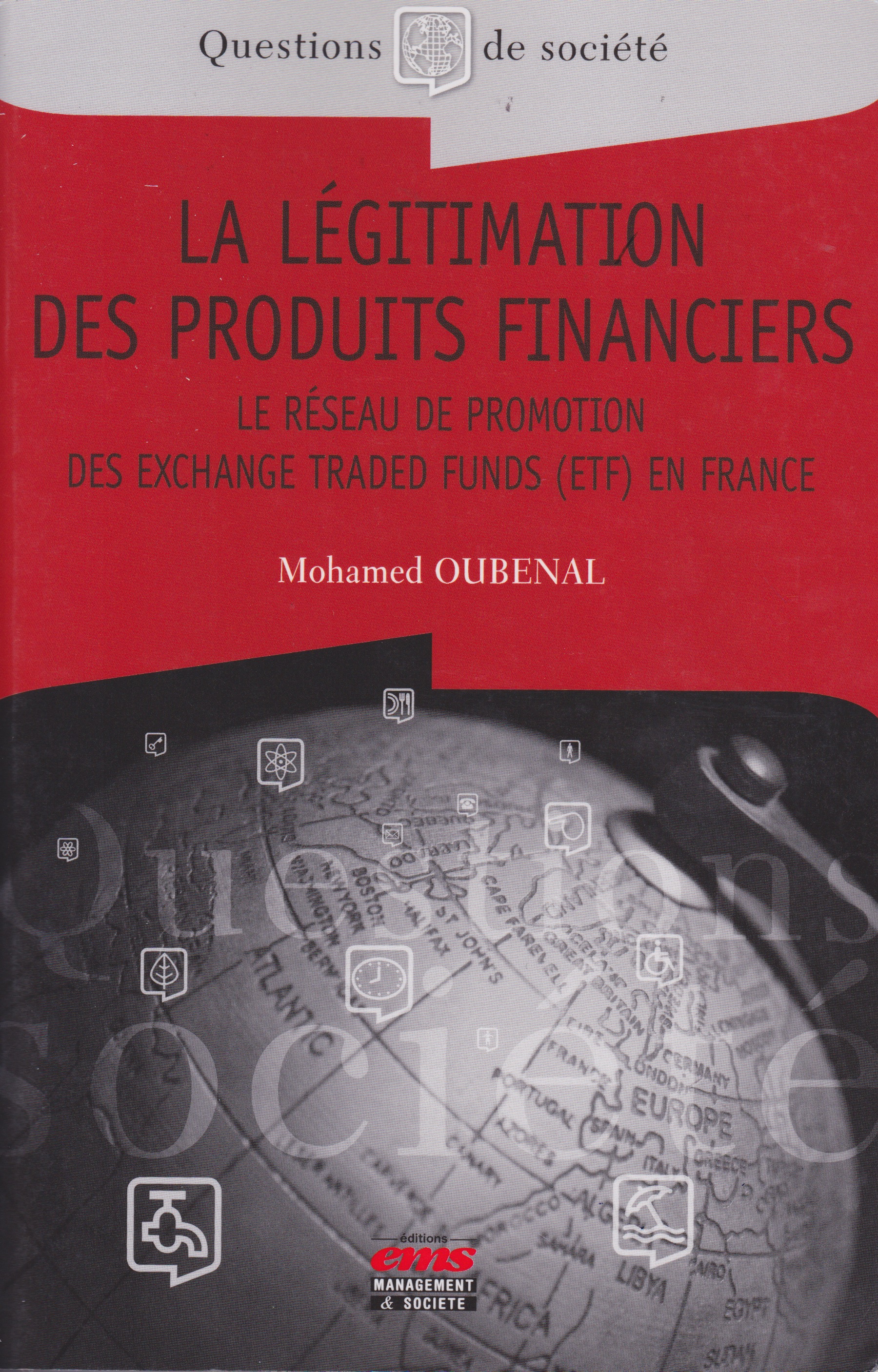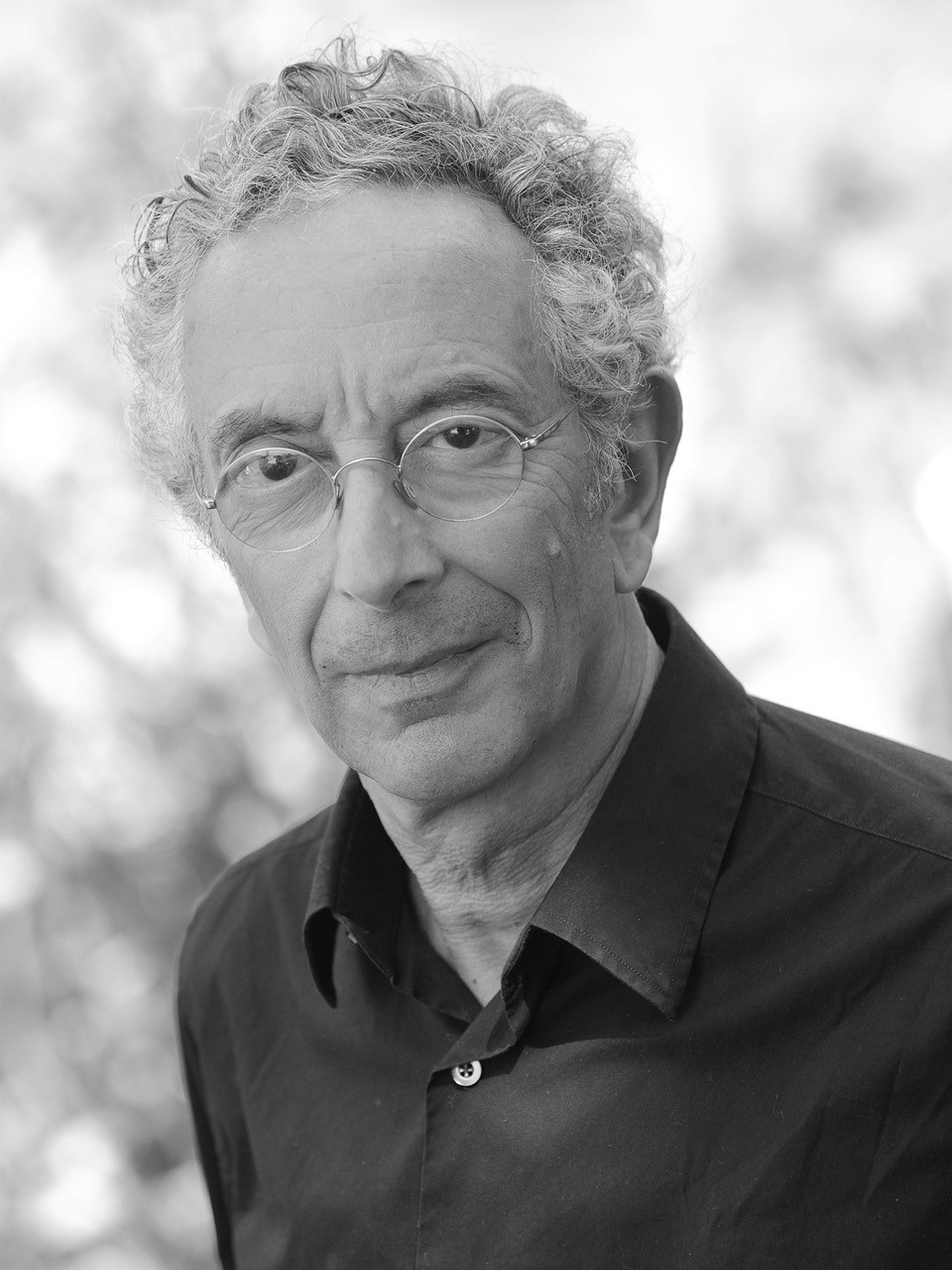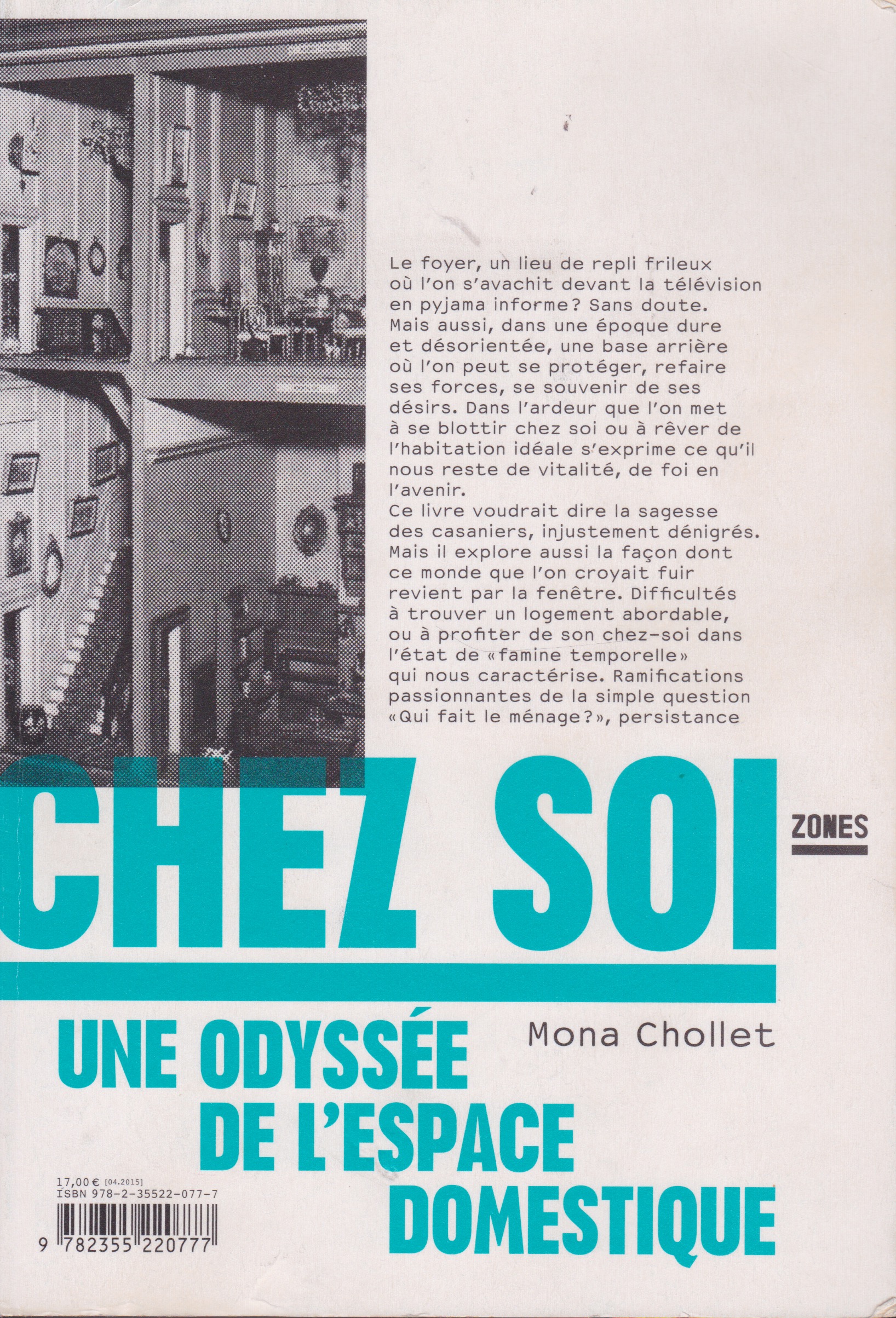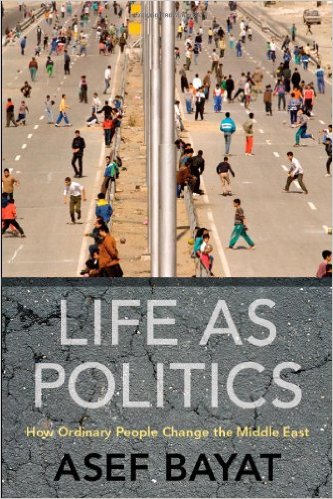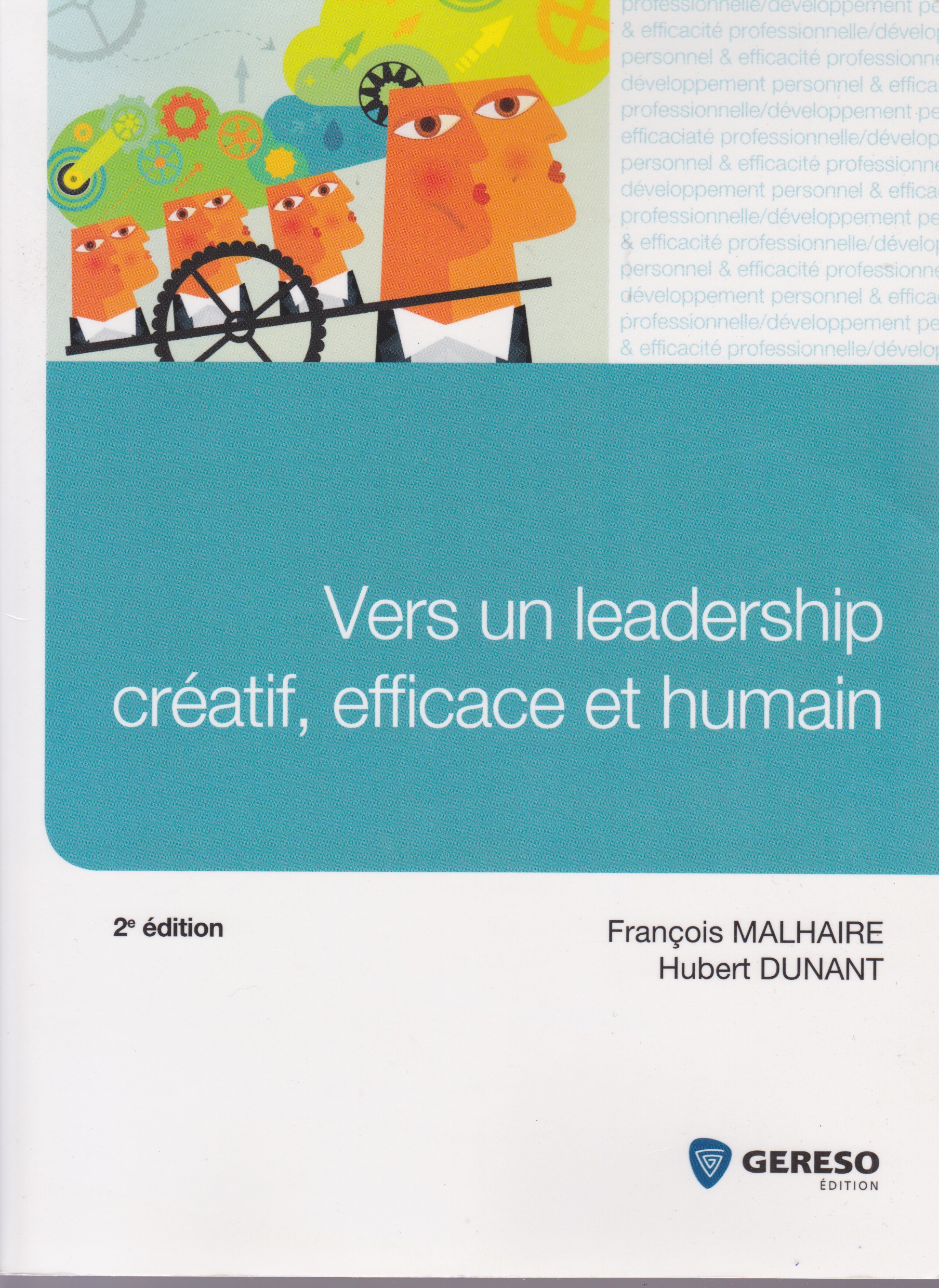Les voies impénétrables de la démocratie au Moyen orient
L’action et le changement social dans le Moyen-Orient musulman, celui des sociétés où la religion semble occuper une position de premier plan, constitue l’une des questions majeures des travaux d’Asef Bayat tout au long de sa carrière académique ; son livre , qu’on pourrait aussi intituler « la politique par la rue » ne se distingue pas de cette optique , puisqu’il focalise « sur les diverses façons dont les gens ordinaires, les subalternes luttent pour affecter les contours du changement dans leur société ».C’est ce qu’il appelle « analyser l’histoire de l'action en temps de contraintes », comment les gens font pour découvrir et générer de nouveaux espaces dans lesquels « ils peuvent exprimer leur dissidence et affirmer leur présence dans la quête de l'amélioration de leur vie ».
Asef Bayat est actuellement enseignant chercheur de sociologie à l’université de l’’Illinois aux USA , il fut également pendant plusieurs années enseignant à l’université américaine du Caire. Né en Iran au sein d’une famille azérie, il a fait ses études doctorales en Grande Bretagne, où il a eu son PHD à l’université de Kent. Il a exercé aussi comme professeur visiteur aux universités d’Oxford, Columbia et Berkeley.
Ce livre initialement écrit avant 2010 fut un des rares recours intelligibles au cours du printemps dit arabe. Asef Bayat était alors directeur académique de l’Institut Néerlandais international pour les études de l'islam dans le monde moderne (ISIM) à la Leiden University, une entreprise scientifique remarquable combinant rigueur académique et engagement social constructif.
Dans ce travail de recherche et de réflexion il examine ce qu’il appelle les « non-mouvements », c’est à dire les efforts collectifs de millions d'acteurs non collectifs, menés à travers les principales places, rues, ou parmi des communautés du Moyen orient. Son approche espère offrir de nouveaux outils de travail à la science sociale ; il écrit dans son introduction « Mon souhait est que ce livre pourrait offrir une contribution du Moyen-Orient, même modeste, aux débats académiques sur les mouvements sociaux et le changement social ».
Avant 2011, écrit-il, on percevait le Moyen-Orient musulman comme immuable, figé dans ses propres traditions et son histoire. Asef Bayat fait remarquer toutefois que de telles présomptions ne reconnaissent pas les actes du quotidien et de la routine, « cette façon à travers laquelle les gens ordinaires font des changements significatifs par des actions de tous les jours. » « Nous analysons souvent les révolutions rétrospectivement, rarement celles qui sont attendues ou souhaitées, car les révolutions ne sont jamais prévisibles ou prédictibles. »
Bref, « La vie en tant que politique : comment les gens ordinaires changent le Moyen-Orient » est à sa seconde édition écrite et publiée en 2013.Mais sa première version parue quelques mois avant le Printemps arabe fut quasiment prémonitoire, ce livre en temps opportun et prophétique a jeté un éclairage distinct sur les actes de protestation qui étaient en cours.
La deuxième édition fut entièrement mise à jour pour refléter les événements récents ; elle comprend trois nouveaux chapitres sur le printemps arabe et le Mouvement Vert de l'Iran.
Asef Bayat est aussi critique envers le corollaire de l’analyse occidentale selon laquelle la région est entièrement imperméable au changement, c’est-à-dire cette théorie qui table sur les réformes graduelles et sélectives menées par les forces et les pouvoirs en place.
Dans le premier chapitre de son livre, « art of presence », Asef Bayat relève que, depuis longtemps déjà, le principal courant orientaliste en Occident a dépeint le Moyen-Orient musulman comme une entité monolithique, fondamentalement statique, et donc une « exception » sociale.
Pourtant, rappelle-t-il, le Moyen-Orient a été le foyer de nombreux épisodes insurrectionnels, de révolutions à l'échelle nationale, et de divers mouvements sociaux (tel que l'islamisme). Donc pour lui, le Moyen Orient fut un terrain de grands progrès pour le changement, même si l’islamisme avait été pendant longtemps largement exclu du mode d'enquête développé par les théoriciens des mouvements sociaux en Occident. Paradoxalement aussi ; des académiciens de la région ont eu tendance aveuglément à déployer les modèles classiques et les concepts des théories du mouvement social dans les pays occidentaux pour les appliquer aux réalités sociales de leurs pays, sans reconnaître de manière suffisante que ces modèles tiennent de différentes généalogies historiques, et offrent donc peu de secours pour expliquer la texture complexe et dynamique du changement et des résistances dans cette partie du monde.
La réalité du non mouvement est complexe ; mais chaque jour des dynamiques sociales modifient les sociétés du Moyen-Orient de manière généralement non reconnue par les observateurs occidentaux et indésirable du côté des détenteurs du pouvoir dans la région.
Pour l’auteur, une approche fructueuse exigerait des sociologues une innovation analytique qui pense et présente de nouvelles perspectives à l’observation, un nouveau vocabulaire pour parler, et de nouveaux outils analytiques pour donner un sens spécifique aux réalités régionales. Et c’est dans cet état d'esprit qu’il a examiné à la fois les politiques contestataires et les « non-mouvements" sociaux comme principaux véhicules pour produire un changement significatif au Moyen-Orient.
Politique contestataire et changement social
Examinant presque un siècle d’évènements et d’histoire du Moyen orient, l’auteur met en évidence à la fois le dynamisme des sociétés concernés, la complexité des contextes et des interférences, et comment certaines formes d’organisation des politiques de contestation sont efficaces ou tout au moins à l’origine de réformes non négligeables. Il note également que certains mouvements ont émergé même comme des alternatives aux tendances islamistes plus redoutables dans le Moyen-Orient musulman. L’échec de l'islamisme à introduire un ordre démocratique inclusif a donné lieu à un certain « post-islamisme », qui pourrait remodeler la carte politique de la région.
Asef Bayat considère que le contexte actuel reflète un conflit où des militants religieux continuent de déployer l'islam comme cadre idéologique d’un ordre moral et sociopolitique, alors que les musulmans laïques, les militants des droits de l'homme et, en particulier, les femmes de la classe moyenne ; font campagne contre cette lecture de l’islam souscrivant au patriarcat et justifiant leur assujettissement.
L’auteur prend pour exemple les mouvements des femmes dans la région et en examine les contours sur deux siècles d’histoire puis retombe sur l’actualité pour évoquer les mouvements des jeunes et les protestations menées par les islamistes dans certains pays de la région ; Il consacre dans ce livre deux chapitres très riches en données et en analyse au « féminisme ordinaire », (ou celui de tous les jours), et la relation de l’islam et de l’islamisme aux loisirs ; à l’art et au « drôle ».
Il qualifie de post islamisme ces courants qui tentent de défaire l'islamisme comme projet politique en fusionnant foi et liberté ; Etat démocratique laïque et société religieuse. Il voit en eux des projets qui cherchent à marier Islam et libertés individuelles, démocratie et modernité, dans l’optique de générer ce que certains ont appelé la « modernité alternative ».
Parallèlement au courant post-islamiste, Asef Bayat constate et reconnait que l’islam continue de servir d’idéologie mobilisatrice cruciale encadrant le mouvement social dans le contexte d’un moyen orient intolérant et répressif, se déployant contre les mouvements contestataires notamment en Egypte, ou en Iran.
Politique de la rue et la rue de la politique
L’espace public urbain continue à servir de théâtre clé à la contestation, vendeurs ambulants squattant les espaces publics, les jeunes qui s’installent dans les coins des quartiers, les enfants de la rue et leurs communautés, les femmes qui prolongent leurs activités sur les passages et voies publiques ; ou les manifestants qui défilent, mettent tous en cause les prérogatives de l'Etat relatives à la maitrise des voies publiques et donc peuvent faire l’objet de représailles. Avec une analyse très fine des formes d’organisation des actions contestataires dans les espaces publics. Asef explique qu’au-delà du conflit entre des autorités et des groupes désinstitutionnalisés ou informels sur le contrôle de l'espace public, les rues des villes sont des espaces où se forgent les identités et s’agrandissent les solidarités, au-delà de leurs cercles immédiats, pour inclure des inconnus, des étrangers ou des passants occasionnels en mesure d'établir une communication latente avec les autres, reconnaissant leurs intérêts mutuels et des sentiments partagés.
Cette approche permet à Asef de mettre en relief des tendances ou courants et sensibilités socio politiques du Moyen orient peu étudiés ou identifiés jusque-là ; et aussi de voir dans des acteurs locaux les seuls auteurs des améliorations politiques et sociales survenues. Ce qu’il appelle « l'art de la présence » c’est « le courage et la créativité d'affirmer une volonté collective, en dépit de tous les obstacles, pour contourner les contraintes, en utilisant ce qui est disponible et découvrir de nouveaux espaces à l'intérieur desquels on se fera entendre, voir, sentir, et se réaliser ".
Bayat présente de larges illustrations de son modèle de changement social insistant sur le fait que l’évolution en cours démontre que grâce aux pratiques banales de la vie au jour le jour, des gens ordinaires réduisent à la fois ; la puissance des Etats autoritaires et le pouvoir des mouvements religieux, et donnent ainsi lieu à des changements sociopolitiques au sein de leurs communautés, villes, gouvernements, religions, et eux-mêmes.
D’une certaine manière, Bayat met l'accent sur la façon dont les gens exercent en période de mondialisation, le pouvoir dans des espaces de contraintes néocoloniales ; il croit au signe avant-coureur de transformations démocratiques et d’un tournant d’époque vers la réforme post islamique progressive. Il croit identifier ces changements au sein des pratiques publiques des différents non-mouvements qu’il a étudiés ; mais il ne dispense pas les citoyens de la région de la nécessité de pratiquer une action politique plus claire et déclarée en faveur des changements politiques, ni de les voir consacrer une attention particulière aux impératifs économiques inévitables , imposées de l'extérieur.
Par : Bachir Znagui
Asef Bayat, Street politics, Ed. Stanford University Press, 2013